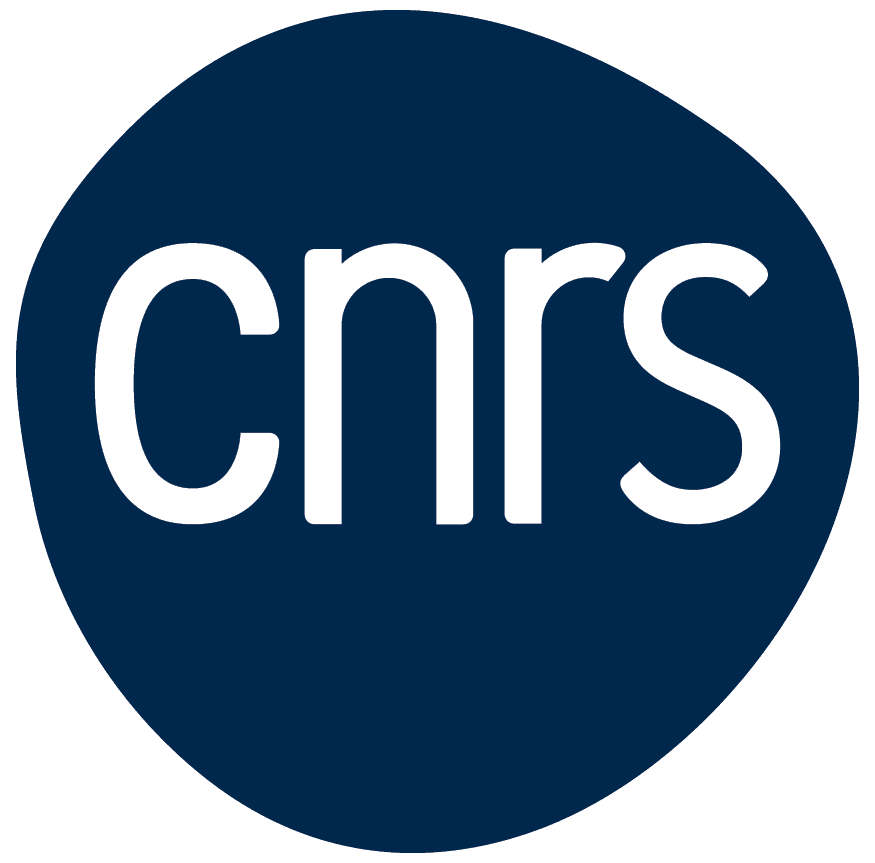Accueil>Terrorisme, contre-terrorisme et rivalité mimétique.
08.04.2025
Terrorisme, contre-terrorisme et rivalité mimétique.
Entretien avec Mathias Delori
Dans son récent ouvrage La guerre contre le terrorisme comme rivalité mimétique paru aux éditions Peter Lang, le politiste du Centre de recherches internationales, Mathias Delori, s’interroge sur les catégories de pensée qui englobent les notions de terrorisme et de contre-terrorisme, sur leur pertinence pour penser et comprendre ces phénomènes, et sur leurs effets. À partir d’une enquête socio-historique fondée sur un travail d’archives et d’entretiens, Mathias Delori analyse comment partisans du djihad armé et de la guerre globale contre le terrorisme ont construit un monde qui a rendu possible une escalade de la violence. Entretien.
Vous nous avez rappelé dans un précédent entretien à quel point il est complexe de définir le terrorisme, qui ne peut, selon vous, être considéré comme un concept sociologique. Pouvez-vous nous indiquer comment vous avez procédé dans cet ouvrage pour qualifier le terrorisme et ainsi étudier ses manifestations ?
Il existe des définitions scientifiques du terrorisme. Pour Raymond Aron, est qualifiée de terroriste toute action violente dont « les effets psychologiques sont hors de proportion avec ses résultats purement physiques »(1). La sociologue Isabelle Sommier a affiné cette définition en suggérant que des groupes armés peuvent produire de tels effets en opérant une « disjonction » entre les victimes, souvent civiles, et la cible, à savoir l’État(2). Ces définitions sont utiles pour décrire et comprendre certains phénomènes de violence politique domestique, notamment lorsque des États libéraux s’interdisent d’avoir recours à des politiques contre-terroristes d’exception, produisant ainsi une démarcation claire entre terrorisme et contre-terrorisme. La Norvège est un exemple intéressant. Le 22 juillet 2011, le néo-nazi Anders Behring Breivik a tué 77 personnes de manière terroriste – selon la définition précitée – et l’État norvégien a réagi en mobilisant des instruments de sécurité encadrés par le droit libéral : la police et la justice en ce qui concerne Breivik, et le renseignement pour prévenir de futurs drames du même genre.
En revanche, ces définitions ne sont pas opératoires pour décrire et comprendre la violence politique en contexte illibéral et en contexte de guerre, car les méthodes des uns et des autres tendent à se ressembler. C’est du moins ce que j’ai observé au cours de cette enquête sur la « guerre globale contre le terrorisme », à savoir l’ensemble des opérations guerrières mises en œuvre par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France depuis la fin des années 1990 pour lutter contre al-Qaïda, puis l’organisation État Islamique (EI), et leurs affidés. La réflexivité oblige à constater que les définitions évoquées ci-dessus s’appliquent aussi bien à certaines tactiques guerrières contre-« terroristes » qu’à ce que nous appelons « terrorisme ». Ainsi, les archives de la politique des « interrogatoires renforcés » mise en œuvre par l’administration Bush au cours des années 2000 ne laissent aucun doute : ses instigateurs savaient que la majorité des personnes torturées étaient innocentes et une technique d’interrogatoire – la technique numéro 35 du répertoire de « techniques d’interrogation standard » de la prison d’ Abu Ghraib – prévoyait l’utilisation des chiens pour « effrayer » les détenus(3). On peut faire la même remarque à propos de la surveillance et des frappes de drones au Yémen, en Somalie, au Pakistan ou en Irak à partir du milieu des années 2000. Notre collègue Rebecca Mignot-Mahdavi a rappelé dans un ouvrage récent(4) que ces aéronefs produisent des effets psychologiques hors de proportion par rapport au résultat physique de l’action, comme dans la définition aronienne du terrorisme. Si les drones tuent moins, toute chose égale par ailleurs, que les chasseurs-bombardiers, leur présence continue dans le ciel, leur vrombissement et la menace continue qu’ils représentent, engendrent un stress et des traumatismes dont on peine, sous nos latitudes, à prendre la mesure.
D'autant que les terroristes des uns sont souvent les combattants de la liberté des autres...
Oui. À ce problème du caractère non discriminatoire de ces définitions du terrorisme en situation de guerre s’en ajoute un autre : il est difficile de dépouiller le terme de ses accents normatifs négatifs. Si j’affirme que la politique « d’interrogatoires renforcés » de l’administration Bush relève du terrorisme, je risque d’être soupçonné de condamner moralement cette politique ou de vouloir relativiser le terrorisme d’al-Qaïda alors que telles ne sont pas mes intentions. Je veux seulement faire œuvre de chercheur en sciences sociales : comprendre, non pas pour excuser, mais pour éclairer.
Je contourne ces obstacles épistémologiques en utilisant le terme « terrorisme » avec des guillemets. Ces guillemets n’ont pas pour fonction de renverser la logique accusatoire. Ils dénotent simplement que je n’utilise pas le terme en tant que concept sociologique. Le « terrorisme » dont il est question dans cet ouvrage regroupe l’ensemble des actes qualifiés comme tels par les trois principaux États de la « guerre globale contre le terrorisme » : les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Ce « terrorisme » possède un volet matériel – des explosions, des morts, des blessés – et une dimension discursive : le fait de qualifier cette violence de « terroriste » plutôt que comme un acte de résistance, comme une tactique de guerre asymétrique ou encore comme un crime de droit commun. Le fait de parler de « terrorisme » plutôt que de « violence politique perpétrée par des groupes non étatiques », comme le font un certain nombre de chercheurs et chercheures, présente un avantage : on peut s’interroger sur ce que cette catégorisation produit. En l’occurrence, ma thèse est que cette catégorisation et les pratiques guerrières qui l’ont accompagnée ont produit une escalade de la violence au cours des années 2000 et 2010.
Justement, vous voulez comprendre ces deux violences – le terrorisme islamique et le contre-terrorisme guerrier – et vous récusez les explications en termes de radicalisation (des terroristes) ou d’impérialisme (des partisans de la guerre contre le terrorisme). Votre thèse est que le « terrorisme » et le contre-« terrorisme » guerrier représentent deux faces d’une même relation violente. Pouvez-vous développer ?
Oui. Ces explications en termes de radicalisation des uns et d’impérialisme des autres ont un point commun : elles ne s’intéressent qu’à l’un des deux belligérants tout en jetant, d’ailleurs, un regard normativement critique sur ses pratiques. L’approche relationnelle de la violence que je déploie dans ce livre se veut réflexive par rapport au rapport normatif à l’objet. Ces violences ne me laissent pas indifférent. J’ai perdu une connaissance dans un attentat, mais je m’efforce de trouver la juste distance. Cette approche est également plus éclairante. Elle permet, tout d’abord, de rendre justice au sens que les uns, les unes et les autres donnent à leurs pratiques. Les partisans de la « guerre globale contre le terrorisme » et les « terroristes » d’al-Qaïda ou de l’EI l’énoncent très clairement : ils sont en guerre. Ils n’utilisent pas ce terme de manière métaphorique comme a pu le faire Emmanuel Macron aux premières heures de la pandémie de Covid 19. Plus que d’être en guerre, ils la font. Concrètement, les bombardements français en Irak à partir d’août 2014 et les attaques commando comme celle du Bataclan en 2015 sont des actes de guerre. Or la guerre est une relation violente.
L’approche relationnelle de la violence que je mobilise diffère de celle qu’on trouve dans le noyau dur des études stratégiques. Ces dernières postulent que la guerre est une interaction violente structurée par des adaptations rationnelles aux actions de l’adversaire. De fait, de telles logiques se retrouvent dans la « guerre globale contre le terrorisme ». Par exemple, la centralité prise par les frappes de drones en Irak, au Yémen, en Somalie et au Pakistan à partir de la fin des années 2000 peut s’interpréter comme une adaptation stratégique aux attaques suicides qui ont causé de trop nombreuses victimes dans les rangs des forces terrestres contre-« terroristes » en Afghanistan et en Irak. Cette grille de lecture interactionnelle et rationaliste peut aussi éclairer le recours, par l’organisation État Islamique, aux attaques contre les civils des pays de la coalition internationale à partir de 2014/2015. Frappée depuis les airs, cette organisation ne pouvait pas riposter contre des troupes combattantes. Elle a réagi comme de nombreuses organisations se trouvant dans le même cas de figure : en intensifiant sa violence contre les civils(5). Cette grille de lecture en termes d’adaptations stratégiques souffre cependant d’un point aveugle. Elle est incapable de rendre compte de l’évolution des identités, des représentations de l’Autre et des affects guerriers dans le temps de la relation violente. C’est ce que la théorie de la rivalité mimétique permet de faire.
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette théorie de la rivalité mimétique et sur la manière dont vous entreprenez de la « sociologiser » ?
J’emprunte cette théorie à l’anthropologue René Girard. C’est un auteur singulier dans le paysage des sciences humaines et sociales. En effet, si la plupart des chercheurs et chercheures s’efforcent de produire des théories dites « de moyenne portée », c’est-à-dire éclairant un ensemble restreint de phénomènes, Girard entendait expliquer la violence sous toutes ses formes et sous toutes les latitudes de l’Antiquité à nos jours. Les matériaux qu’il a mobilisés – les tragédies grecques et les romans de l’époque moderne notamment – sont également originaux, d’autant qu’il ne les interprétait pas seulement comme des récits de fiction mais, aussi, comme des commentaires sur la réalité. Notons que Girard a fait preuve d’une certaine réflexivité sur le caractère iconoclaste de sa démarche lorsqu’il a écrit que sa théorie repose « sur des faits dont le caractère empirique n’est pas vérifiable empiriquement »(6). La théorie de Girard ne me semble pas applicable, telle quelle, à une enquête de sciences sociales. Je me suis donc appliqué à la sociologiser et je ne suis pas le premier à le faire. Didier Bigo, Daniel Hermant ou encore Xavier Crettiez ont fait œuvre de précurseurs. La revue Cultures et Conflits a aussi contribué à cette recherche. Enfin, mon travail doit beaucoup aux réflexions conduites dans les années 2010 au sein du groupe OCTAV (Observatoire Collaboratif sur le Terrorisme, l’Antiterrorisme et les Violences) animé par Philippe Bonditti.

René Girard a élaboré cette théorie pendant un demi-siècle, de telle sorte qu’il en a formulé plusieurs variantes. La première, exposée dans Mensonge romantique et vérité romanesque (1961), a pour clef de voûte la notion de « désirs mimétiques ». Elle stipule que les êtres humains croient désirer des choses, des personnes ou des idées pour elles-mêmes alors qu’en réalité, ils se prennent mutuellement comme modèle et désirent ce que l’autre désire. Girard ajoute que les acteurs se voilent la face sur la dimension mimétique de leurs désirs. Dans Le rouge et le noir de Stendhal, par exemple, Julien Sorel croit désirer Madame de Rênal de manière romantique, c’est-à-dire pour elle-même et contre les conventions sociales, alors qu’il imite en réalité Monsieur de Rênal, maire de la petite ville de Verrière, son modèle. C’est le sens du titre du livre de Girard : il existe une « vérité romanesque » derrière le « mensonge romantique » du désir pour l’être ou la chose aimée. Cela porte les germes de la violence, car « deux désirs qui convergent vers le même objet se font mutuellement obstacle »(7). Dans son ouvrage Achever Clausewitz (2007), Girard donne l’exemple des guerres franco-allemandes engendrées, selon lui, par le désir mimétique d’être la première puissance européenne et le seul porte-drapeau de la « Kultur » et de la « civilisation ». Cette variante de la théorie de la rivalité mimétique n’est toutefois pas articulable avec l’approche socio-historique que je déploie. Sa théorie de l’action est trop restrictive. Les désirs, mimétiques ou non, ne sont pas les seuls déterminants de l’action sociale, tout du moins pas à la guerre. La théorie est par ailleurs trop déterministe. Les acteurs apparaissent comme des éléments de mécanismes mimétiques qui les dépassent totalement.
Dans La violence et le sacré (1972), Girard formule une variante de sa théorie à la fois complémentaire de la première, mobilisable de manière autonome et plus compatible avec une démarche socio-historique. Elle porte non pas sur l’origine de la violence, mais sur son développement. La question est : pourquoi certaines rivalités prennent-elles la forme d’une escalade de la violence alors que d’autres sont résolues pacifiquement ou sous la forme d’un conflit violent stabilisé dans un régime de limites ? Girard répond que les sociétés humaines qui ont survécu à l’autodestruction ont inventé des stratagèmes : les rituels du bouc-émissaire dans le cas des sociétés traditionnelles et la justice pénale dans le cas des sociétés modernes. Mais la justice pénale internationale est trop peu internationale et trop faible pour réguler tous les conflits et leurs tendances mimétiques. Ce stratagème est donc inopérant.
Qu’en est-il alors de votre approche de la théorie girardienne ?
Ma théorie de la rivalité mimétique s’appuie donc sur une autre idée qui traverse toute l’œuvre de Girard : la question de la reconnaissance (ou non), par les acteurs, du caractère relationnel de la violence. Les configurations violentes où les acteurs reconnaissent le caractère relationnel de la violence ne tendent pas vers l’escalade. Elles peuvent même conduire à une réconciliation, comme l’a montré Valérie Rosoux à propos des relations franco-allemandes(8) . À l’inverse, la représentation de l’autre comme un agresseur tend à produire de l’escalade, car on passe facilement de cette idée à celle selon laquelle l’autre est un être cruel (un mécréant, un fanatique islamique…) et à la conclusion qu’il est légitime, face à la cruauté, de dépasser les limites de ce qu’on estime être, en temps normal, la juste violence. Les pratiques violentes deviennent parfaitement mimétiques quand la contre-cruauté répond à la cruauté, et inversement. Girard parle de « double monstrueux » ; Germaine Tillion des « ennemis complémentaires »(9).
Dans la configuration violente étudiée dans La guerre contre le terrorisme comme rivalité mimétique , ce mimétisme destructeur commence quand al-Qaïda estime que les bombardements états-uniens au Soudan et en Afghanistan en août 1998 justifient une attaque d’ampleur contre des civils (l’attaque du 11 septembre 2001) et quand les États-Unis décrètent, le 1er janvier 2002, que les « terroristes » d’al-Qaïda peuvent être considérés comme des « combattants illicites » ne bénéficiant pas, de ce fait, de la protection du noyau dur des conventions de Genève. Par la suite, les attaques contre les civils ont répondu à la torture et la torture aux attaques contre les civils. Le mimétisme réside dans le fait que la contre-violence des uns apparait comme de la cruauté aux autres, et inversement.
Quel est le mérite de cette théorie de la rivalité mimétique dans le cas présent ?
Outre le fait qu’elle est agnostique sur l’origine de la violence, cette interprétation de la théorie de la rivalité mimétique évite l’écueil du déterminisme. Si les logiques d’escalade ont dominé, certains acteurs ont fait, c’est tout à fait vrai, le choix de sortir de la relation violente après avoir reconnu le caractère relationnel de celle-ci. Au niveau des acteurs collectifs, citons la décision du gouvernement espagnol de retirer ses troupes d’Irak après les attentats de Madrid en 2004. Je documente aussi, dans mon ouvrage, des trajectoires individuelles. Au début du mois de mai 2004, par exemple, l’homme d’affaire américain Nicholas Berg est capturé puis décapité par des militants d’un groupe dirigé par Abu Musab al-Zarqawi. La vidéo, la première du genre, a fait le tour du monde. Deux ans plus tard, les forces armées états-uniennes répliquent en assassinant al-Zarqawi. En réaction, le père de Nicholas Berg exprime son désarroi avec dignité, face à cette conception contre-« terroriste » de la loi du talion : « Ma réaction est que je suis désolé lorsqu’un être humain meurt. Zarqawi est un être humain. Il a une famille qui réagit comme ma famille a réagi lorsque Nick a été tué, et je me sens mal pour cela ». Il convient de rendre justice à ces agentivités qui ont œuvré contre l’escalade mimétique(10).
À l’inverse, d’autres acteurs collectifs et individuels sont passés de la reconnaissance du caractère relationnel de la violence – synonyme de maintien de la violence dans un régime de limites – à la négation de cette relation et, par conséquent, à l’escalade mimétique. En ce qui concerne les acteurs collectifs, le cas le plus fascinant est la France. Au cours des années 2000, la France fait preuve de prudence par rapport à l’approche guerrière du contre-« terrorisme » islamique en participant de manière secondaire à la guerre d’Afghanistan et en s’abstenant de participer au bombardement et à l’invasion de l’Irak en 2003. Cette politique s’adosse alors à la conviction, formulée par un dirigeant de la DGSE devant le Sénat en 2010, selon laquelle la guerre contre le « terrorisme » attise le « terrorisme »(11). Contrairement aux États-Unis, au Royaume-Uni et à l’Espagne, la France n’est alors pas visée par des attentats islamistes majeurs. À partir de 2013-2014, en revanche, la France épouse l’approche guerrière du contre-« terrorisme » dans le Sahel et, surtout, en Irak contre l’organisation État Islamique. Les attentats des années 2015 et suivantes sont une conséquence de ce tournant. Je montre dans mon livre que des « experts » ont présenté ces attentats comme des agressions alors qu’ils avaient expliqué, une décennie plus tôt, que le non-engagement français en Irak lui avait épargné de nombreux attentats. Certains avaient même prédit, quand la France a commencé à bombarder l’EI en août 2014, que cette décision conduirait probablement à une riposte de l’EI.
Justement, vous montrez que l’escalade n’était pas une fatalité, mais que les logiques mimétiques l’ont souvent emporté. Pourquoi ?
Girard pensait que le mimétisme est inscrit dans la nature humaine. C’est une des raisons pour lesquelles il s’est enthousiasmé, à la fin de sa vie, pour la théorie biologique des « neurones miroirs ». Il a vu dans cette théorie une confirmation de ses intuitions. Mon approche socio-historique repose sur la notion de construction sociale de la réalité. À travers leurs discours et leurs pratiques, les acteurs sociaux produisent des normes et des représentations qui les poussent, ou non, à vouloir répondre à la violence par la violence. Comme toutes les constructions sociales, celle documentée dans mon livre, à savoir l’escalade des violences « terroristes » et contre-« terroristes », n’était pas nécessaire. D’ailleurs, les retraits d’Irak, d’Afghanistan et du Sahel ont produit une désescalade à partir de 2020. Au cours des deux décennies précédentes, les logiques mimétiques l’ont emporté car des acteurs puissants (responsables officiels, experts, journalistes…) ont nié le caractère relationnel des deux violences. Ils ne l’ont pas fait de mauvaise foi, mais pour des raisons qui prenaient sens dans leurs champs sociaux respectifs.
Comment traitez-vous cela dans l’ouvrage ?
Dans la deuxième partie de mon ouvrage, je documente quatre formes prises par cette négation. J’ai déjà évoqué la première : la représentation de l’autre comme un être radicalement autre (« mécréant » ou « fanatique »). La deuxième dimension est la simulation de la réalité au sens de Baudrillard(12). Les partisans de la « guerre globale contre le terrorisme » et du djihad armé ont construit des imaginaires où, pour paraphraser Baudrillard, leur propre guerre n’avait pas lieu.(13) Ce fut le cas, dans les médias et les réseaux sociaux, quand les « frappes chirurgicales » ont répondu aux « attaques martyres » et inversement. Ces euphémisations symétriques de la violence portent les germes de la rivalité mimétique, car elles incitent leurs publics à ne percevoir qu’une seule violence digne de ce nom : celle de l’Autre.
La troisième dimension est le temps. Girard remarque que la vengeance est souvent « différée ». Quand elle saute une génération, comme dans certaines vendettas ou dans les relations franco-allemandes entre 1870 et 1939, les enfants des anciens bourreaux ont de bonnes raisons de se percevoir comme innocents : ils le sont. Si les djihadistes ont souvent pratiqué la vengeance différée contre les descendants des « croisés », les partisans de la guerre contre le « terrorisme » ont eu une attitude inversement symétrique : ils ont pratiqué la violence par anticipation dans le cadre des guerres préventives et, à l’échelle tactique, dans les frappes dites de « signature » (signature strikes), lesquelles ne sont pas dirigées contre des personnes identifiées comme combattantes ou « terroristes » mais contre des personnes qu’on soupçonne de pouvoir commettre, à l’avenir, des actions combattantes ou « terroristes ». La frappe aérienne française qui a tué 19 civils dans le village de Bounty au Mali le 3 janvier 2021 illustre cette tendance, qu’on trouve également dans les justifications publiques de la torture, consistant à utiliser la violence pour empêcher une violence future. Les bourreaux du futur étant aussi innocents dans le présent que les enfants des bourreaux d’hier, ces bourreaux présumés se sentent victimes d’une agression et peuvent être tentés, à leur tour, de répondre par la violence à la violence. Cette symétrie inversée des rapports au temps a, accessoirement, contribué à la représentation de l’autre comme un être radicalement autre, car vivant dans le Moyen-Âge ou utilisant des technologies modernes impies.
La quatrième dimension de la rivalité mimétique est le droit. Girard dirait certainement qu’un système pénal international reconnu comme légitime par toutes les parties aurait pu empêcher cette escalade. Cela aurait vraisemblablement été le cas, par exemple, si les dirigeants d’al-Qaïda et le président Bill Clinton avaient été jugés respectivement pour les attentats contre les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie, et pour les bombardements en Afghanistan et au Soudan, en août1998. En l’absence d’un tel système, le droit a produit du mimétisme, car les uns et les autres se sont mutuellement représentés comme des criminels. Leur potestas – leur force légale – a ainsi pu répondre à la violentia – la violence criminelle – de l’Autre.
Quelle a été votre méthodologie de travail ?
J’ai étudié la construction sociale de la rivalité mimétique dans quatre champs sociaux : politique, journalistique, militaire et judiciaire. Je montre qu’ils ont fonctionné de manière autonome, ce qui est conforme à la théorie bourdieusienne des champs sociaux, tout en étant structurés par des logiques mimétiques très semblables. Je donne l’exemple de la couverture médiatique, par le journal Le Monde, de la relation entre la France et l’organisation État Islamique. Avant les attentats de 2015, de nombreux articles du quotidien soulignent le caractère relationnel des violences « terroristes » et contre-« terroristes ». Le Monde a par exemple ouvert ses colonnes à Dominique de Villepin, qui met en garde les autorités françaises contre le risque d’un engagement contre l’EI en Irak : « Aller faire la guerre contre cette région meurtrie, frappée par les crises identitaires (...), c’est prendre le risque de cristalliser et de coaliser un certain nombre de forces (...) contre nous »(14). Le discours change après 2015, et on peut lire dans les articles publiés par Le Monde que la France a été agressée et qu’elle n’a pour ainsi dire d’autre choix que de riposter.
La négation du caractère relationnel de la violence culmine après l’assassinat du père Hamel le 26 juillet 2016. Un éditorialiste du Monde écrit : « Nous ne sommes pas visés au hasard, mais pour ce que nous sommes. Nous ne sommes pas frappés pour notre appartenance à la coalition qui combat l’EI en Irak et en Syrie : la France ne l’a rejointe qu’après avoir été attaquée »(15). La dernière phrase de cet extrait – « la France n’a rejoint [la coalition qui combat l’EI] qu’après avoir été attaquée » – était factuellement fausse. L’EI a perpétré sa première attaque contre un Français, l’alpiniste Hervé Gourdel, le 23 septembre 2014, c’est-à-dire quatre jours après le déclenchement de la guerre aérienne française. Il est intéressant de remarquer que François Hollande s’est, lui-aussi, embourbé dans les dates lors de son témoignage au procès des complices des attentats de novembre 2015(16). Je n’interprète pas l’éditorial du Monde et l’affirmation de François Hollande comme des discours de propagande, mais comme des signes de la puissance des imaginaires qu’ils ont produits dans leurs champs sociaux respectifs. Dans les univers symboliques de la « guerre globale contre le terrorisme », comme d’ailleurs dans celui du djihad armé, la communauté (libérale ou islamique) a été agressée. Cette prémisse prime sur toutes les chronologies.
J’ai procédé de la même manière pour chaque champ social : j’ai analysé les discours et les pratiques signifiantes. Je pense par exemple, côté djihadiste, à la pratique qui consiste à exécuter un prisonnier vêtu d’une combinaison orange. Ce rituel macabre exprime l’idée selon laquelle la violence djihadiste est une réponse à une violence première : celle des « mécréants » sadiques qui ont torturé et humilié de « bons » musulmans dans les prisons de Guantanamo et d’Abu Ghraib. Les responsables politiques et militaires des pays de l’OTAN performent, eux aussi, des rituels qui racontent de telles histoires. Ils commémorent par exemple chaque année les attentats perpétrés à New York le 11 septembre 2001. La cérémonie se déroule au siège du commandement intégré de l’OTAN à Bruxelles devant un mémorial constitué par des débris des tours jumelles. Le mémorial s’intitule « Article 5 ». Il fait référence au célèbre article du traité fondateur de l’OTAN qui énonce qu’« une attaque armée contre l’une ou plusieurs d’entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties ». Cet article n’a été activé qu’une fois : au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. À l’OTAN, ces attentats sont interprétées comme le point de départ de la guerre globale contre le « terrorisme » car, dans l’imaginaire construit par cette organisation, les frappes aériennes sur l’Afghanistan et le Soudan en 1998 ne constituent pas des actes de guerre.
Même si j’étudie les deux violences (contre-« terroriste » et « terroriste »), je consacre beaucoup plus de pages à la première qu’à la seconde. Cela rend justice au fait que le contre-« terrorisme » guerrier, notamment son volet états-unien, fait beaucoup plus de morts innocentes que le « terrorisme ». Pour la guerre d’Irak de 2003-2005, les estimations vont par exemple de 40 000 à 600 000 victimes civiles selon qu’on compte les morts directes ou indirectes(17). Le « terrorisme » peut être très violent, comme à New York en 2001 ou à Paris en 2015, mais on n’est pas dans ces ordres de grandeur. Cette asymétrie de traitement de ces deux violences dans mon ouvrage reflète aussi une contrainte pratique : j’ai pu réaliser une enquête sur archives et par entretiens dans les champs militaires états-uniens et français, mais pas auprès des djihadistes. Je me suis appuyé, en ce qui les concerne, sur les travaux de spécialistes comme Jean-Pierre Filiu et sur les enquêtes de journalistes embarqués dans ces organisations.
Vous écrivez dans la conclusion de l’ouvrage que la rivalité mimétique l’a souvent emporté sur la réflexion stratégique. Que voulez-vous dire par là ?
La réflexion stratégique, qu’il ne faut pas confondre avec le champ peu réflexif des études stratégiques, consiste à s’interroger sur le meilleur moyen de parvenir à son objectif. Cela implique de comprendre les motifs de l’adversaire. On réalise alors automatiquement, pour reprendre une formule de René Girard, que « l’agression n’existe pas. (…) L’agresseur a toujours déjà été agressé »(18). La réflexion stratégique constitue donc un antidote puissant à la rivalité mimétique. Elle peut aider à sortir du cercle vicieux de la vengeance comme dans le cas, évoqué plus haut, de l’Espagne en 2004. Elle peut aussi conduire à poursuivre la guerre tout en la maintenant dans un régime de limites. Chaque année, le président des États-Unis reçoit un document intitulé « National Intelligence Estimate » qui synthétise les rapports annuels des différents services de renseignement. Celui de 2006 observait que le bombardement et l’invasion de l’Afghanistan et de l’Irak ont engendré une multiplication des vocations terroristes. Les auteurs de ce document y prescrivaient de faire preuve de davantage de discernement dans l’usage de la force. Cela a permis une courte désescalade jusqu’à l’intensification des frappes de drones au tournant des années 2000 et 2010. À l’heure où les bruits de bottes deviennent assourdissants, ce livre peut aussi être lu comme un appel à la réflexion sur le caractère souvent contre-productif de l’usage de la violence pour arrêter celle-ci.
Propos recueillis par Miriam Périer, CERI.
illustration : Oeuvre sans titre de Felix Del Marle. Domaine public.
Notes
- 1.Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962, p. 176.
- 2.Isabelle Sommier, Le Terrorisme, Paris, Flammarion, 2000
- 3.Anonyme, Working Group Report on Detainee Interrogations in the Global War on Terrorism, Torture documents (The Rendition Project), 4 avril 2003, p. 65.
- 4.Rebecca Mihnot-Mahdavi, Drones and International Law. A Techno-Legal Machinery, Cambridge, Cambridge University Press, 2023.
- 5.Simon Collard-Wexler, Costantino Pischedda et Michael G. Smith, "Do Foreign Occupations Cause Suicide Attacks?", Journal of Conflict Resolution, 58(4), 2013, pp. 625-657.
- 6.René Girard, La violence et le sacré, Paris, Grasset, p. 463.
- 7.René Girard, La violence et le sacré, op. cit., p. 216.
- 8.Valérie Rosoux, Les usages de la mémoire dans les relations internationales : le recours au passé dans la politique étrangère de la France à l'égard de l'Allemagne et de l'Algérie de 1962 à nos jours, Bruxelles, Edition Bruylant, 2002
- 9.Germaine Tillon, Ennemis complémentaires. Guerre d’Algérie, Editions Tiresias, 2005.
- 10.“Beheaded man's father: Revenge breeds revenge”, cnn.com, 9 juin 2006, voir https://edition.cnn.com/2006/WORLD/meast/06/08/berg.interview/ . Consulté le 17 octobre 2023.
- 11.Alain Chouet, « Al Qaida, Commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées du Sénat », Conférence du 29 janvier 2010, http://videos.senat.fr/video.22174_57b70c17f0a5f.le-moyen-orient-a-l-heure-nucleaire?timecode=4809000 (consulté le 12 mars 2020). La séquence se trouve ici : 19’50’’
- 12.Jean Baudrillard, Simulacre et simulation, Paris, Editions Galilée, 1981.
- 13.Jean Baudrillard, La guerre du Golfe n'a pas eu lieu, Paris, Editions Galilée, 1991.
- 14.« Villepin », LeMonde.fr, 12 septembre 2014
- 15.Jérôme Fenoglio, « Éditorial : Attaque de Saint-Etienne-du-Rouvray : Résister à la stratégie de la haine », Le Monde, 28 juillet 2016. Notons que Le Monde a édité la version électronique de cet éditorial après que le site Arrêt sur image a relevé l’inversion de la chronologie.
- 16.Emmanuel Carrère, V13. Chronique judiciaire, Paris, P.O.L, 2022, pp 127-128
- 17.Gilbert Burnham, Riyahd Lafta, Shannon Doocy et Les Roberts, "Mortality after the 2003 invasion of Iraq: a cross-sectional cluster sample survey", Lancet, 368, 2006, pp. 1421-28
- 18.René Girard, Achever Clausewitz, Paris, Carnets Nord, p. 53.
Suivez-nous
Nous contacter
Contact Média
Coralie Meyer
Tel: +33 (0)1 58 71 70 85
coralie.meyer@sciencespo.fr
Corinne Deloy
Tel: +33 (0)1 58 71 70 68
corinne.deloy@sciencespo.fr