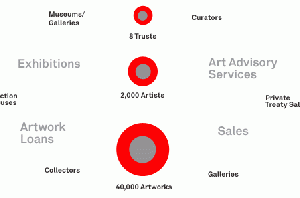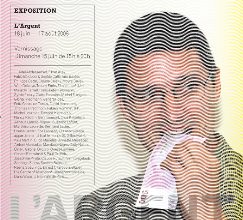Faire se rencontrer un acteur du monde de l’art et un économiste spécialisé répond aux règles fixées pour notre séminaire cette année. Simon Njami est bien connu pour ses textes et ses expositions — nous lui devons notamment la définition d’un sens de la contemporanéité en Afrique par les Africains eux-mêmes et affranchie des critères occidentaux. Il fait ici une lecture deleuzienne des règles intransigeantes du marché de l’art international.
L’économiste Philippe Petit lui répond qu’il en va de l’art comme du reste, à cette réserve près que le monde économique — même s’il le voulait — ne peut tout domestiquer. Il rappelle que la communauté des économistes a bien du mal à définir ce qu’est un marché et comment s’y forment les valeurs : l’objet d’art lui semble y tenir une place singulière, ne serait-ce que parce que la valeur qui lui est assignée dépasse de loin sa simple financiarisation. L’œuvre d’art serait alors, selon lui, une sorte de rempart symbolique fondé sur une dimension empathique et ouverte aux problèmes d’autrui qui la rendrait propice à une appropriation citoyenne.
Laurence Bertrand Dorléac
Séminaire du 1er octobre 2009
Le principe
et la réalité
Simon Njami
L’établissement de la valeur d’une œuvre, avant que l’artiste qui l’a produite n’entre dans le circuit commercial et ne devienne l’objet de la loi de l’offre et de la demande, ne correspond à aucune règle économique. Il s’agirait, en cette occurrence, plutôt d’un concours de circonstances qui conduit à l’élection de tel ou tel. Car, en fait, il ne s’agit pas tant d’élire une œuvre que d’admettre un artiste dans le cercle très fermé du marché de l’art. L’art contemporain obéit néanmoins à un certain nombre de règles qui sont comme autant d’étagements, pour reprendre l’expression deleuzienne, et de surfaces de contact. Dans ce dispositif, une succession d’événements concourent à l’établissement et à la confirmation d’une valeur qui, quel que soit le mode de consécration choisi, demeurera un principe aléatoire, tant que l’onction historique ne sera pas passée par là. Les biennales et les grandes expositions, les musées, les critiques et commissaires, dans un second temps les foires et les galeries, constituent le cadre de cette transsubstantiation d’un nouveau type.
Au début de l’humanité, l’art est humble dans sa démarche. Il ne s’analyse pas et ne se détache pas du geste premier. Il n’est pas l’objet de commentaires savants, puisqu’il est une expression naturelle, quotidienne, qui participe de la définition même de l’humanité. Peindre est un geste aussi essentiel que boire et manger. Cela ne se questionne pas. Les hommes n’entendent pas se confronter au Grand Architecte mais souhaitent lui donner la place qui, pensent-ils, lui revient. L’art est collectif, anonyme. Le geste est plus fort que son résultat. Puis vient le moment où, en impudent Prométhée, en Eve avide de connaissances, l’homme se rebelle et entend maîtriser lui-même sa propre destinée. Chassée du jardin d’Eden, ou condamné à se faire dévorer le foie pour l’éternité, l’homme tombe dans le piège qui condamna Narcisse. Il se croit tout puissant. Et le résultat de cette transformation est que l’artiste se met à signer « son » œuvre, substituant par là le nom au geste. Certains ont même vu dans le fait artistique « la célébration de la mort du Dieu ». En effet, qu’aurait-on à faire désormais d’un créateur dont on est devenu l’égal ? Ne dit-on pas d’un artiste qu’il est un « créateur » ?
Résumons-nous : l’individuation de l’artiste et l’incarnation de l’œuvre constituent la première étape de l’établissement d’un étalonnage arbitraire comme règle universelle. Et la complexité, ou pour employer un terme à la mode, l’illisibilité du marché de l’art contemporain, n’est sans doute que la conséquence lointaine d’une faute originelle. À la naissance de l’art se trouvait une démarche ontologique qui est aujourd’hui remplacée par des concepts d’une aridité décourageante. Dans l’ère contemporaine, le langage, qui selon Henri Delacroix « transforme le monde chaotique de sensations en formes et représentations » privilégie la représentation au détriment parfois de la forme. Toute représentation n’étant qu’une projection subjective, les interprétations qui en résultent ne sauraient avoir de valeur « scientifique ». Le monde contemporain a néanmoins créé un schisme entre le créateur et ses exégètes, provoquant une série de malentendus parfois risibles. Comme nous le rappelle Sartre : « L’image (…) c’est une certaine façon qu’a l’objet de paraître à la conscience, ou, si l’on préfère, une certaine façon qu’a la conscience de se donner un objet. »[ref]Jean-Paul Sartre, L’imagination, Paris, PUF, 1949.[/ref] Ce qui était produit par nos lointains ancêtres dans les grottes pariétales était bien de l’art, mais il semblerait qu’aujourd’hui, sans la glose qui représente la valeur ajoutée d’une œuvre ou d’un artiste, il n’y est de place pour rien. Ce dont je parle ici, que ce soit bien clair, ne s’applique qu’au marché international de l’art. Il est évident qu’en dehors de ce cercle très fermé, d’autres pratiques fleurissent. Mais ce serait l’objet d’un tout autre débat.
Je l’ai dit, je n’aborderai pas ici la question du goût et de la qualité, que nous pourrions appeler « valeur esthétique », mais je me concentrerai sur l’autre valeur. Car il n’existe pas d’universalité du goût, et même Kant ne me contredirait pas sur ce point. En revanche, il existe ce que je nommerai « consensus » ou « convention », qui détermine une valeur « sociale » de l’œuvre, qui, bien souvent, n’a pas de relation avec sa valeur esthétique. Dans les tous cas, les processus mis en œuvre dans ces deux « révélations » n’obéissent pas aux mêmes critères ou règles et peuvent parfois s’avérer contradictoires.

Citroën Picasso (détail).
Nous sommes contraints d’analyser le marché de l’art soit comme un phénomène (Husserl), soit comme un événement (Deleuze), tout en sachant que la frontière entre les deux est parfois floue, puisque, comme vous le savez, Deleuze s’est beaucoup servi de Husserl. Ce qui m’intéresse dans ce système, c’est le fait que, comme l’écrit Paul Ricœur : « Au fond, la phénoménologie est née dès que, mettant entre parenthèses – provisoirement ou définitivement – la question de l’être, on traite comme un problème autonome la manière d’apparaître des choses.[ref]Paul Ricœur, Esprit, déc. 1953.[/ref] » En mettant l’être entre parenthèse, nous ne sommes pas brouillés par des a priori ou des souvenirs. Si je vous dis Picasso, vous ne m’entendrez pas de la même manière qui si je vous disais un « peintre espagnol ». Parce que le nom même de Picasso représente à lui seul une histoire que vous seriez contraints de ne pas ignorer. C’est d’ailleurs l’un des maux dont souffre l’art, et en particulier l’art contemporain. Tout se déroule en vase clos dans ce milieu et les tempêtes qui y surviennent parfois, et qui semblent annoncer la fin du monde, sont, au regard de la « vraie vie », beaucoup de bruit pour rien.
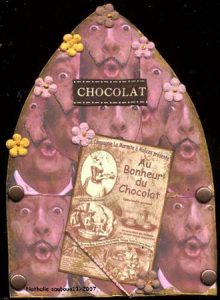
Publicité pour le chocolat Lanvin par Salvador Dali.
L’art, je veux encore une fois parler de celui qui se vend entre Miami et Londres, dans les foires prestigieuses, même s’il représente parfois des enjeux considérables, n’est pas un phénomène populaire. Cela ne représente pas un sujet très sexy. Si je parle de Damien Hirst à ma boulangère, elle me regardera avec des yeux ronds. L’aura de l’artiste contemporain n’a rien à voir avec celle d’un comédien, d’un chanteur, d’un sportif… ce qui lui confère d’emblée une position particulière qui ne peut être appréciée que par une certaine élite. Malgré l’individuation et les phénomènes d’engouement sporadique qui traversent la communauté artistique, seuls quelques rares noms sont parvenus à sortir du champ clos du milieu de l’art : Picasso en son temps, bien entendu, qui, après Dali vantant le chocolat Lanvin prête post-mortem son nom à une automobile, Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, et peut-être Cristo.

Jean-Michel Basquiat posant devant une de ses oeuvres.
Je voudrais prendre Jean-Michel Basquiat comme cas pratique, car sa carrière illustre assez bien, à mon sens, tout l’aléatoire, le glamour et la communication qui sont liés à l’art contemporain depuis la fin des années soixante-dix. Basquiat, Haïtien d’origine, commence sa carrière dans le métro de New York et est bientôt identifié par l’underground new-yorkais. Sa signature, SAMO, se met à fonctionner comme une marque de fabrique. Des galeristes sentent la bonne affaire : le garçon noir, parle français, a des attitudes de dandy et l‘expression qui est la sienne colle à son époque. À partir de là, la machine est lancée. Expositions collectives, biennale de Whitney, jusqu’à la mythique Documenta 7 qui va faire éclore trois gamins, Keith Haring, Miquel Barcelo, Jean-Michel Basquiat. Signes des temps et des mœurs de l’époque, seul Barcelo a survécu aux folles années quatre-vingt. Le milieu de l’art avait besoin de sang neuf. Il lui est servi sur un plateau. Les prix de Basquiat s’envolent d’autant plus aisément que le jeune homme affiche un détachement rafraîchissant, se moque des critiques et du monde qui l’a fait roi. L’apothéose, et j’emploie ce mot sans aucun cynisme, c’est sa mort en 1988 d’une overdose, à l’âge de vingt-huit ans.
Mais que l’on m’entende bien. Le marché de l’art n’a pas la puissance de produire des Basquiat au kilomètre. Encore faut-il que l’élu soit capable d’endosser son costume de héros. Son œuvre, comme nous le rappelle Deleuze, ne signifie rien dans la solitude de l’atelier : « Les signes restent dépourvus de sens tant qu’ils n’entrent pas dans l’organisation de surface qui assure la résonance entre deux séries (deux images-signes, deux séries ou deux pistes, etc.). »[ref]Gilles Deleuze, Logique du sens, Paris, Minuit, 1969.[/ref] Il faut donc, pour que l’œuvre puisse acquérir une valeur marchande, qu’elle soit l’objet d’un consensus entre tous les acteurs de l’opération. Il suffirait qu’un seul d’entre eux fasse défaut pour que le miracle ne puisse pas advenir. L’artiste et son œuvre n’auraient plus dès lors, qu’à miser sur l’onction historique qui les inscrira dans les livres d’histoire. Ainsi Van Gogh, dont les œuvres devaient atteindre des records dans les ventes aux enchères longtemps après sa mort, ne bénéficia-t-il pas d’un consensus capable de la faire apprécier de son vivant. Le « monde du sens » développé par l’artiste, pour qu’il soit accessible à tous en même temps doit obéir à un certain nombre de critères : « Non seulement parce qu’il survole les dimensions selon lesquelles il s’ordonnera de manière à acquérir signification, manifestation et désignation ; mais parce qu’il survole les actualisations de son énergie comme énergie potentielle, c’est-à-dire l’effectuation de ses événements qui peut être aussi bien intérieure qu’extérieure, collective et individuelle, d’après la surface de contact ou la limite superficielle neutre qui transcende les distances et assure la continuité entre ses faces. »[ref]Gilles Deleuze, Logique du sens, Paris, Minuit, 1969.[/ref]
Il se saurait donc y avoir de valeur reconnue sans une adéquation parfaite entre la production et sa « surface de contact ». Ceci vaut aussi bien pour le marché que nous avons tenté de décrire que pour les autres marchés parallèles dont le caractère souvent social, engagé, politique, ne franchit pas nécessairement les barrières de la reconnaissance internationale. Mais ce monde-là, au sein duquel s’expérimente les expressions de demain (comme Basquiat en son temps avec le graffiti), est le vivier sans lequel, le grand marché n’aurait aucun avenir. Il représente le vivier dans lequel, de temps à autre, vont puiser les prescripteurs pour apporter de la nouveauté à un principe de consommation qui est prompt à brûler demain ce qu’il a adoré la veille. Il s’est trouvé des artistes contraints à se reproduire à l’envi, piégés par leur soudaine célébrité. Ce n’est que justice, et que l’on me pardonne cet accent moralisateur, si les autres, qui vivent encore à l’ombre du Grand Marché, ont conservé toute la liberté de créer, sans avoir de comptes à rendre personne.
Simon Njami est écrivain, critique et commissaire d’expositions, co-fondateur et directeur de publication de la Revue Noire, Visiting Professor à l’Université de San Diego. Il a organisé de nombreuses expositions dont : Paris Connection, Paris/San Francisco, 1991; L’Afrique par elle-même, photographies (co-commissaire), Paris, Sao Paulo, Londres, Bamako, Washington, Berlin, Cape Town, 1998/1999; Les Rencontres africaines de la Photographie, Bamako, à partir de 2001; Africa Remix, Düsseldorf, Londres, Paris, Tokyo, Stockholm, Johannesburg, 2004/2007; Un prisme lucide – photographies, Biennale de Sao Paulo, 2004; premier Pavillon africain à la 52e Biennale de Venise (Co-commissaire), 2007; As you like it, First african contemporary art fair, Johannesburg, 2008.
Il est également l’auteur de textes publiés dans les catalogues d’exposition et de bien d’autres, parmi lesquels : “L’invention de la vie”, in : Peut-on être vivant en Afrique, Presses Universitaires de France, 2000; Remembrance of things Past, Ten years of debate about African Contemporary Art, Tobu Museum of Art, 1998; Antholoy of XXth Century African Art (Co-éditeur et co-auteur), Revue Noire, 2001, DAP, Paris New York, 2002; L’Afrique en regards (éditeur); Une brève histoire de la photographie, Filigranes, 2005. Il est aussi l’auteur de nouvelles, de romans et d’essais, parmi lesquels : Cercueil et Cie, Lieu Commun, 1985; Les Enfants de la Cité, Gallimard, 1987; African Gigolo, Seghers, 1989; Les Clandestins, Gallimard, Paris, 1989; James Baldwin ou le devoir de violence, Seghers, Paris, 1991; C’était Senghor, Fayard, 2006; Panthéon noir, Mengès, 2010.