
Jean Rouch a découvert les rituels de possession des populations songhay du Niger quand il était ingénieur des Travaux publics des colonies avant de renoncer à ce métier pour se consacrer à la recherche. Il commence à filmer pour documenter les cérémonies où les choses sont des « activateurs d’affects » à but curatif. Clara Pacquet relève des correspondances entre son cinéma, où les humains deviennent choses et les choses créatures, et la littérature en Europe (Perec, Robbe-Grillet, Foucault, Barthes ou Baudrillard) confrontée au déferlement des objets produits en série par les machines.
Laurence Bertrand Dorléac
Animisme et modernité.
Jean Rouch
et les choses
Clara Pacquet
« Je fais mes films comme on dessinerait un pont[ref]Jean Rouch en 1992 dans un entretien avec Pierre-André Boutang : Jean Rouch raconte à Pierre-André Boutang, 2004.[/ref]. »
Jean Rouch, 1992
C’est comme ingénieur des Travaux publics des colonies que Jean Rouch se rend pour la première fois en 1941 en Afrique sub-saharienne. Imprégné de l’univers surréaliste, il a déjà suivi des cours d’ethnographie au musée de l’Homme. Dans la lignée de dada, les surréalistes s’intéressent aux pouvoirs magiques et spirituels d’objets liés à des danses, des rituels ou des croyances, et initient un nouveau rapport aux signes et aux objets. Un rapport plus dynamique, plus ouvert, plus incertain aussi, et perméable aux manifestations du désordre.
Un gai savoir

Fig. 1 : Jean Rouch, Initiation à la danse des possédés, 1949. Couleur, 16 mm, 22 min. Photogrammes ©CNRS/CFE/Jocelyne Rouch
À la marge de la direction des chantiers, Rouch découvre les rituels de possession des populations songhay du Niger. Il rassemble des observations et publie en 1943 un premier article « Aperçu sur l’animisme songhay » dans la revue Notes africaines[ref]« Aperçu sur l’animisme songhay », Notes Africaines, Dakar, 1943, p. 4-8.[/ref]. Renonçant à son activité d’ingénieur, Rouch s’inscrit en thèse à la Sorbonne avec Marcel Griaule sur le thème du génie de l’eau chez les Songhay. Il réalise de nombreuses missions et comprend très vite que le médium du cinéma va devenir indispensable pour documenter les cérémonies. Pour l’anthropologue, la caméra va devenir un objet quasi-magique, analogue à un organe, en référence au ciné-œil de Vertov. En 1949, Rouch présente Initiation à la danse des possédés au musée de l’Homme. Ce film montre une cérémonie de guérison : une jeune femme possédée de manière intempestive par deux génies doit apprendre, grâce à la danse, à contrôler – c’est-à-dire à chevaucher – ces génies et devenir possédée seulement à la demande des prêtres. La voix-off, Rouch lui-même, décrit tantôt les actions des protagonistes du rituel afin de faciliter la compréhension pour le regardeur, tantôt formule des hypothèses interprétatives, ainsi de cette remarque suggérant un parallèle entre les spectateurs du rituel dans le film et les spectateurs du film dans la salle : « et dans ces danses, ce sont souvent les spectateurs qui jouent le rôle d’acteur ». Le film est présenté au Festival du film maudit où il reçoit un prix. Les artistes et les cinéastes rassemblés à Biarritz sont saisis : enthousiasmés au sens dionysiaque du terme, interpellés par une forme inédite de gai savoir.
Possession et migration

Fig. 2 : Jean Rouch, Les maîtres fous, 1954-57. Premier prix des films ethnographiques, géographiques, touristiques et folkloriques au Festival international de Venise en 1957. Couleur, 16 mm, 28 min. Photogrammes ©Les Films du Jeudi / Les Films de la Pléiade. On peut voir l’analogie opérée par Rouch entre les états de transe et l’exercice du pouvoir colonial.
Le succès de Rouch auprès des héritiers du surréalisme est décisif pour la suite. En 1950 à Paris, alors qu’il s’intéresse au théâtre de la cruauté d’Artaud[ref]Voir le texte de Rouch « L’Autre et le Sacré : jeu sacré, jeu politique », Jean Rouch : cinéma et anthropologie, Paris, Cahiers du cinéma, 2009, p. 30.[/ref], Rouch découvre des similitudes criantes entre les techniques corporelles prônées par son aîné et les passages à la transe qu’il a pu observer lors de rituels de possessions songhay. La cruauté implique l’usage d’objets pour atteindre un degré d’intensité du corps. Accessoires, costumes, instruments lors de rituels, danses et cérémonies, mais aussi inversion des rôles entre entités animées et entités inanimées, les choses impliquées deviennent des activateurs d’affects dont la fonction se révèle curative. Une cure souvent liée à une pratique de la représentation relevant de l’exagération et de la moquerie jusqu’à la caricature. Tourné en 1954 et rendu public en 1957, le film Les Maîtres fous s’inscrit dans cette fascination pour la possession dont Rouch explore la nature thérapeutique. Car le possédé n’est pas fou, il maîtrise cet état grâce à des techniques réclamant un apprentissage. Rouch présente le culte de possession des Haouka, au cours duquel les initiés incarnent de manière grotesque les symboles du colonialisme par l’invocation de dieux nouveaux ; ceux de la technique, de la ville, de la force. Les adeptes de ce culte sont des immigrés nigériens songhay vivant à Accra, la capitale du Gold Coast. Majoritairement en bas de l’échelle sociale, ils sont forcés de trouver des méthodes d’adaptation et d’intégration. Lors des cérémonies, les individus possédés sont transformés, par l’état de transe, en caricatures symboliques de personnalités britanniques du pouvoir colonial. Selon Rouch, ce culte est l’expression africaine de l’Occident.
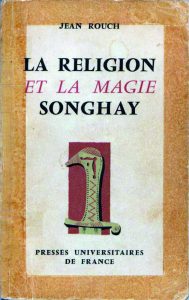
Fig. 3 : Jean Rouch, La Religion et la magie Songhay, Paris, PUF, 1960. Couverture du livre réalisé à partir de sa thèse d’État principale ©Jocelyne Rouch
Le titre du film est un calembour, car ce sont les maîtres britanniques qui sont fous. D’abord projeté en 1955 au musée de l’Homme dans un premier montage sans son et accompagné d’un commentaire de Rouch improvisé en direct dans la cabine de projection, le film sera commercialisé. S’il a été violemment rejeté par les ethnologues présents à la projection au musée, jugé « intolérable » ou « raciste », il rencontre un vrai succès auprès d’un public de non spécialistes et remporte le Grand Prix de la Biennale de Venise en 1957. Il révolutionne en outre l’approche ethnographique des rituels. Le fait que les participants au culte Haouka sont des migrants est essentiel. On ne saurait comprendre ces cérémonies en dehors du phénomène migratoire, et c’est justement cet aspect qui intéresse Rouch : l’adaptation, le mélange, la fusion des génies ancestraux et des génies modernes, rompant avec une démarche essentialiste dans l’abord des cultures sous le concept de « tradition », rompant également avec une vision hermétique des rapports entre le soi et l’autre.
Entre les continents
Lorsqu’il réalise Les Maîtres fous, Rouch observe les Songhay depuis son premier séjour au Niger en 1941. Ces derniers se réfèrent simultanément à des religions diverses : culte des ancêtres, culte des génies du lieux (Zin), culte de divinités cosmologiques (Holey) et Islam. Rouch ambitionne de comprendre comment ces systèmes s’imbriquent les uns dans les autres et souhaite en retour modifier le regard que les Européens portent sur l’Afrique et sur eux-mêmes.

Fig. 4 : Jean Rouch et Edgar Morin, Chronique d‘un été, 1960-61. Noir et blanc, 16 mm, 86 min. Prix de la Critique internationale au Festival de Cannes en 1961. Photogrammes ©Argos Films
Chronique d’un été, film culte réalisé à quatre mains en 1960-1961 avec Edgar Morin, est exemplaire de ce mouvement de va-et-vient entre les continents. Avec ce film, Rouch – sur une idée de Morin qui lui demande pourquoi il n’est jamais venu étudier la « tribu » parisienne – continue son opération de transvasement d’une culture dans l’autre. L’impact est très fort, car l’expérience est réalisée en Europe, avec des acteurs qui ressemblent au public européen. Il est frappant de remarquer des similitudes entre Chronique d’un été et le roman de Georges Perec Les Choses. Une histoire des années 1960. Quatre ans séparent la sortie du film et la parution du livre, et le couple imaginé par Perec semble tout droit sorti du documentaire de Rouch et Morin. Les doutes de toute une génération, allant de la guerre d’Algérie jusqu’à son rapport aux choses et au quotidien, sont abordés. Avec, en sourdine, cette interrogation : le rapport des hommes aux choses dans les sociétés contemporaines industrialisées est-il dénué de sens ? Une différence abyssale sépare l’usage des objets dans les rituels songhay et la relation des Européens aux choses à l’heure d’une société industrialisée réglée par une économie de marché. Bien qu’à un rythme moindre qu’en Occident, l’Afrique des années 1950 connaît cependant le capitalisme importé par les colonisateurs, tout comme elle connaît l’introduction de la machine dans les affaires humaines. Ce qui intéresse Rouch, c’est la manière dont les peuples africains qu’il a pu observer procèdent sans cesse à des synthèses insoupçonnables pour un œil et un esprit européens.

Fig. 5 : Jean Rouch, Les Veuves de quinze ans (Marie-France et Véronique) in La fleur de l’âge ou les adolescentes, 1963-64. Noir et blanc, 35 mm, 25 min. Photogrammes. ©Les Films du Jeudi / Les Films de la Pléiade. Dans ce court-métrage dédié à l’adolescence, Rouch oscille entre la représentation d’un désir féminin libre et l’image de la femme-objet. Il alterne par exemple la mise en scène d’une sorte de primitivité « tribale » mêlant des sources ethnographiques plus ou moins imaginaires avec de la musique jazz avec celle d’une séance de photographie de mode, le corps féminin devenu ici objet des convoitises masculines et publicitaires.
La secte des Haouka et le culte qu’ils vouent aux génies de la technique et de la colonisation sont exemplaires de ces adaptions ou réaménagements constants de ce que les anthropologues contemporains de Rouch ont peut-être trop rapidement baptisé « la tradition ». Le rapport aux « ancêtres » est en perpétuel mouvement, poreux aux changements apportés par la modernité et c’est exactement en cet endroit que Rouch reconnaît la force du continent africain, et même son « extrême » modernité[ref]D’aucuns diront ultérieurement « postmodernité » car pareilles pratiques du mélange peuvent être interprétées comme le symptôme d’une mise à l’écart de tout paradigme évolutif de l’histoire, ainsi que d’une disparition des grands récits invalidant l’usage de catégories telles que tradition, modernité, progrès etc. À observer les Haouka par exemple, on assiste à une multitude de récits qui, dans un devenir incessant, ne cessent de se recomposer à l’infini, à l’écart de toute pensée de la pureté ou de l’originel. Les rapports mêmes entre copie et original s’en trouvent profondément modifiés.[/ref].
Un goût pour les choses
À la fin des années 1950, Roland Barthes inaugurait avec les Mythologies un regard inédit sur le monde matériel et son impact symbolique sur les sujets. Selon Barthes, un objet parle, c’est un système de signes, tandis que l’ensemble des choses forment un monde, voire une cosmogonie[ref]Voir « Poujade et les intellectuels » ou « Le mythe à droite » in Roland Barthes, Mythologies, Paris, Seuil, 1957, p. 173 et 224.[/ref]. Les mythes modernes incarnés par les accessoires de la vie quotidienne sont porteurs de l’ordre du monde capitaliste, tendant à faire passer pour nature ce qui relève d’une construction idéologique. Le mythe serait une tentative de neutralisation des forces contraires et contrariantes vis-à-vis de cet ordre. Les années 1960 témoignent d’un goût prononcé pour la question. Outre Perec, Robbe-Grillet plaide en 1963 pour un nouveau roman, c’est-à-dire conscient d’une société réifiée où les humains sont devenus des choses parmi d’autres, tandis que Foucault publie en 1966 Les Mots et les choses (dont le titre originairement souhaité par le philosophe était « L’Ordre des choses »). En 1968, c’est au tour de Jean Baudrillard de poursuivre la réflexion avec son ouvrage de sémiotique politique : Le Système des objets : la consommation des signes.

Fig. 6 : Jean Rouch, VW Voyou, 1973. Couleur, 16 mm, 19 min. Photogrammes. ©CNRS/CFE/Jocelyne Rouch
Les films de Rouch et ses recherches sur l’animisme évoluent dans cet environnement. S’ils sont nourris par les questionnements collectifs qui leur sont contemporains – les atrocités de la guerre, la colonisation, capitalisme versus marxisme – ils sont également les initiateurs d’une réflexion autour du monde et de sa représentation, précisément concernant la différence entre le même et l’autre, et le sérieux avec lequel on peut croire en un progrès des civilisations. En affinité avec Barthes qui reconnaît dans la voiture un « objet parfaitement magique[ref]Roland Barthes, « La nouvelle Citroën » in Mythologies, op. cit., p. 140.[/ref] », Rouch s’intéresse à la vie de cette machine dans un contexte non-européen où les plans du matériel et du spirituel sont mêlés[ref]Un questionnement qui cessera pas de germer chez les philosophes, les écrivains et les cinéastes des décennies suivantes. Citons, en cet endroit, la dédicace du livre de Robert Linhart L’Établi (1978) : « à Ali, fils de marabout et manœuvre chez Citroën ». Linhart a travaillé comme OS en usine avant de décrire les conditions de travail des ouvriers et sera une source d’inspiration pour Jean-Luc Godard dans sa série télévisée France/tour/détour/deux/enfants (1978). La voiture Citroën fait quant à elle de multiples apparitions chez Rouch (Cocorico ! Monsieur Poulet, Dionysos), tandis que l’un des protagonistes de Chronique d’un été est ouvrier chez Renault.[/ref].

Fig. 7 : Jean Rouch, Cocorico ! Monsieur Poulet, 1973-74. Couleur, 16 mm, 94 min. Photogrammes ©CNRS/CFE/Jocelyne Rouch
Histoires de migration, les films Jaguar (1967) et Cocorico ! Monsieur Poulet (1974) font de la voiture un protagoniste symbolisant le mariage improbable de la nature et de la technique. Avec Dionysos, film de 1986 et véritable manifeste selon Deleuze[ref]Gilles Deleuze, « Les puissances du faux » in Cinéma 2 – L’image-temps, Paris, Minuit, p. 198.[/ref], les recherches de Rouch atteignent leur point d’acmé. Nietzsche, De Chirico, mythes antiques d’Europe et d’Afrique sont joyeusement fusionnés au sein de cérémonies réelles ou imaginaires, dont le spectre s’étend de la soutenance de thèse aux rites bachiques. Son protagoniste principal, auteur d’une thèse sur « la nécessité du culte de la nature dans les sociétés industrielles », est embauché par une usine de production de voitures. Sa mission : ré-enchanter l’usine !
Semer un désordre fertile

Fig. 8 : Jean Rouch, Dionysos, 1983-86. Couleur, 16 mm, 97 min. Photogrammes.
Ici mise en scène d’un rituel dionysiaque au cœur de l’usine devant la voiture enchanteresse baptisée « la panthère parfumée » ©Les Films du Jeudi / Les Films de la Pléiade
Animé d’une vision dynamique, nietzschéenne du savoir, Rouch s’est toujours méfié des démarches scientifiques organisées selon un mode classificatoire. Sa prédilection pour le concept d’enthousiasme – titre par ailleurs du premier film sonore de l’histoire du cinéma documentaire soviétique signé Vertov en 1930-1931 – va également dans ce sens. Dubitatif, critique vis-à-vis des méthodes de présentation des collections et des philosophies de conservation sous-jacentes, il a reconnu dans le médium du film sonore la possibilité de transmettre la vie des objets dans les musées ethnographiques et de les replacer dans leur contexte[ref]Pour aller plus loin, nous pourrions même avancer que cela permettrait de restituer ces objets à leur société d’origine (un vif débat actuellement que celui de la restitution des objets pillés, volés, appropriés dans le contexte colonial). Plutôt que les objets originaux présentés en vitrine, des projections de rites filmés seraient à la fois plus riches du point de vue de la connaissance et plus juste d’un point de vue moral.[/ref]. Plutôt que de classer, Rouch envisage le film comme une méthode d’animation des objets, mais également comme un outil pour semer un désordre fertile. Son intérêt pour la caricature, le grotesque, l’humour, même raté, et le slapstick, ne se comprend pas tout à fait sans l’associer à ses recherches sur le phénomène migratoire, mais également sur l’oralité, l’improvisation et toute autre forme ouverte de production de sens et de savoir. À regarder comment Rouch filme les hommes et leurs objets, on comprend que les uns et les autres forment un système – un monde – dont on ne saurait les séparer, sachant que les rôles peuvent être inversés, les hommes devenant choses, les choses créatures. Le monde est habité par un chaos, il est traversé de flux et toute entreprise classificatoire peut se révéler dévastatrice. Sans rejeter l’usage des choses produites par les machines, Rouch s’intéresse aux mélanges, aux ruptures, aux interstices et à tout ce qui résiste à une idéologie prédéterminée. Les choses représentent un pont entre la réalité et l’imaginaire, la nature et la technique, le même et l’autre, et ne sauraient se laisser si facilement instrumentaliser par un marché. Mais il faudrait peut-être inventer de nouveaux rituels pour résister.
Bibliographie
Gilles DELEUZE, « Les puissances du faux » in Cinéma 2 – L’image-temps, Paris, Minuit, 1985.
Georges DIDI-HUBERMAN, La Ressemblance informe ou le gai savoir visuel selon Georges Bataille, Paris, Macula, 1995.
Jean-Luc GODARD, « L’Afrique vous parle de la fin et des moyens. Jean Rouch, Moi, un noir », Cahiers du cinéma, n° 94.
Bertrand HELL, Possession et chamanisme. Les maîtres du désordre, Paris, Flammarion, 1999.
Paul HENLEY, The Adventure of the Real. Jean Rouch and the Craft of Ethnographic Cinema, Chicago / London, The University of Chicago Press, 2009.
Marc-Henri PIAULT, « Jean Rouch (1917-2004). La ciné-transe, une pensée fertile », Hermès, La Revue, 2004/2 (n° 39), p. 210-218.
Jean ROUCH, Jean Rouch, La Religion et la magie songhay, Paris, Presses universitaires de France, 1960.
Jean ROUCH, « La caméra et les hommes » [première parution 1973], CinémAction, n° 81, 1996.
Jean Rouch : cinéma et anthropologie, textes réunis par Jean-Paul Colleyn, Paris, Cahiers du cinéma, 2009.
Joram TEN BRINK, Building bridges. The Cinema of Jean Rouch, London / New York, Wallflower Press, 2007.
Clara PACQUET est docteure en philosophie. Elle a soutenu une thèse à l’EHESS sous la direction de Danièle Cohn intitulée Signature et achevé en soi. Esthétique, psychologie et anthropologie dans l’œuvre de Karl Philipp Moritz (1756-1793) parue en 2017 aux presses du réel dans la collection « Œuvres en sociétés ». Outre ses recherches consacrées aux Lumières allemandes, elle s’intéresse aux arts du XXe siècle, notamment dans leur lien à l’anthropologie. Elle a participé comme chercheuse à plusieurs projets de recherche à la frontière entre esthétique et histoire de l’art et collabore régulièrement aux revues L’Objet d’art et Dossier de l’art. Avec Bärbel Küster, elle a coédité la publication en ligne Photographie et oralité. Dialogues à Bamako, Dakar et ailleurs (Stuttgart/Berlin, 2017) rassemblant des interviews filmés d’artistes maliens et sénégalais ainsi que des contributions d’écrivains, d’historiens de l’art, d’anthropologues et de commissaires d’expositions.





