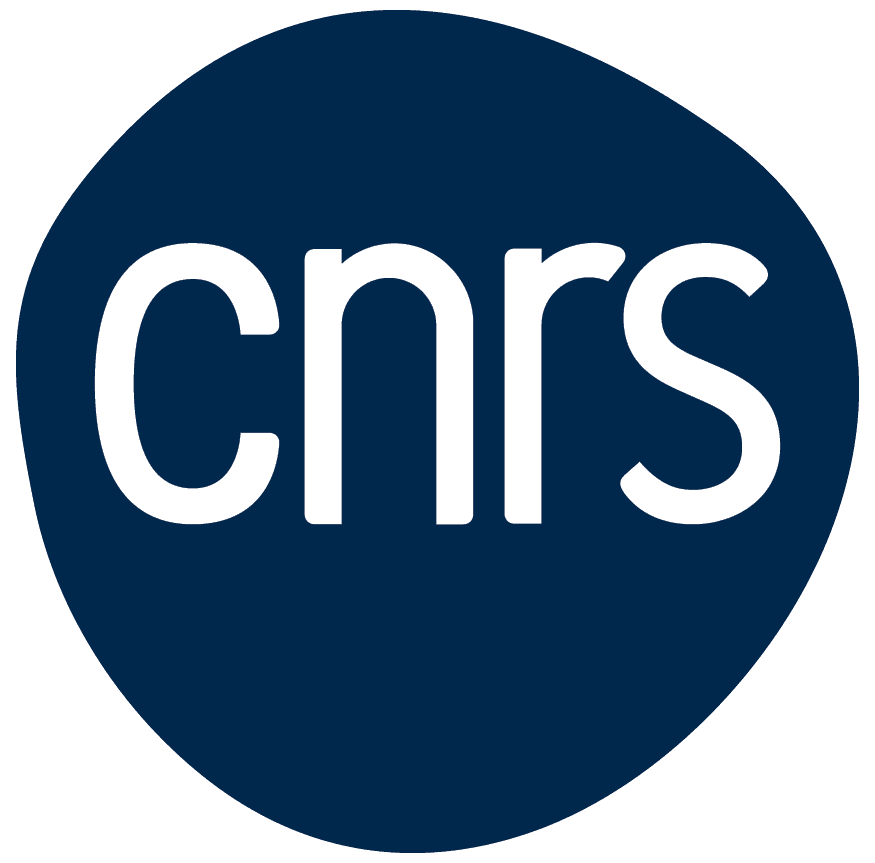Accueil>La politique au banc des accusés

11.02.2025
La politique au banc des accusés
Bruno Cautrès et Luc Rouban, chercheurs CNRS CEVIPOF livrent leur analyse de la seizième vague de l’enquête annuelle du Baromètre de la confiance politique, réalisée par OpinionWay, avec le CESE, Intériale Mutuelle, CMA-France, EDF, l’Institut de l’entreprise et l'Université Guido Carli - LUISS à Rome.
Le regard que portent les Français sur la vie politique s’est singulièrement durci depuis 2024. Les niveaux de confiance dans les représentants du pouvoir exécutif ont clairement baissé et ne sont nullement comparables à ceux que l’on trouve en Allemagne et en Italie. En France, seuls 23% des enquêtés ont confiance dans le gouvernement contre 38% en Allemagne et 35% en Italie. Et 27% seulement ont confiance dans François Bayrou alors que 43% des Italiens font confiance à Georgia Meloni et que 53% des Allemands font confiance à Olaf Scholz malgré la poussée actuelle des forces d’extrême-droite. La situation politique née de la dissolution de l’Assemblée nationale et de l’incertitude, sinon du chaos, qui s’en sont suivis ont généré une critique qui va au-delà de la méfiance, laquelle, somme toute, permet encore d’espérer. Cette critique porte sur l’utilité de l’activité politique en tant que telle.
Sans doute, l’attachement au principe démocratique est-il toujours très fort mais sa mise en œuvre actuelle en France crée beaucoup de déception et même de désarroi. En fait, les Français ont tout simplement honte de leurs responsables politiques. Ils les ont mis au banc des accusés. Les illusions d’une lecture parlementaire de la Vᵉ République se sont vite dissipées et l’idée s’impose que l’efficacité de l’action publique prime sur des débats interminables et des manœuvres de coulisses qui n’ont même pas permis de faire voter un budget qui règle sérieusement les difficultés financières du pays. La confiance dans l’Assemblée nationale est revenue à son niveau le plus bas (24%) tandis que 52% considèrent que l’on ne peut pas être fier de notre système démocratique (42% en Italie et 33% en Allemagne). Seuls 28% considèrent que la démocratie fonctionne bien, ce qui est le cas en revanche de 37% des Italiens et de 51% des Allemands. C’est encore en France que l’idée selon laquelle « en démocratie rien n’avance, il vaut mieux moins de démocratie et plus d’efficacité » obtient son score le plus haut (48%), en hausse par rapport aux années précédentes. De même, l’idée de recourir à un « homme fort qui n’a pas besoin des élections ou du Parlement » obtient également le soutien de 41% des enquêtés, une proportion qui n’avait pas été atteinte depuis 2017.
La demande d’autorité s’est affirmée. C’est ainsi que l’idée d’avoir « un vrai chef en France pour remettre de l’ordre » est défendue par 73% des enquêtés français alors que cette proposition ne convainc que 60% des enquêtés allemands ou italiens. Cette demande est surtout le fait des plus âgés (78% des 50 ans et plus), des moins diplômés (79% de ceux qui ont le niveau CAP/BEP) et de l’électorat de droite ou d’extrême-droite. C’est le cas de 89% des électeurs de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle de 2022, de 92% des électeurs de Valérie Pécresse, de 95% de ceux d’Éric Zemmour mais encore de 76% de ceux d’Emmanuel Macron. Cette proportion est bien plus basse, bien que majoritaire, à gauche : 54% de l’électorat de Jean-Luc Mélenchon et 58% des électorats d’Anne Hidalgo ou de Yannick Jadot.
Cependant, la mise à distance de la politique politicienne ne débouche pas sur un populisme supposant un engagement fort au service d’un leader incontesté. C’est le pragmatisme qui domine sans que l’on n’enregistre de grandes variations selon le statut professionnel ou le niveau de diplôme. Une majorité de Français (53%) est désireuse de disposer d’un gouvernement d’experts plutôt que d’un gouvernement représentant une majorité politique, ce qui débouche assez logiquement sur une demande également majoritaire (56%) pour un gouvernement de coalition faisant des compromis plutôt qu’un gouvernement engagé dans un projet politique sans concession. On peut douter qu’une telle solution serait à même de réenchanter la politique. C’est la lassitude qui l’emporte, face à une classe politique qui semble ne plus parler qu’à elle-même, avec son langage codé que personne ne comprend et son incapacité à régler les problèmes.
La priorité est clairement donnée à la vie privée et à sa protection plus qu’à l’investissement politique. Prendre ses distances avec ce fatras digne de la Quatrième République, est devenu un choix majoritaire : les deux tiers des enquêtés estiment ainsi en moyenne que « l’on a tout intérêt à se mettre à l’écart de la vie politique et à se consacrer à sa vie personnelle ». Cette mise à distance d’une politique qui inspire plus que jamais « méfiance » et « dégoût », un sentiment en nette hausse cette année, touche tous les électorats.
La crise politique que connaît la France sans interruption depuis le mouvement des Gilets jaunes de 2018, et qui a pris une dimension institutionnelle à partir de 2024, a produit un désengagement à l’égard du politique au profit du local, de la vie privée mais aussi des entreprises. Une demande d’autorité et d’efficacité vient également à l’appui d’un nouveau modèle à l’instar de celui que porte Donald Trump aux États-Unis. Pour l’instant, seul le Rassemblement national en France semble en mesure d’en profiter.
Bruno Cautrès et Luc Rouban, chercheurs CNRS au Centre de recherches politiques de Sciences Po
Analyse publiée dans Le Monde le 11 février 2025