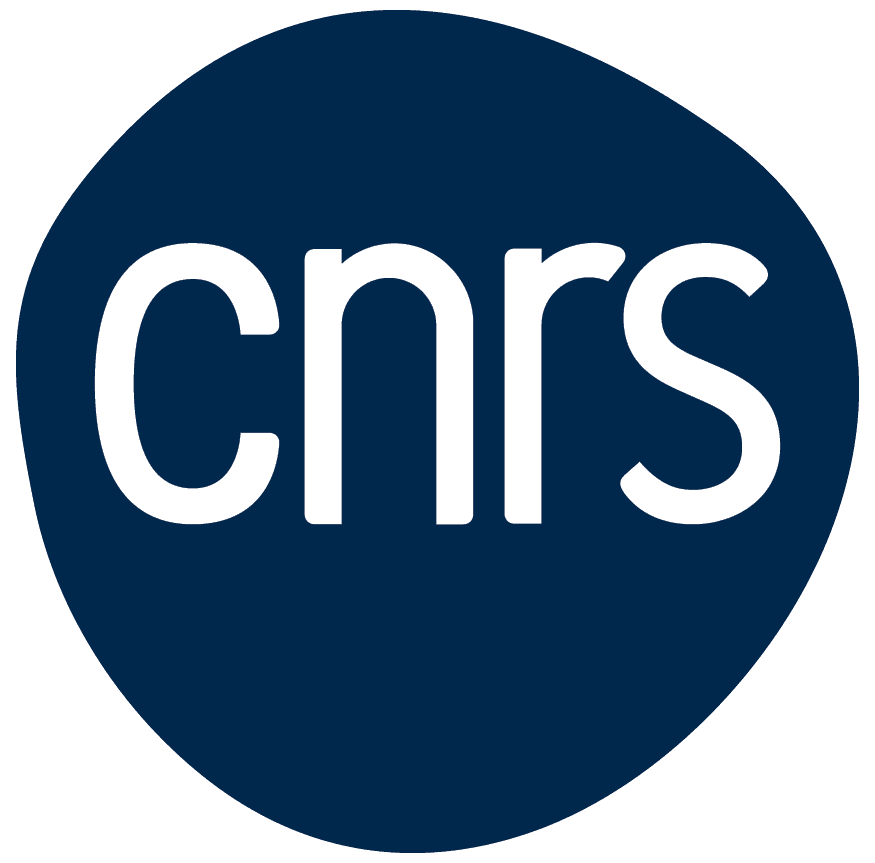Accueil>Baromètre de la confiance politique : une forte demande de démocratie plus directe et participative

20.02.2025
Baromètre de la confiance politique : une forte demande de démocratie plus directe et participative
Dans un entretien avec notre partenaire The Conversation, le chercheur Bruno Cautrès du CEVIPOF, le centre de recherches politiques de Sciences Po, propose une analyse de la crise démocratique illustrée par les derniers résultats du Baromètre de la confiance politique du CEVIPOF et plaide pour une remise à plat de nos institutions.
Le CEVIPOF a publié la vague 16 de son Baromètre de la confiance politique le 11 février 2025, réalisé par OpinionWay, grâce à un partenariat entre le CEVIPOF, le CESE, Intériale Mutuelle, CMA-France, EDF, l’Institut de l’entreprise et l'Université Guido Carli - LUISS à Rome.
Comme chaque année, le Centre d’études sur la vie politique française (Cevipof) propose un baromètre de la confiance politique. Avez-vous été surpris par les résultats de 2025 ?
Bruno Cautrès : Oui, nous avons été particulièrement surpris, après 16 ans d’enquête annuelle. Il s’agit d’un avertissement très sérieux sur l’état de notre démocratie. Nous ne nous attendions pas à arriver, cette année, à un tel niveau de défiance envers la politique et les institutions. Celle-ci est aussi forte que lors de la crise des gilets jaunes. Seuls 26 % des Français déclarent avoir confiance dans la politique, contre 47 % en Allemagne et 39 % en Italie. C’est un véritable effondrement.
Concernant la confiance dans les acteurs de la politique, on constate que 79 % des sentiments sont négatifs, et 16 % des Français ont confiance dans les partis. La confiance dans l’Assemblée nationale est à son niveau le plus bas, atteignant péniblement 24 %. Le président de la République souffre d’un niveau de confiance qui ne cesse de plonger. Quant au premier ministre, son action est déjà dépréciée avec une côte de 27 %. Il ne dispose d’aucun état de grâce. Un tiers seulement des personnes interrogées nous disent que le gouvernement et que François Bayrou sont légitimes ! Le personnel politique est perçu comme enfermé dans sa bulle, incapable de comprendre le pays et de régler les problèmes qui minent la cohésion nationale.
Vous faites le lien entre crise de la confiance politique et sentiment d’injustice sociale…
B.C. : Effectivement, nous constatons qu’il existe une corrélation forte entre ces deux sujets. Ainsi 36 % des salariés français estiment être dédaignés à cause de leur absence de diplômes (contre 29 % en Allemagne), de l’insuffisance de reconnaissance de la diversité des parcours de vie, estimant que tout est indexé sur le diplôme.
Une part majoritaire de la population française a le sentiment que le pouvoir ne simplifie pas sa vie quotidienne, qu’il ne fait pas assez confiance à la société civile et prend des décisions qui créent de la souffrance sans apporter de solutions.
À cette dimension très structurelle, vient s’ajouter l’effet de la dissolution et de ses conséquences. Ainsi, 56 % font porter la responsabilité de la situation politique actuelle à Emmanuel Macron. Les conséquences de cette décision furent perçues comme le retour à l’instabilité de la IVe République, à une situation où l’on ne comprend plus rien, ni les objectifs ni les priorités. Les données de notre enquête montrent cet extrême sentiment de confusion.
Est-ce que ce manque de confiance envers la classe politique se retourne contre le système démocratique, avec une tentation « illibérale » ?
B.C. : C’est une question complexe. Depuis plusieurs années, notre enquête montre une mise en tension de la question démocratique. Aucun autre pays n’a vécu une crise aussi violente que celle des gilets jaunes, il faut le rappeler. L’attachement aux principes démocratiques reste important, mais, en même temps, la démocratie est accusée par beaucoup d’être un système inefficace.
L’une des demandes, c’est un besoin d’autorité : 73 % souhaitent « un vrai chef en France pour remettre de l’ordre », contre 60 % en Allemagne et en Italie. Elle se double d’une volonté marquée de mise en œuvre d’une démocratie directe avec un fort soutien des Françaises et des Français aux référendums et à une démocratie plus horizontale et participative.
En ce qui concerne la demande d’autorité, l’élément le plus important, c’est la demande d’efficacité qui est sous-jacente. Mais la demande d’un chef, d’une personnalité forte qui « remette de l’ordre » dans le pays, est indéniable. Près d’un quart des personnes interrogées affirme aspirer à ce que l’armée dirige le pays. C’est un chiffre qui doit inquiéter. Cette injonction était auparavant située entre 15 et 17 %. Lors de la crise sanitaire liée à la Covid, 27 % des Français souhaitaient voir l’armée prendre la tête de la nation. Aujourd’hui, nous sommes à 24 %, c’est considérable.
On pourrait attendre de la classe politique, et peut-être des citoyens, une réflexion sur les moyens d’atteindre un fonctionnement démocratique plus sain. Or, cette question est la grande absente des débats…
B.C. : Je plaide, depuis plusieurs années, pour que la France s’engage dans une démarche comme le Royaume-Uni, l’Australie, ou la Nouvelle-Zélande avec une démarche d’audit démocratique. Les Anglais ont créé des commissions électorales à la suite du gros scandale lié à des notes de frais des députés. Désormais, vous avez, au niveau local, nombre de consultations citoyennes au Royaume-Uni ; lors de l’installation d’une infrastructure ou d’un site industriel par exemple.
Remarquons certaines initiatives intéressantes au plan démocratique en France, comme les conventions citoyennes, le grand débat national, les cahiers de doléances, etc. Le problème, c’est que nos institutions ne disposent pas de dispositifs suffisamment solides susceptibles de relayer ces innovations vers le Parlement.
À la fin de la conférence citoyenne sur le climat, les personnes tirées au sort ne comprenaient plus leur rôle : était-il législatif ou purement consultatif ? ou simplement était-ce celui d’une force de proposition ? Le chef de l’État a promis de « reprendre sans filtre leurs propositions », donnant le sentiment de défier le Parlement ou de le mettre de côté sur un sujet essentiel. Nous avons besoin de modalités renouvelées pour ces nouveaux outils de la concertation démocratique.
Pourquoi ne pas réfléchir à une nouvelle autorité indépendante dont la mission serait de consulter sur le fonctionnement de notre démocratie, hors du champ du débat politique ? Cette instance devrait rendre des comptes régulièrement. Son périmètre d’action et ses missions seraient précises, à la différence du conseil national de la refondation, dont on ne sait pas ce qu’il est devenu. Quant au Haut-Commissariat général au plan de François Bayrou, son utilité était tellement floue que le Parlement l’a supprimé d’un trait de plume en mettant son budget à zéro !
Notre enquête rappelle la présence de problèmes extrêmement lourds. Il est impossible de continuer ainsi. Nous devons arrêter de nous complaire dans l’idée selon laquelle la Ve République serait indépassable. Un très important effort doit être fait pour tirer des conclusions des multiples crises politiques et sociales traversées ces dernières années. Il faut espérer que le débat de la présidentielle de 2027 sera l’occasion d’un grand débat sur notre démocratie.![]()
Légende de l'image de couverture : Bruno Cautrès CEVIPOF 2024 (crédits : Aurore Papegay)