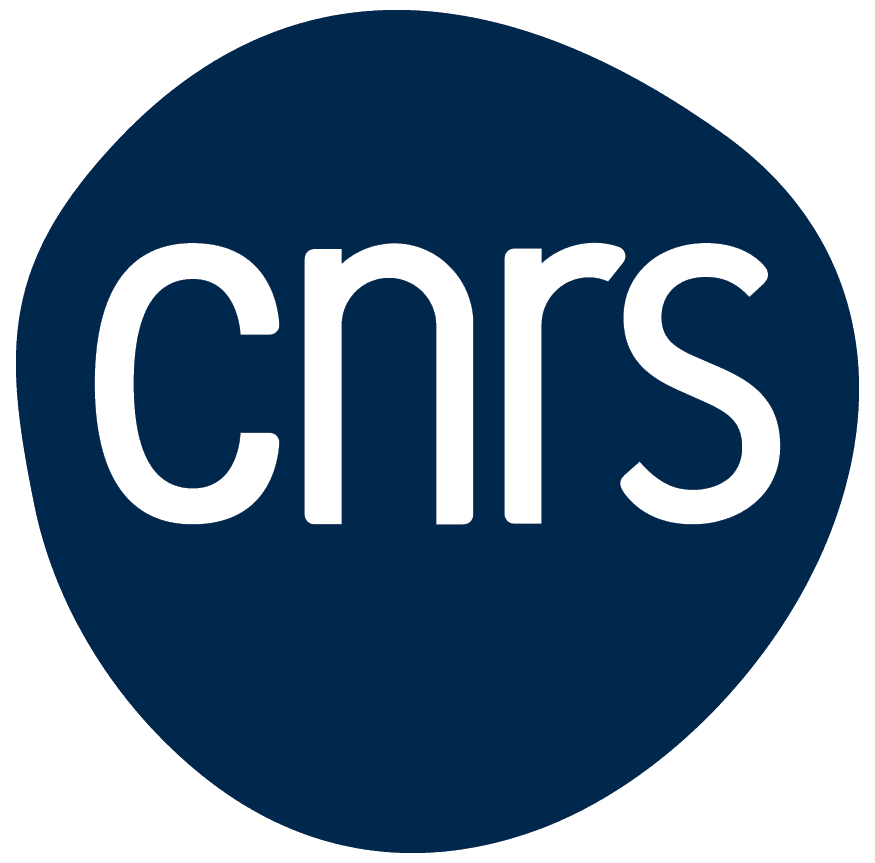Accueil>Le témoignage de violences sexistes et sexuelles sur X comme question politique et scientifique
04.04.2025
Le témoignage de violences sexistes et sexuelles sur X comme question politique et scientifique
Le Prix du mémoire 2024 du Conseil national du numérique est décerné à Clara Le Gallic-Ach, doctorante au CRIS, pour son mémoire de Master Sociologie Quantitative et Démographie de l’Université Paris Saclay / ENSAE, dirigé par Alice Debauche & Etienne Ollion.
Ce mémoire explore la prise de parole des victimes de violences sexuelles et sexistes sur les réseaux sociaux, plus particulièrement X, à travers les témoignages partagés dans la dynamique du mouvement - et du hashtag - #MeToo. Clara Le Gallic-Ach s’interroge sur la manière dont ces récits enrichissent la compréhension des violences subies, éclairent l’expérience et les parcours des victimes ; révèlent la tension entre l’intime, le collectif et le public dans l’espace numérique.
Son étude sociologique et statistique repose sur un corpus archivé de 330 000 tweets, dans lesquels les victimes choisissent un mode d’expression : anonymat ou incarnation, durée d’exposition, etc pour évoquer des violences subies. L’auteure analyse également les impacts des messages et la porosité entre les espaces numériques, médiatiques, judiciaires et politiques, tout en montrant que ces récits peuvent apporter des perspectives nouvelles aux chercheurs et compléter les statistiques officielles.
Si l’accès aux données Twitter s’est souvent vu entravé par les changements de politique de la plateforme, et si l’espoir de trouver dans ces données de nouvelles et fécondes façons d’étudier les problématiques sociales s’est vite évaporé, il n’en demeure pas moins que ce lieu d’expression publique, voire de défoulement, a aussi servi de nobles causes.
Clara Le Gallic-Ach, nantie d’un bagage méthodologique robuste acquis à l’ENSAE, a rapidement vu le potentiel des données stockées journalièrement par l’INA - qui archive non seulement des émissions audio-visuelles, mais aussi des contenus de réseaux sociaux - et a misé sur leur viabilité scientifique. A partir d’une sélection mots clés, dont #MeToo, elle a pu explorer plus de 300000 tweets publiés entre 2017 et 2022.
- Grâce à l’utilisation d’un modèle de langage (BERT pour les intimes), correctement entraîné, j’ai pu repérer les comptes témoignant de violences sexuelles et sexistes et les distinguer des ceux exprimant une opinion ou des simples relayeurs - dont les bots (agents automatiques). J’ai ainsi pu procéder à une classification automatique des contenus et me concentrer sur ceux présentant un intérêt pour ma recherche.
N’avez-vous pas eu peur d’avancer sur un terrain où la sociologue a besoin de savoir qui parle, d’où il parle, qui est l’individu qu’il observe ?
- Oui, c’est un véritable renoncement ; se priver de données socio-démographiques oblige à bien préciser l’objet étudié : ici le contenu des témoignages textuels, et la forme ou la durée de cette expression.
Sur quels types de violences portent ces témoignages ? Certains sont-ils plus fréquents ?
- En les distinguant par type, on mesure leur diversité : milieu familial, professionnel, éducatif, lieux publics, mais aussi le faible nombre de violences conjugales signalées. En regardant de plus près, une autre caractéristique émerge, c’est la variable temps. Beaucoup des faits dénoncés dans ces tweets sont anciens. Les victimes expriment un certain recul par rapport à ce traumatisme. Apparemment les témoignages, qui sont rarement des dénonciations précises, ne sont pas en rapport avec des faits vécus au même moment.
Mais les tweetos sont tous anonymes ?
- Non, par forcément. On peut distinguer ceux qui endossent une cause, dénoncent, interpellent, des acteurs politiques par exemple et peuvent révéler leur identité, et ceux qui sont non seulement anonymes, mais parfois ne recherchent aucunes interactions. C’est alors un témoignage “brut” lancé sur la toile, via un compte créé ad-hoc qui n’aura pas d’autre objet, pas de followers.
Comment se poursuit votre parcours à Sciences Po, avec deux questions corollaires : ce corpus va t’il être complété, et comment vous situez-vous dans le paysage de la recherche, entre SHS et sciences informatiques ?
- Je suis sociologue, on va dire quantitative, travaillant avec des outils d’analyse du langage. Mon travail en thèse va me permettre d’élargir la recherche à des bases de données plus traditionnelles, comme celle de l’INED par exemple. On peut y suivre de manière diachronique le mouvement induit par #MeToo. Mais je continue à profiter des données archivées par l’INA pour actualiser et capitaliser le corpus des témoignages sur Twitter et affiner ma compréhension de la manière dont les gens utilisent la plateforme.
Clara Le Gallic-Ach prépare sa thèse Déclarer des violences de genre en France depuis #MeToo au CRIS, sous la direction de Marta Domínguez Folgueras (CRIS) et Magali Mazuy (INED).