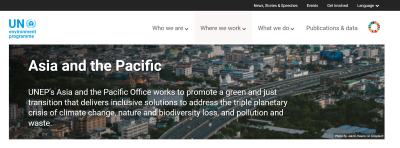Accueil>Transition écologique : l’inclusion en question
22.10.2024
Transition écologique : l’inclusion en question
Transition écologique : l’inclusion en question
Les idéologies économiques, comme politiques, les identités sociales et culturelles ainsi que les inégalités influencent la conception des transitions écologiques, tout comme leur mise en œuvre. De quelles façons ? Avec quelles conséquences ? Comment améliorer les politiques publiques de durabilité ? Ces questions sont au cœur des travaux de Manisha Anantharaman, Assistant Professor au Centre de sociologie des organisations (CSO).
Elle publie dans Recycling Class. The Contradictions of Inclusion in Urban Sustainability (MIT Press, janvier 2024) les conclusions qu’elle tire de dix ans d’observations sur le terrain. Entretien.
Vous vous intéressez aux pratiques quotidiennes de durabilité environnementale et aux mobilisations politiques qui y sont liées. Quels sont les résultats de vos dernières recherches à ce sujet ?
Manisha Anantharaman : Mes recherches actuelles se concentrent sur deux questions : comment les classes moyennes émergentes en Asie pensent et agissent sur l’environnement à travers leurs pratiques quotidiennes et leurs mobilisations politiques, et avec quelles conséquences sur les espaces urbains, l’écologie et les autres groupes sociaux ? À partir de là, j’ai cherché à comprendre comment les communautés marginalisées et périphériques naviguent dans l’« environnementalisme performatif » des élites culturelles urbaines tout en affirmant leur droit à la ville et au bien être.
J’ai étudié ces questions à travers des études empiriques sur la mobilité verte urbaine, l’économie circulaire, le travail informel, et les espaces verts. Écrire Recycling Class m’a permis de synthétiser ma réflexion sur les liens entre justice et durabilité, et de proposer de nouveaux cadres théoriques pour étudier comment les inégalités sont reproduites et remises en question dans les transitions écologiques.
Fondé sur un travail ethnographique de terrain à Bangalore, en Inde, j’analyse dans cet ouvrage les moyens de subsistance, les infrastructures et les mouvements sociaux liés aux déchets urbains et leurs circuits et les discours des programmes mondiaux de durabilité néolibérale « propre et verte » et d’économie circulaire.
Je combine les cadres théoriques de la sociologie culturelle, de l’économie politique féministe et de l’écologie politique urbaine pour faire le lien entre la consommation durable de la classe moyenne et le travail environnemental des travailleurs pauvres. J’y propose une analyse « située », relationnelle et intersectionnelle des politiques et pratiques de durabilité urbaine.
Empiriquement, j’ai suivi la politique des déchets dans la ville et j’ai observé comment les acteurs de la classe moyenne, l’État, les récupérateurs de déchets (qui gagnent leur vie en récupérant la valeur des déchets) et les acteurs économiques s’entendent. J’ai découvert que la « durabilité communautaire »(1) de la classe moyenne, les efforts qui mettent l’accent sur la décentralisation et les solutions low Tech créent de nouvelles voies permettant aux organisations de ramasseurs de déchets de revendiquer la mise en place d’infrastructures dites inclusives. Il s’agit d’infrastructures qui tiennent compte des besoins de chacun et permettent à toutes les populations, en particulier les plus marginalisées, d’avoir une bonne qualité de vie, de pouvoir participer pleinement à la société et d’être plus résilientes aux effets des changements climatiques.
De fait, si les « infrastructures de bricolage » (do it yourself) coproduites servent d’espaces de citoyenneté et de négociation politique, et si elles remettent en question la logique technocratique et des politiques dominantes de développement durable basées sur la croissance, elles n’en reproduisent pas moins les divisions du travail en classe, en caste et en genre, démontrant que l’inclusion sans réforme sociale peut reproduire une répartition injuste des risques et des responsabilités.
En fin de compte, l’ouvrage est une critique du « programme d’inclusion ». L’inclusion en soi n’est pas une panacée contre l’injustice et les idées fausses du « gagnant-gagnant » sapent le potentiel de transformation des transitions écologiques.
Vous travaillez actuellement avec le Centre « Environment and Society » de la Chatham House en lien avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), principale autorité mondiale en matière d’environnement. Quels sont les objectifs de votre participation à ce programme ?
M.A : Le débat de politique publique sur la transition écologique a besoin des théories et des outils de la sociologie. Ma bourse d’associée à Chatham House « Environment and Society Centre » m’offre une plateforme pour transmettre les produits de la recherche au public et aux décideurs politiques. En ce moment, je travaille en équipe sur un rapport politique pour le Programme Environnement des Nations Unies liant consommation et circularité. Nous y synthétisons un large corpus de littérature académique, examinons la mise en œuvre des politiques dans les villes du monde entier et développons une méthodologie pour créer des programmes politiques adaptés aux contextes pour remodeler alimentation, mobilité et consommation de logement.
Nous avons animé des ateliers avec des parties prenantes représentant divers secteurs, régions et domaines d’expertise pour garantir que les résultats englobent une perspective mondiale. Le rapport met également l’accent sur les perspectives des groupes marginalisés dans la planification de la transition écologique et propose des actions concrètes pour les inclure.
United Nations Environment Programme site web, juin 2024
Réaliser ce type de travail politique n’est pas simple, car il faut marier indépendance de la recherche et coopération avec des instances politiques. En tant que chercheuse, j’étudie les relations de pouvoir et suis donc sensible aux difficultés liées à la formulation de solutions transformatrices pour la durabilité, au sein de l’ordre en place. Dans le même temps, je suis attachée à l’indépendance de la recherche, à son apport critique ainsi qu’à la nécessité de prendre en compte les perspectives des pays du Sud dans des milieux où les unes et les autres sont sous-représentés. C’est pourquoi, et malgré des réticences fréquentes et une conscience constante des contradictions liées au fait de tenter de mener simultanément un travail critique et orienté vers l’action, j’ai accepté des opportunités de m’adresser à un public politique plus large à travers mon travail. À l’inverse, ces expériences nourrissent mes recherches et mon enseignement, me permettant d’établir des liens entre la théorie et la pratique dans mes publications scientifiques et en classe.
Qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre Sciences Po et le Centre de sociologie des organisations ?
M.A : C’est tout d’abord parce que les discussions et débats sur la transition écologique sont vraiment au centre des préoccupations en France. Il existe de nombreuses opportunités de mener des recherches intéressantes, notamment sur les thèmes de l’inégalité, de l’inclusion et de la « transition juste ».
Ensuite, Sciences Po est clairement engagée dans la recherche et l’enseignement sur la transition écologique, comme en témoignent les nombreux programmes et initiatives qui y sont dédiés. Je suis ravie de me joindre à ces efforts et de contribuer à ces échanges avec mes perspectives mondiales et intersectionnelles. J’ai également été attiré par l’opportunité de travailler dans une institution avec un profil et un engagement mondial. Sciences Po accueille des étudiants du monde entier. Je pense que cette ouverture au monde améliore notre compréhension des problèmes sociaux contemporains, et en particulier des problèmes écologiques qui ont une dimension mondiale incontournable. Par ailleurs, la possibilité d’enseigner dans des masters de haut niveau à Sciences Po était un atout supplémentaire.
Enfin, je ressens une affinité avec les chercheurs du Centre de sociologie des organisations et mes travaux se situent à l’intersection des thématiques sur lesquelles se concentre le laboratoire : comment le travail (formel et informel) est engagé dans la transition écologique, les interactions entre les mouvements sociaux, les marchés et les politiques publiques, entre autres.
À tout cela s’ajoute une note personnelle : je ne sais pas conduire ! J’ai survécu aux États-Unis pendant 13 ans en tant que non-conducteur, mais c’est vraiment agréable d’être dans une ville et un pays dotés d’excellents transports publics.
Quels cours enseignez-vous et quels messages souhaitez-vous faire passer aux étudiants ?
M.A : J’enseigne des cours de justice environnementale et de sociologie de l’environnement. J’adore enseigner. La salle de classe est ma maison sur n’importe quel campus.
Ma philosophie d’enseignement s’inspire d’humanistes tels que Paulo Freire, Bell Hooks, Ella Baker. Mon objectif est de créer une classe humanisante et énergisante où les étudiants intègrent des cadres conceptuels, des compréhensions historicisées et une observation attentive pour réfléchir de manière critique à leurs contextes sociaux et environnementaux. Mon objectif est de leur permettre d’évaluer et répondre aux questions socioécologiques grâce à la pensée critique, à la recherche partagée et à la citoyenneté engagée.
Je suis aussi heureuse de travailler avec des étudiants de maîtrise et de doctorat intéressés par les approches de recherche participative et collective, des approches pédagogiques et méthodologiques de recherche avec lesquelles je suis familière.
Quels sont vos projets à venir ?
Le premier s’intéresse à la relation entre digitalisation et transitions écologiques. Aux côtés de chercheurs de Suède, de Norvège, de Turquie et du Japon, je codirige un projet « Digital infrastructures for sustainable consumption: Redirecting, reorganising, reducing and reimaging consumption », financé par la National Science Foundation des États-Unis. Notre équipe a reçu 1,3 million d’euros sur trois ans pour étudier l’usage des outils numériques — notamment les applications — dans la consommation des ménages et ses conséquences environnementales, dans cinq pays. Dans ce projet, nous combinons les approches théoriques des pratiques, des façons de faire, avec des méthodes ethnographiques visant à comprendre la vie quotidienne. L’idée est d’analyser les cycles de vie pour quantifier les impacts des interventions numériques pour la durabilité dans les domaines de l’alimentation et de la mobilité. Elle se terminera par une série d’ateliers avec les autorités municipales, les concepteurs d’appli et la société civile.
Pour le second projet, je lance une étude sur le travail informel dans l’économie circulaire dans une perspective comparative. Ce projet explorera la manière dont les sociétés multinationales, les organisations intergouvernementales et l’Union européenne encadrent les économies informelles de déchets et les associent à leurs plans de transition vers une économie circulaire. L’idée est d’explorer comment les récupérateurs et les recycleurs informels des villes asiatiques et africaines cooptent, résistent ou modifient les programmes pour les intégrer dans les chaînes de valeur mondiales du recyclage. Il sera particulièrement intéressant d’observer le rôle du marché intermédiaire et des acteurs de la société civile tels que les organisations internationales dédiées au développement, les sociétés de capital-risque et les organisations à but non lucratif dans la médiation de ces relations économiques et sociales en évolution.