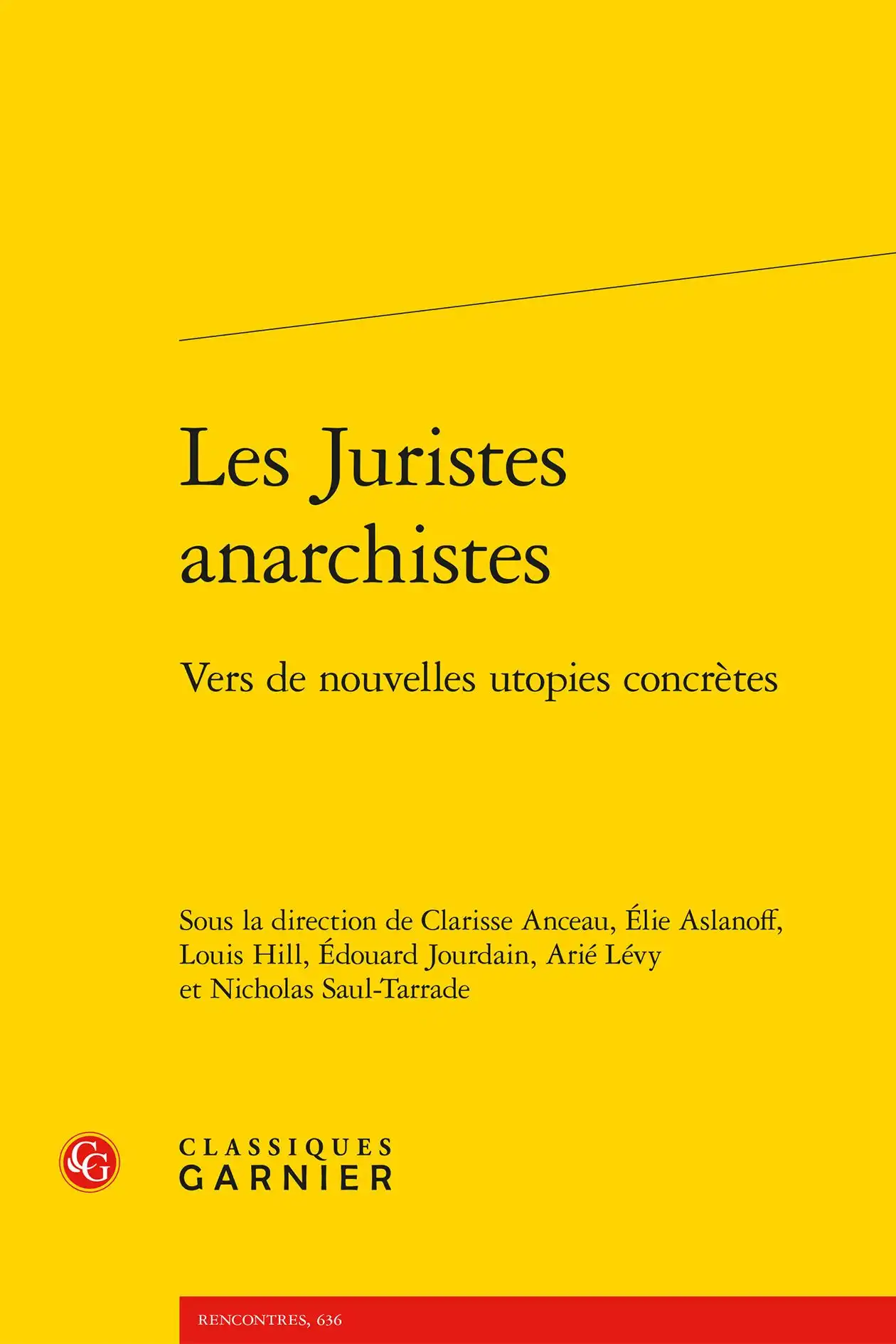Accueil>Le droit autrement : rencontre avec les Juristes anarchistes
24.04.2025
Le droit autrement : rencontre avec les Juristes anarchistes
Né en 2021, le groupe des Juristes anarchistes rassemble des doctorants et docteurs de l'École de droit de Sciences Po désireux de renouveler l’imaginaire juridique à partir d’une perspective libertaire. À contre-courant des usages traditionnels du droit, ce collectif interroge la manière dont les juristes peuvent contribuer à la pensée anarchiste — et inversement, comment les idées anarchistes peuvent nourrir une critique radicale du droit. À travers colloques, séminaires, publications et rencontres interdisciplinaires, le groupe explore les tensions, dialogues et potentiels entre normes juridiques et utopies libertaires.
Rencontre avec les membres de ce laboratoire d’idées iconoclaste, à l’occasion de la parution de leur premier ouvrage collectif Les juristes anarchistes : Vers de nouvelles utopies concrètes (Classiques Garnier, 2024).
Le groupe des Juristes anarchistes est né en 2021. Qui sont les membres qui compensent ce collectif et quelles sont les ambitions qui vous rassemblent ?
Le groupe de recherche des Juristes Anarchistes est composé de Clarisse Anceau, Elie Aslanoff, Yacine Ben Chaabane Mousli, Jules Cosqueric, Amina Hassani, Louis Hill, Arié Lévy, Sophia Riahi, Nicholas Saul-Tarrade et Garance Thomas.
L'objectif général du groupe est d'entamer une discussion à la fois sur les apports des juristes dans l'élaboration de nouvelles doctrines libertaires et sur les apports de la pensée libertaire au service d'une vision critique du droit. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, nous souhaitons interroger les rapports entre droit et anarchisme. Cette ambition est suffisamment générale pour abriter une grande diversité de visions politiques, d'épistémologies juridiques, de stratégies de recherche, de projets. Nous avons, ainsi, au fil des années proposé des projets très différents.
En 2021, date de la création du groupe, la réflexion s'est surtout portée sur l'apport du droit à la pensée anarchiste. Nous avons, dans cet esprit, organisé un colloque sur l'élaboration par les juristes d'utopies libertaires. Cela a donné lieu à la publication d'un ouvrage collectif chez Classiques Garnier. Nous avons eu l'occasion de présenter cet ouvrage à l'Université de Rouen et à l'École de droit de Sciences Po, et aimerions à présent le présenter dans d'autres universités, médias, ou librairies.
En 2022, nous avons poursuivi la réflexion entreprise en 2021 en organisant une série d'évènements sur le concept de responsabilité. Il nous a semblé que ce concept avait des implications libertaires ou, au contraire, liberticides qu'il était utile d'étudier. Nous avons donc accueilli plusieurs chercheurs en droit et sciences sociales au cours de trois séances, respectivement sur la responsabilité civile, pénale et internationale. Ce fut l'occasion de découvrir la littérature abolitionniste que nous souhaitons approfondir à l'avenir.
Les années 2023 et 2024 ont été consacrées à l'étude de l'État, de sa formation et des rapports de domination qu'il institue. Un premier évènement était dédié aux formes juridiques de la violence de l'État. Il s'agissait de mobiliser le savoir des juristes au service d'une meilleure compréhension de la violence étatique, fréquemment dénoncée par les anarchistes. Nous avons également organisé un séminaire sur une généalogie de l'État inspirée des travaux de Mohamed Amer Meziane. Ce fut l'occasion d'élargir notre réflexion en y incorporant de nouvelles sources, comme l'anthropologie, la pensée décoloniale, la théologie, l'histoire.
Votre ouvrage “Les juristes anarchistes : Vers de nouvelles utopies concrètes” (Classiques Garnier, 2024) vient d'être publié. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Dans cet ouvrage, il s'agissait de présenter un nouveau geste méthodologique consistant à s'inspirer du droit pour imaginer de nouvelles utopies anarchistes. L'intérêt du geste était avant tout de montrer aux juristes qu'il était possible de contribuer, en juriste, à des débats extérieurs au droit. Cela est intéressant dans un moment où les juristes font l'objet d'une marginalisation dans les grands débats sociétaux au profit de sociologues et économistes. L'ouvrage tente aussi de convaincre les anarchistes de s'intéresser aux travaux des juristes. Le droit permet en effet de formaliser des relations, y compris parfois des relations horizontales. Cette formalisation permet alors de concrétiser les idéaux, parfois trop abstraits, des anarchistes. L'ouvrage montrait ainsi que l'on pouvait, voire que l'on devait, parfois être juriste pour être anarchiste, comme c'était d'ailleurs le cas de Pierre-Joseph Proudhon, père de l'anarchisme. Pour autant, l'ouvrage montrait que le fait de penser l'anarchisme en juriste n'invitait pas forcément à adopter une doctrine homogène, mais au contraire à l'exploration d'une grande diversité d'idées, conceptions, formes juridiques, voire de sources (droit naturel, droit positif, droit savant, droit privé, droit public, histoire du droit, etc...).
Quels sont les projets à venir de votre groupe ?
A présent, nous comptons continuer d'organiser des évènements sur différentes thématiques, comme les liens entre la pratique du droit et la pensée libertaire, le pluralisme juridique, l'abolitionnisme pénal, le droit autochtone, les formes juridiques de la violence de l'Etat, les vertus épistémologiques d'un point de vue anarchiste sur le droit, et notamment en droit international. L'important pour nous est de regrouper des chercheurs et chercheuses, praticiens et praticiennes, qui partagent une même envie de renouveler l'imagination juridique et libertaire, sans pour autant avoir la même vision de ce qu'est le droit, ou la liberté.