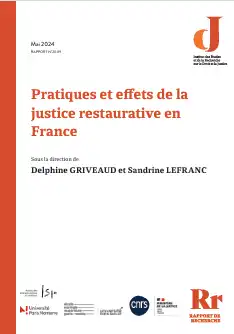Accueil>Justice ou injustice restaurative ? Les réponses de la recherche

10.06.2024
Justice ou injustice restaurative ? Les réponses de la recherche
La justice restaurative est un droit en France depuis 2014. Victimes et auteurs ou autrices d’infractions – quels que soient les actes commis – peuvent demander à dialoguer avec l’autre partie, ou avec des auteurs, autrices ou victimes du même type d’infraction. Le dispositif a connu un engouement sans précédent depuis la sortie en 2023 du film Je verrai toujours vos visages. Elle reste cependant l'objet de controverses et ses détracteurs parlent parfois d'"injustice restaurative".
Quel bilan scientifique pour la justice restaurative ?
Quel bilan tirer d'une décennie de déploiement en France de cette autre manière de rendre justice, complémentaire, mais indépendante de la justice pénale ? Comment est-elle mise en œuvre ? Quelle évaluation en faire ? En particulier, quels sont les effets de ses dispositifs sur les victimes, et sur les auteurs et autrices ? Contribue-t-elle au rétablissement d’un lien social affecté par le crime ?
Ce sont les questions auxquelles a souhaité répondre Sandrine Lefranc, directrice de recherche au Centre d'études européennes et de politique comparée (CEE, Sciences Po / CNRS), grâce à un financement de l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice (IERDJ). Pour cela, elle a rassemblé une équipe composée de collègues académiques aussi bien que des praticiens et praticiennes de la justice restaurative.
Après 36 mois de travail, le rapport qui en est issu (codirigé avec Delphine Griveaud) vient d'être publié. Ses conclusions ont été présentées lors d'une table ronde organisée par l'IERDJ le 5 juin, à Bruxelles et en ligne.
DÉcouvrir le rapport et sa synthèse
Le rapport en 5 points clés
- Le rapport dresse le portrait d’une justice restaurative fragile à l’échelle nationale, mais active sur certains territoires bien délimités localement.
- Les effets de la justice restaurative sur ses publics sont globalement positifs : les professionnelles et professionnels retrouvent un sens à leur métier, les participantes et participants renouent avec l'État. Pour tous, une estime de soi renforcée.
- La justice restaurative fonctionnant par individualisation, le lien social n'est pas particulièrement réparé. L'environnement social des participantes et participants est peu impliqué, les normes sociales peu discutées. En matière de violences de genre, très présentes dans les pratiques de justice restaurative en France, c'est pourtant une condition pour que les mesures aient des effets durables.
- Les mesures des effets sur la récidive des auteurs sont limitées méthodologiquement.
- L’hypothèse d’une double dynamique émotionnelle – de soulagement des victimes et de renforcement de l’empathie des auteurs, privilégiée dans la littérature évaluative internationale et nationale, est discutable.
Les chercheuses à l'origine du rapport appellent en conclusion à la mise en place d'une évaluation plus systématique, sur une durée longue, que celle qu'elles ont pu réaliser.
> En bonus, revoir la conférence organisée par le CEE et l'École de droit de Sciences Po sur la justice restaurative :