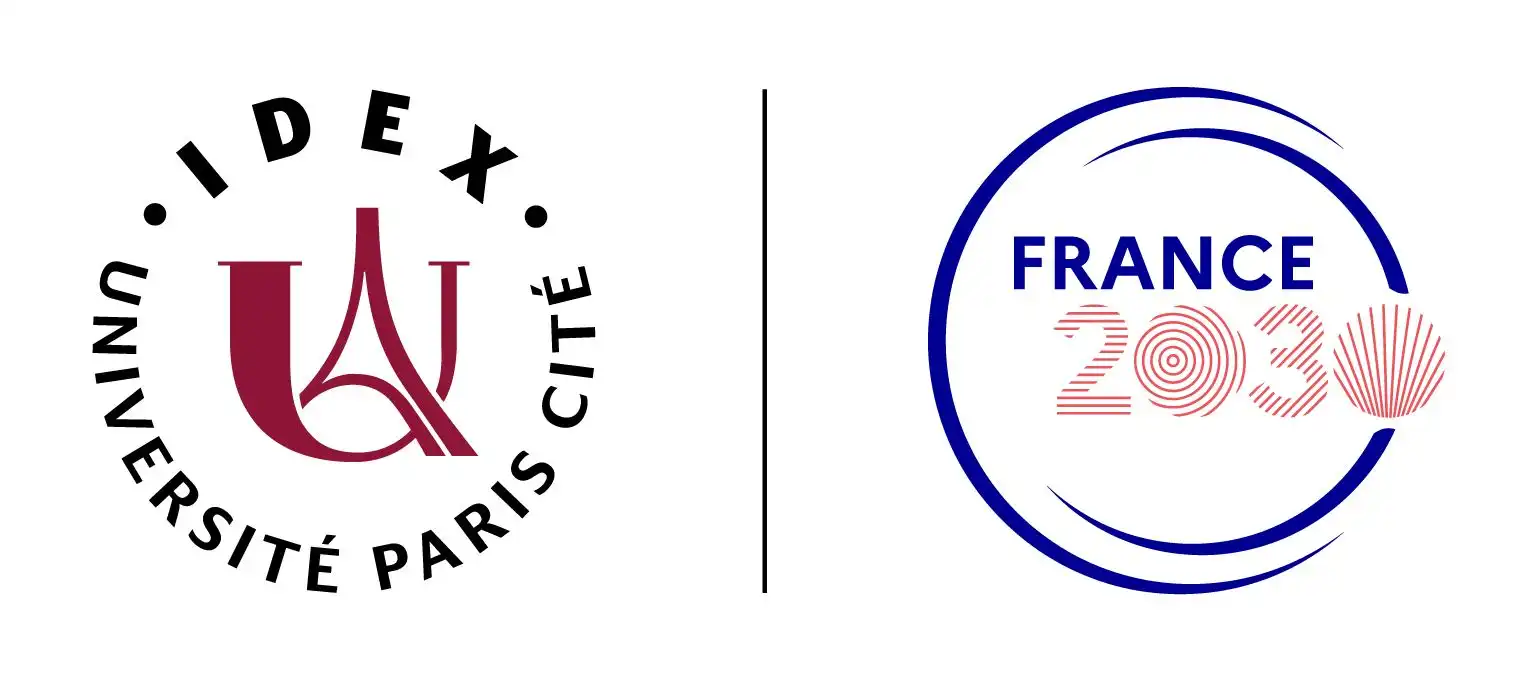Accueil>Marie-Anne Dujarier- Le paradoxal déploiement du management par les dispositifs
12.09.2024
Marie-Anne Dujarier- Le paradoxal déploiement du management par les dispositifs
Marie-Anne Dujarier est sociologue, professeure à l’Université Paris Cité (IHSS / LCSP) où elle est responsable du Master Sociologie clinique et psychosociologie. Ses recherches portent sur l’encadrement social de l’activité par les institutions que sont l’emploi, la consommation et le management. Elle a notamment publié L’idéal au travail (Puf – Quadrige, 2006), Le management désincarné (La Découverte, 2016), Troubles dans le travail. Sociologie d’une catégorie de pensée (Puf, 2021). Elle a aussi dirigé Idées reçues sur le travail, publié en 2023, au Cavalier Bleu, avec un collectif de 40 chercheu.res.
LE PARADOXAL DEPLOIEMENT DU MANAGEMENT PAR LES DISPOSITIFS
Marie-Anne Dujarier
Management contemporain : quoi de neuf ?
Le management est, pour un employeur, le moyen de faire faire les choses ; ou mieux encore, de faire en sorte que les choses soient faites. Cette pratique sociale s’est développée et formalisée depuis le capitalisme industriel, et avec l’accroissement de la taille des organisations.
Des « modes managériales » (Abrahamson, 1996) se sont succédées depuis un siècle dans les entreprises privées et publiques, comme dans l’administration : taylorisme, fordisme, fayolisme, direction par les objectifs, démarches qualités, « qualité totale », « démarches participatives », reengineering, benchmarking, lean management, méthode Agile…
Aujourd’hui, ce qui caractérise les manières d’organiser la production et de fabriquer des marchés est un management désincarné, avec une direction massivement exercée via des dispositifs. Le mot s’entend au sens proposé par Michel Foucault (2001) comme un « ensemble relativement hétérogène, comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques ». Nous pourrions ajouter, pour actualiser cette liste, des outils de gestion et des systèmes informatiques.
Utilisés par l’État pour encadrer les populations et leurs actions, les dispositifs s’imposent maintenant aussi dans les grandes organisations productives, y compris privées, pour prescrire, outiller, organiser, cadencer et contrôler l’activité productive humaine. Le « quoi » faire, le « comment » faire et le « pourquoi » faire sont partout contenus dans des dispositifs, c’est-à-dire des choses, plus qu’énoncés par des personnes.
Cette configuration sociale suppose de mandater des salariés pour concevoir, diffuser et mettre en œuvre les dispositifs. Leur employeur attend qu’ils améliorent les résultats (taux de retour sur investissement, réduction des coûts, amélioration de la productivité et de la qualité, développement des marchés…), en agissant sur les organisations, l’emploi et l’activité des humains productifs. Ces derniers sont des employés aux statuts divers, mais aussi des client.es et citoyen.nes incité.e.s ou contraint.e.s à coproduire les services consommés – que ce soit face à une caisse prétendument automatique de supermarché, au moment de réaliser des opérations bancaires depuis chez soi, d’acheter un billet de train, de rentrer des choix dans Parcoursup ou de déclarer ses impôts.
Ce mode de management s’inscrit dans la « rupture anthropologique » (Castel, 1995), initiée avec le taylorisme. Elle sépare la pensée de l’action, l’organisation des tâches de leur réalisation. Les concepteurs de dispositifs sont en effet chargés de penser la tâche sans la faire, à l’intention de celles et ceux qui sont supposés la réaliser sans toucher aux normes et règles dont elle est porteuse.
Présents dans toutes les grandes structures, ces salariés de grandes organisations sont rattachés à la direction générale qui soutient leurs projets ou bien consultant.es pour elle. Diplômé.es à un niveau Bac +5 d’écoles et universités sélectives, ces cadres sont situés à distance fonctionnelle, temporelle, sociale mais aussi topographique (cf la contribution d’Olivier Godechot), des opérationnels dont l’activité est encadrée par leurs dispositifs. Cette distance fonde leur mandat et leur légitimité professionnelle. Elle leur permet de voir les choses et les gens de haut, en « plan », c’est-à-dire à la fois de manière globale, lointaine, abstraite et rationnelle. Aussi, nous proposons de les dénommer par le néologisme de « planneurs », pour les distinguer des cadres de proximité ou de ceux qui travaillent dans la recherche et développement. D’après notre enquête, les planneurs ont pris une place importante : ils seraient désormais 40 % des cadres en France (Dujarier, Wolff, Schlagdenhauffen, 2015).
S’ils ne sont pas les hiérarchiques officiels des opérationnels, l’activité de ceux-ci est pourtant, de fait, encadrée par les dispositifs qu’ils ont conçus ou qu’ils font respecter. La majorité des planneurs (56 %) déclare en effet avoir pour mission de « fournir des outils et/ou méthodes de travail pour les autres salariés » et 43 % disent « mettre en place des méthodes de contrôle, d’évaluation, de reporting et de mesure de performance dans les entreprises ». Les méthodes qu’ils déclarent mettre en œuvre s’intitulent « conduite du changement », « optimisation des flux, de la qualité et de la sécurité », « réduction des coûts », « informatisation », « développement, innovation », « fiabilité financière et comptable et de contrôle de gestion », « optimisation de la fonction RH », etc. Une grande partie des dispositifs porte des noms, généralement des acronymes d’anglicismes, incompréhensibles pour un néophyte (TPM, TQM, CRM, ERP, GPEC, SAP, SRUM, MPO…).
Qu’ils soient salariés de l’organisation ou consultants pour celle-ci, ils se revendiquent spécialistes de méthodes universelles plus qu’experts d’un secteur productif. À cet égard, la majorité des planneurs doute d’avoir un « vrai métier ». L’examen de leur carrière indique qu’ils passent d’un secteur productif à un autre avec régularité, y compris entre public et privé. Ainsi, un DRH de l’agroalimentaire devient, sans aucune difficulté apparente, DRH d’hôpitaux publics, par exemple.
Cette forme d’encadrement a de fortes incidences sur le travail réel et vécu des hommes et femmes qui doivent penser, agir et vivre quotidiennement avec des dispositifs. Or, elle est l’objet d’une critique sociale étendue. On cherchera à comprendre alors les ressorts de son extension en portant l’attention sur les marchés des dispositifs et celui des emplois de planneurs.
Comment ce management à distance est-il vécu ?
Dans ce management via les dispositifs, les tâches, leur organisation et évaluation sont conçues de manière générique, hors de la situation réelle, et avant qu’elle n’ait lieu, par des personnes qui en sont éloignées.
Employés et consommateurs doivent alors faire un effort de traduction : décrypter le vocabulaire des concepteurs et sa signification, rentrer dans leur logique, constater que les valeurs et le sens de l’activité imposés par ces dispositifs heurtent parfois celles de leur métier. Que l’on soit un médecin hospitalier soumis au système de la « Tarification à l’acte » (T2A), un guichetier dans une agence de location de voitures ou une cadre proximité dans la pétrochimie, il faut arriver à comprendre ce que ces dispositifs exigent, nomment, mesurent, valorisent, pour arriver à produire avec eux, mais aussi pour tenter de les contourner.
Lorsque la situation concrète et le client (le patient ou l’usager) se présentent tels que les concepteurs l’ont imaginé, « ça roule », entend-on dire. Mais ce cas est rare : dans un hôpital, une multinationale ou une usine, de même que dans une classe d’école, une banque ou un aéroport, les clients et usagers sont infiniment variés et leurs demandes régulièrement subtiles, partiellement implicites et polymorphes ; les aléas sont nombreux, qu’ils concernent le fonctionnement des machines et outils, les effectifs réellement disponibles, la santé ou le climat. Celles et ceux qui doivent travailler avec ces dispositifs observent que ceux-ci sont régulièrement « à côté de la plaque ». Un commentaire fuse alors régulièrement, teinté de colère : ceux qui les ont inventés ne connaissent pas le « réel » ; ils « planent complètement ». Les objectifs à réaliser, les catégories de pensée et d’action, les étapes de réalisation comme les méthodes de contrôle s’avèrent être maladroits en situation. Ils sont alors jugés, non sans émotion, peu efficaces, ou même source d’un grand gâchis – de temps, d’énergie, d’intelligence, de matière et même d’argent. Cette critique sociale est quasi unanime – jusque et y compris chez les planneurs eux-mêmes, lorsqu’ils doivent travailler avec les dispositifs conçus par d’autres.
Or, dans ce mode d’encadrement, du fait de la distance topographique, organisationnelle et sociale, il n’est pas possible d’interagir avec les prescripteurs. Les objectifs, même inatteignables, les procédures mêmes contre-productives, comme les discours lénifiants sur la « conduite du changement » deviennent indiscutables. Face à un dispositif, il n’est pas possible de les contester, d’arranger, d’arrondir, ou d’inventer des manières de faire autrement. C’est ce qu’expriment les insultes ou même petites claques infligées de manière si dérisoire à des ordinateurs, par exemple, lorsqu’ils imposent les finalités et modalités de l’action humaine, avec maladresse ou injustice. La renormalisation et la régulation au fil de l’activité, cette participation ordinaire à la vie politique comme à l’efficacité, sont ici déniées ; à ceci s’ajoute l’expérience d’être sans cesse entravé, voire d’être contraint à mal travailler comme à tricher avec le système, aux dépens de l’efficacité et de la qualité.
Enfin, ce management par les dispositifs exige un (auto)contrôle croissant. De plus en plus, les employé.es doivent rendre compte sous des formes quantifiées : ils et elles doivent renseigner des tableaux, cocher des cases, mesurer des ratios. Ce reporting chronique, à tous les niveaux, est vécu comme une tâche supplémentaire fastidieuse, qui vient mordre sur le temps dédié au « vrai travail », c’est-à-dire à la production elle-même. Cette nouvelle bureaucratie néolibérale (Hibou, 2012) diffusée au nom de la productivité et de « l’excellence » réduit l’efficacité, la justesse et la performance, d’après celles et ceux qui l’expérimentent. Cette situation est vécue comme insensée et pathogène : « on est fous de travailler comme ça », « on va péter un câble »… : autant d’expressions ordinaires qui établissent un lien entre l’activité ainsi encadrée par les dispositifs et la santé.
Ce management désincarné contribuerait donc à produire ce que les enquêtes quantitatives sur les conditions de travail mesurent : l’intensification de l’activité, la perte d’autonomie alliée au déficit de soutien de proximité, la difficulté à produire un sens dans son emploi, l’importance des maladies professionnelles… Bref, une dégradation des conditions sociales pour déployer une activité sensée dans l’emploi.
Comment comprendre la prolifération de dispositifs jugés contre-productifs et pathogènes ?
La critique sociale de ce management par les dispositifs dit donc qu’il joint l’inutile au désagréable. Les dirigeants eux-mêmes sont dubitatifs quant à sa performance réelle et vilipendent régulièrement la bureaucratie dans leurs organisations.
Pourtant, les dispositifs managériaux continuent d’être diffusés dans toutes les grandes organisations quel que soit le secteur. Ainsi, le lean management est « appliqué » dans l’industrie automobile (cf la contribution de Juan Sebastian Carbonell) comme dans la magistrature, par exemple. De même, des dispositifs standardisés de GRH, de communication et de « change management », à l’instar des méthodes de contrôle de gestion ou de marketing se retrouvent avec régularité dans le public et le privé, l’industrie et les services, et même l’agriculture. Les mêmes « solutions » informatiques sont aussi vendues quels que soient le secteur de production et les métiers.
Pour comprendre le succès de ce management par les dispositifs malgré la forte critique sociale dont il fait l’objet, nous pouvons regarder ces dispositifs en tant que marchandises vendues et achetées par des planneurs qui, eux, ont des enjeux sur leur marché de l’emploi.
Des offreurs de dispositifs se pressent pour les vendre aux dirigeants des organisations : des consultants aux spécialités diverses, suivis des vendeurs de systèmes informatiques, des formateurs à ces méthodes et autres coachs viennent proposer leurs services. Notons que ces salariés ont pour mission d’accroître d’abord la profitabilité de leur propre entreprise. Or la standardisation de l’offre, cette « industrialisation du conseil » (Vilette, 2003,p.49) est une clé de leur productivité.
Les acheteurs de dispositifs – majoritairement des directeurs – cherchent des solutions aux multiples problèmes qui surgissent dans leur organisation. Pour cela, ils ont besoin de recourir à des supports qui font autorité, ce qui les « dispense de responsabilité et évite les accusations de négligence » (Meyer et Rowan, 1977). Il s’agit aussi de montrer qu’ils « font des choses » lors de leur passage comme directeurs dans l’organisation. Enfin, ils doivent rassurer leur employeur (le conseil d’administration, ou un autre directeur de rang supérieur) en ayant recours à des démarches et méthodes inattaquables, c’est-à-dire validées par d’autres. Ces trois forces poussent à l’achat de dispositifs vendus comme « innovants » bien qu’ils aient déjà été appliqués ailleurs avec succès – d’après les vendeurs. Les dirigeants préfèrent alors imiter les autres (Di Maggio et Powell, 1983) en achetant les dispositifs dernier cri sur le marché des dispositifs managériaux. Ceci explique leur diffusion phénoménale dans des organisations pourtant incomparables.
Sur ce marché du management, l’innovation est perpétuellement entretenue par les offreurs, pour assurer le renouvellement des produits. Chaque nouveau produit promet de corriger les avanies du précédent, sans que celles-ci ne semblent inquiéter le marché lui-même. Mais l’extension du marché des dispositifs tient aussi au zèle des planneurs dans leur tâche. Regardons alors celle-ci et son lien avec les dynamiques de carrière.
Comment peut-on être planneur ?
Contrairement aux managers de proximité, également chargés d’améliorer la performance, les planneurs sont dans l’impossibilité, au quotidien, de voir, entendre, sentir et expérimenter ce et ceux qu’ils encadrent pourtant via leurs dispositifs. Cette situation, bien que prescrite et revendiquée, est vécue comme une difficulté : comment faire pour organiser, définir, rythmer, contrôler des tâches et des humains avec finesse, sans pouvoir compter sur une connaissance de la situation et sur une proximité ?
Simultanément, leur tâche est aussi vécue comme ingrate. Les planneurs sont chargés d’« optimiser », pour le bénéfice d’un tiers, l’activité concrète des salariés et consommateurs dans le sens d’une productivité toujours plus grande et d’une extension du marché. Leur mission consiste le plus régulièrement à dégrader les conditions d’emploi, à automatiser, délocaliser et intensifier l’activité concrète, afin de satisfaire les critères du travail abstrait. Cette place n’est donc pas confortable socialement, et est même citée régulièrement comme indésirable par les planneurs eux-mêmes.
Leurs tâches se présentent donc comme impossibles techniquement et inconfortables socialement. Pourtant, les planneurs partagent une norme sociale explicite : celle de « travailler beaucoup », et d’être très « engagés ». Il est normal dans ce milieu, de se vanter de « travailler trop » et d’être très affairé.
L’observation montre que ces obstacles fonctionnels et moraux sont surmontés par une taylorisation de leurs propres tâches. Chaque dispositif vient avec une sorte de mode d’emploi pour sa mise en application et son acceptabilité sociale – le plus souvent en faisant appel à la « participation » des autres employé.es. Il permet de confier aux plus jeunes, formés à la manipulation d’abstractions sous contrainte de temps mais sans métier ni expérience, des tâches simples : faire des entretiens ou des formations standardisées à la chaîne, réaliser des calculs sur un tableau Excel, remplir des cases, suivre une procédure, produire des analyses ponctuelles avec des méthodes prescrites, « pondre » des diapos… Des chefs de projets ou de missions les encadrent. Ils ont pour tâche de réaliser la mise en place d’un dispositif dans un délai et avec un budget généralement qualifié de très « serré ». Pour cela, ils distribuent les tâches, les prescrivent, contrôlent et assemblent. Ils rendent des comptes au niveau dit « politique » ou « stratégique » : des directeurs de l’organisation ou de prestataires de services qui vendent ou achètent les dispositifs dans un réseau social étroit.
Cette organisation rationalisée du travail des rationalisateurs est d’autant plus productive qu’elle est fondée sur une méconnaissance des métiers, des situations concrètes et des gens. Rester dans la méthode et l’abstraction des chiffres et des lettres est analysé par les planneurs comme une condition pour tenir la cadence de leur propre tâche. Le surgissement de nuances ou de diversité concernant les situations de « terrain », comme la connaissance sensible des effets de ces dispositifs sur l’activité et l’emploi des salariés compliquent leur propre tâche. Rester du côté de l’abstraction permet de délester le monde de sa matérielle gravité, de sa complexité et de ses ambivalences. C’est une réponse pratique pour réaliser avec efficacité et légèreté la tâche de planneur.
Cette posture est reconnue sur le marché des carrières et des emplois de planneurs. Les méthodes de recrutement comme les critères d’évaluation le confirment : la dextérité dans le maniement d’abstractions alliée à la capacité à maintenir éloignée la pensée sur leurs dimensions concrètes est une norme professionnelle valorisée, tant leur vraie spécialité, affirment les planneurs, c’est la « méthode ».
L’engagement dans leur tâche ne peut s’expliquer ni par le salaire, ni par la menace de licenciement. L’écoute clinique indique que s’ils sacrifient alimentation, sommeil, week-end et parentalité, c’est qu’ils et elles ont le sentiment d’être « pris au jeu », et ce dans les deux sens du mot : comme « game », c’est-à-dire compétition excitante – contre des concurrents, contre la montre… –, mais aussi comme « play », c’est-à-dire pour le plaisir d’exercer son intelligence sur des problèmes, jugés « marrants » et comparables à des jeux de sudoku par exemple. Ce cadrage ludique de la tâche dans l’emploi est bien connu des sociologues du monde ouvrier. Donald Roy (1959) et Mickael Burawoy (2008) l’ont observé chez ceux qui sont soumis à une tâche répétitive sous contrainte de quota. Bourdieu (1997) retrouve ce phénomène dans l’activité scolastique. Chez les cadres également, cette stratégie de défense est connue (Pagès et Al. 1979 ; Dejours, 1998 ; Boussard & Dujarier., 2017).
Les tâches des planneurs ont en effet une temporalité de jeu, en ce que les « prestations », « missions », « deal » et « projets » se succèdent comme des parties, avec leurs scores ou gagnants, et toujours cette possibilité de rejouer. Le rapport subjectif à l’activité est aussi celle du jeu : un engagement total, « corps et âme », conjugué à une indifférence au hors-jeu (ce que la distance permet), et à une capacité de détachement immédiate à l’activité (ce que les mobilités expriment). En outre, le succès d’une « partie » dépend exclusivement du jugement des pairs joueurs, sur des critères internes au groupe des planneurs : ici, il s’agit d’avoir réalisé un « beau » modèle ou des présentations séduisantes, d’avoir « innové », d’avoir tenu le délai et le budget dans la mise en place d’un dispositif, et réussi cela sans « vagues » sociales…
Ce cadre ludique construit et maintenu collectivement est fonctionnel pour arriver à réaliser les tâches de planneur, de manière rapide. L’employeur bénéficie alors, de la part de ces salariés d’un zèle qu’aucune contrainte ou même incitation financière ne pourraient générer. Comme pour les ouvriers, l’introduction du jeu dans l’activité, par celles et ceux qui la réalise, participe à accroître la productivité et donc l’exploitation, tout en masquant les rapports sociaux (Burawoy, 2008).
En somme, la pertinence, la performance ou l’utilité du dispositif lui-même n’est pas le critère d’évaluation des planneurs pour faire carrière. Ce qui compte, pour être embauché et promu, c’est plutôt de démontrer que l’on sait « lancer des (gros) projets », si possible de belle envergure et évidemment « innovants ». Si jouer le jeu est une condition pour faire carrière dans les fonctions de planneurs, c’est avec deux principaux revers : la règle du jeu ne tient qu’à condition de restreindre les liens sociaux aux joueurs, les seuls à ne pas la questionner, d’une part ; et il s’effondre lorsque le réel les rattrape. Le plus souvent lorsque le corps se rebiffe ou s’épuise. Un tiers des planneurs dit que le principal risque professionnel qui menace est la « perte de sens ». Lorsqu’ils ou elles sortent du jeu pour en reconstruire, c’est pour aller hors du monde compétitif et productiviste qu’ils ont contribué à bâtir.
Conclusion
Le management contemporain est caractérisé par le déploiement de dispositifs et leur cumul chaotique. Ils transforment notre monde matériel, social et psychique. La critique sociale, à tous les niveaux, nous dit qu’ils forment une nouvelle bureaucratie, jugée régulièrement insensée, pathogène et peu performante. Son déploiement semble alors paradoxal. La dynamique du marché des dispositifs managériaux, d’une part, et celui des carrières des planneurs, d’autre part contribuent à l’expliquer.
Ce fait social met en tension les tenants d’un « réalisme » économique abstrait, quantifié, et celles et ceux qui évoquent le « réel » concret, qualitatif et complexe. Ce rapport social sans relation trame silencieusement quoiqu’intensément la plupart des pratiques productives actuelles, avec des enjeux de sens, de santé, mais aussi d’écologie. Ce mode d’encadrement de l’action humaine des salariés, citoyens et consommateurs, mais aussi des autres vivants (animaux domestiques, plantes, cellules, forêts…), s’il se présente comme neutre et pragmatique est donc en réalité profondément politique.
---
Consultez les autres textes de la série "Que sait-on du travail ?"
---
Références :
ABRAHAMSON Éric, « Management fashion», Academy of management Review, 21, (1), p. 254-285, 1996.
BOURDIEU Pierre, Méditations pascaliennes, Minuit, 1997.
BOUSSARD Valérie & DUJARIER Marie-Anne, « Up to the financial elites, or Out to the menial world : Figuring out companies as commodities : a key to stay in the M&A sector », Finance At Work, BOUSSARD (dir.), Routtlege, p. 29-41, 2017.
BURAWOY Mickaël, « Le Procès de production comme jeu », Tracés 1, (14), traduction de Calderón, J. A., p. 197-219, 2008.
CASTEL Robert, La métamorphose de la question sociale, une chronique du salariat, Point Seuil, 1995.
DEJOURS Christophe, Souffrance en France. La Banalisation de l’injustice sociale, Seul, « L’histoire immédiate », Paris, 1998.
DI MAGGIO Paul J. & POWELL Walter W, «The Iron Cage Revisited : Institutional Isomorphism and collective Rationality in Organizational Fields», American Sociological Review, 48, p.147-160, April 1983.
DUJARIER Marie-Anne, WOLFF Loup, SCHLAGDENHAUFFEN Régis. Les cadres organisateurs à distance : enquête quantitative et clinique, Rapport de recherche, Association pour l’emploi des cadres (APEC), 2015.
FOUCAULT Michel, Dits et Écrits. Tome 2 : 1976- 1988. Gallimard Quarto, 2001.
HIBOU Béatrice, La bureaucratisation du monde à l'ère néolibérale, La Découverte, Cahiers Libres, 2012.
MEYER John W. & ROWAN Brian, “Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony", American Journal of Sociology, 83 (2), p. 340-363, 1977.
PAGÈS Max, BONETTI Michel, GAULEJAC DE Vincent, DESCENDRE Daniel, L’emprise de l’organisation, DESCLÉE DE Brower, « Sociologie Clinique », (1979) 1998.
ROY Donald, Un sociologue à l'usine, Textes essentiels pour la sociologie au travail, La Découverte, 2006.
VILLETTE Michel, Sociologie du conseil en management, La Découverte / Repères, 2003.