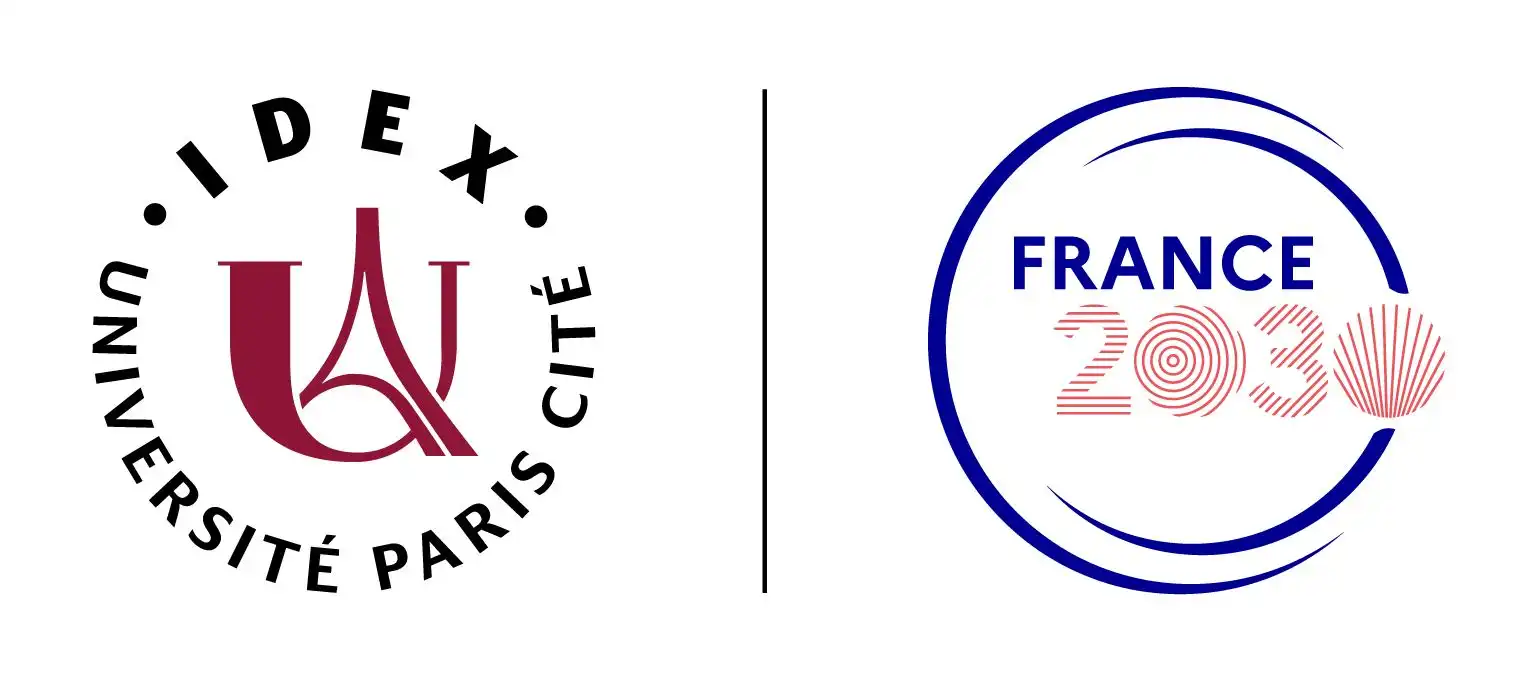Accueil> Les violences sexistes après #MeToo : Entretien avec Catherine Cavalin, chercheuse affiliée au LIEPP
22.11.2022
Les violences sexistes après #MeToo : Entretien avec Catherine Cavalin, chercheuse affiliée au LIEPP
Catherine Cavalin est chercheuse affiliée au LIEPP et sociologue chargée de recherche à l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales (IRISSO) du CNRS. Elle est coauteure de l'ouvrage "Les violences sexistes après #MeToo" publié par les Presses des Mines en novembre 2022, 5 ans après l'émergence du hashtag #MeToo.
Le débat public fait régulièrement référence au hashtag « #MeToo ». En quoi peut-on dire que son apparition a constitué un moment-charnière ?
Savoir si le mouvement #MeToo a constitué une charnière, c’est une question en soi sur #MeToo. Et c’est une question historique. #MeToo est-il nouveau ? Si oui, qu’apporte-t-il de nouveau ? Et par rapport à quelle(s) histoire(s), précisément ? Globalement, disons que #MeToo se discute à la fois comme une rupture et comme un mouvement qui prolonge une dénonciation plus ancienne des violences sexistes et sexuelles. Si bien que la qualification de #MeToo comme « charnière » n’est pas immédiate…
Pour répondre plus en détail, on peut commencer par rappeler quelques éléments de chronologie. Les médias viennent de célébrer ce dernier mois d’octobre comme marquant les cinq ans de #MeToo. En octobre 2017, le producteur de cinéma hollywoodien Harvey Weinstein a commencé de faire l’objet d’accusations pour agressions sexuelles par plusieurs dizaines de femmes, en même temps que le New Yorker et le New York Times enquêtaient sur les faits dénoncés par celles-ci. Alors, l’actrice Alyssa Milano relayait ces dénonciations en publiant le 15 octobre 2017 un tweet invitant les femmes victimes de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle à répondre « me too » à son message, pour révéler ou publiciser les violences dont elles avaient fait l’objet.
Le rappel – ou la véritable commémoration – des cinq ans de #MeToo que les médias viennent de produire célèbre ce moment-là : octobre 2022, à cinq ans de distance d’octobre 2017. Le hashtag #MeToo se double pourtant d’une chronologie plus longue, dans laquelle octobre 2017 apparaît au moins autant comme prolongeant un mouvement précédemment engagé que comme constituant un retournement ou une charnière.
Dix ans auparavant, en effet, l’activiste afro-américaine Tarana Burke avait utilisé cette expression (« me too », sans hashtag à l’époque). Alors, l’intention qu’elle avait placée dans son « me too » était largement analogue à celle qu’ont ensuite exprimée les milliers de tweets et autres messages publiés à partir de l’automne 2017. Dire « #MeToo », c’est exprimer que l’on a vécu l’expérience des violences sexuelles et sexistes, l’énoncer comme une expérience personnelle, et l’énoncer aussi en sachant et en disant que c’est une expérience partagée par une foule innombrable d’autres personnes. D’une certaine façon, le #MeToo de 2017 dont les développements – notamment sur les réseaux sociaux – ne sont aujourd’hui pas encore clos, n’a donc pas publicisé un message totalement neuf. Et par ailleurs entre 2007 et 2017, de nombreux autres mouvements, même sans l’expression « me too » ou le hashtag « #MeToo », avaient aussi très largement publicisé une dénonciation de la prévalence très grande et trop tue des violences sexistes et sexuelles perpétrées par des hommes, de l’impunité dont bénéficiaient ces actes, et de la nécessité d’en porter témoignage pour rendre visible le poids énorme de cette victimation. Cela a par exemple été le cas des « slutwalks » au Canada, des mobilisations féministes latino-américaines Ni Una [muerta] más puis Ni Una Menos dans les années 2010, des mouvements Ni Una menos et Non Una di Meno, en Espagne et en Italie respectivement ou encore, dans l’univers francophone, du blog Vie de meuf lancé en 2010 par Osez le féminisme !, suivi par les innombrables « Paye ta… » (Paye ta schneck, Paye ta blouse, etc.) et autre Chair collaboratrice, sites internet dédiés ou blogs dénonçant la perpétration de violences sexistes et sexuelles dans le cadre du travail. 2017 marque donc à la fois une rupture par l’immensité du déferlement des témoignages, et un mouvement venant prolonger des dénonciations dont l’expression « me too » énoncée par Tarana Burke en 2007 était une manifestation parmi d’autres.
Plus en amont, bien évidemment, #MeToo s’inscrit dans l’histoire longue des féminismes et de ses « vagues » historiques, particulièrement dans la continuité des deuxième et troisième vagues (Pavard 2017) qui ont toutes deux promu une dénonciation des violences fondées sur le genre et comme instrument d’inégalité entre les sexes. Même sans se référer explicitement à l’histoire des féminismes, c’est aussi cette profondeur temporelle en amont de #MeToo qu’évoque Vanessa Springora, l’une des figures marquantes de #MeToo lorsqu’elle écrit : « On le sait désormais, cette vague n’est pas née en octobre 2017 à Hollywood, et ne se limite pas à une déclinaison de hashtags. C’est un raz-de-marée qui vient de loin, une onde sous-marine porteuse de toutes les voix qui, à chaque décennie, ont le courage de raconter le vécu traumatique de l’abus sexuel, malgré les risques encourus : le mépris, l’humiliation, l’inversion du rapport bourreau-victime. La douche froide est arrivée lorsqu’il a bien fallu se confronter à une réalité que personne ne voulait voir : le caractère systémique des violences sexuelles, l’impunité et la loi du silence qui autorisaient la perpétuation de ce système » (Springora 2022) .
La continuité historique de la cause défendue se discute toujours, cependant, en regard de sa discontinuité. Les vagues féministes peuvent être considérées à la fois comme le prolongement historique toujours recommencé des féminismes, en même temps qu’un renouvellement si sensible de leurs formes, de leurs contenus, et pour partie de leurs actrices que l’on peut aussi considérer qu’elles sont en rupture les unes par rapport aux autres. Spécifiquement dans le cas de #MeToo, la nouveauté de l’expression numérique des témoignages individuels (par les blogs, les sites et l’ensemble des canaux qu’autorise l’usage des réseaux sociaux) incite fortement à traiter #MeToo comme un moment-charnière. Comme le montrent Josiane Jouët, Katarina Niemeyer et Bibia Pavard, en changeant les modalités de la lutte sociale, l’usage du numérique modifie aussi potentiellement le contenu et les actrices de cette lutte. La lutte sociale, au moins pour partie, devient une « campagne de communication ». Et l’usage de moyens de communication qui précisément peuvent donner la parole à des millions de personnes prend un sens tout particulier, au sein de luttes féministes qui depuis des décennies cherchent à promouvoir la prise de parole par les femmes (Jouët, Niemeyer, et Pavard 2017, 25).
Alors précisément, en quoi le numérique a-t-il changé la façon dont le débat public aborde les violences sexistes et sexuelles ?
Les toutes premières lignes de l’ouvrage que j’ai codirigé avec Jaércio da Silva, Pauline Delage, Irène Despontin Lefèvre, Delphine Lacombe et Bibia Pavard présentent le hashtag #MeToo comme un hashtag « total ». L’idée contenue dans ce caractère de « totalité » du hashtag est une façon de répondre à votre question. #MeToo a cumulé et continue de cumuler, dans ses résurgences toujours actives (#MeTooInceste, #MeTooGay, etc.), de nombreuses caractéristiques des ressorts et des effets que produisent les réseaux sociaux. #MeToo a été immédiatement viral et immédiatement transnational, d’abord amplifié par l’usage de l’anglais puis relayé par de nombreuses déclinaisons nationales et non anglophones (#YoTambién en Espagne et dans l’hispanophonie, #IamNotAfraidToSpeak en Russie, #WoYeShi en Chine, #BalanceTonSaïSaï au Sénégal dans le prolongement de #balancetonporc en France, etc.). #MeToo a également été immédiatement transformateur, en exprimant une volonté impérieuse de changement radical de la société et des rapports de pouvoir qui la gouvernent. Cette idée d’une radicalité et d’une urgence des revendications portées par #MeToo se trouve dans la tribune de Vanessa Springora récemment publiée par Le Monde, déjà citée précédemment : « […] au-delà de ces révélations, #metoo, dans un bouillonnement ininterrompu, a ouvert la brèche à bien d’autres sujets. Rarement on aura vécu une période d’effervescence intellectuelle aussi féconde, et vu les questions intimes s’imposer avec autant de force dans le champ politique » (Springora 2022) . Dénonciation des agressions subies, revendication de la légitimité de la parole des victimes ; mais aussi critique radicale de l’inaction des pouvoirs publics et de l’impunité des agresseurs ; mais encore, en allant plus loin, politisation à l’extrême de ce que Vanessa Springora désigne comme « les questions intimes ».
On retrouve ici le débat sur la continuité et la solution de continuité entre #MeToo et ce qui l’a précédé. Par cette publicisation et cette politisation de l’intime, #MeToo se place dans la ligne du slogan féministe des années 1970 : « The personal is political ». Il prolonge également le mouvement d’ampleur qui, depuis la fin des années 1970 et surtout depuis les années 1990, a conduit à de profondes réformes législatives dans des domaines précédemment cantonnés à l’intime, hors d’atteinte du politique (réformes des lois définissant le viol, statut de conjoint ou ex-conjoint comme circonstance aggravante des violences commises, etc.). Mais avec #MeToo, ce sont des millions de voix de victimes qui l’énoncent, qui interagissent, et qui ne sont pas seulement des voix de femmes victimes, et cela en change la portée.
D’un autre côté, si le débat public sur les violences sexistes et sexuelles est transformé par l’usage du numérique, c’est aussi parce qu’en réaction à #MeToo, on assiste à des réactions hostiles et des résistances. C’est ce que l’on désigne souvent comme un « backlash », en reprenant l’expression proposée par Susan Faludi (Faludi 1993) pour décrire un retour de bâton connu à d’autres moments de l’histoire des féminismes. Cela consiste dans des réactions auto-déclarées antiféministes et qui remettent en cause non seulement la légitimité de la parole des victimes, mais aussi celle du mouvement tout entier (#Me Too va-t-il « trop loin » ?), dans un contexte de « brutalisation des débats » (Badouard 2017) . Le chapitre écrit par Kaitlynn Mendes (Mendes 2022) dans l’ouvrage que nous avons tout juste publié montre en particulier comment les personnes qui témoignent sur les plateformes numériques des agressions sexistes et sexuelles qu’elles ont subies peuvent faire l’objet de dénigrements et de cyberharcèlement. Ces analyses rejoignent de nombreuses situations que les médias nous donnent souvent à connaître, soit à propos d’interactions entre personnes inconnues du public soit à propos de personnes de grande notoriété qui contribuent à entretenir le backlash. Donald Trump, avant, pendant ou depuis la fin de son mandat comme président des États- Unis d’Amérique, multiplie ainsi les propos obscènes sur sa supposée légitimité à disposer du corps des femmes en tant qu’homme puissant, tout en tournant en dérision les dizaines de plaintes ou révélations de femmes qui, depuis les années 1970, rapportent avoir subi des agressions à caractère sexuel de sa part (Levine et El-Faizy 2019) . Ces « plaisanteries » vulgaires et insultantes sur la douleur des victimes ou l’inégalité du rapport de forces dans lequel elles se trouvent par rapport à leur agresseur reçoivent régulièrement le soutien des supporters du camp trumpien. À ce titre, le backlash dépasse des cas individuels qu’on pourrait décrire comme singuliers (même si très symboliques, comme dans le cas de Trump), et peut s’analyser dans une réflexion plus large sur la polarisation des luttes au sein des régimes démocratiques (sans se limiter aux États-Unis). Autour de #MeToo et au- delà des cas individuels d’auteurs, le backlash s’exprime comme un rejet global de comportements décriés comme injustement délateurs, et en conséquence comme un rejet de la légitimité de la parole des victimes présumées « diffamantes ». Tous ces phénomènes connaissent aussi une diffusion virale par les plateformes numériques.
Comment les analyses des violences sexistes et sexuelles par les sciences sociales ont-elles été impactées par le hashtag #MeToo ? En quoi le # a-t-il fait évoluer l’analyse des violences sexistes et sexuelles en sciences sociales ?
Pour apporter des éléments de réponse à cette question, on peut tout d’abord prolonger la réponse précédente. Pour les sciences sociales (ici l’histoire, l’anthropologie et la sociologie), la question de la nouveauté introduite par l’usage des moyens d’expression numérique fait interagir nouvellement l’étude des médias, l’analyse des mouvements sociaux et celle des féminismes. Par exemple, on peut se demander dans quelle mesure les outils numériques renouvellent les mouvements sociaux mais aussi, tout autant, dans quelle mesure c’est la dynamique propre des mouvements sociaux qui produit des usages spécifiques de ces outils. En particulier, alors que l’expression de « féminisme numérique » connaît aujourd’hui un usage croissant, elle constitue un objet à part entière d’interrogation pour les sciences sociales (dans le prolongement des questions mentionnées plus haut sur les « vagues » féministes, leurs continuités et leurs ruptures). On peut se demander dans quelle mesure, également, les plateformes elles-mêmes façonnent les causes défendues à travers l’imposition d’un format, d’un langage et de la diffusion d’une forme de mise en récit, autrement dit d’un « jargon » pour reprendre l’expression utilisée dans les travaux sur les réseaux sociaux.
Pour ces trois mêmes sciences sociales, une autre question importante émerge avec #MeToo : celle de la catégorisation « femmes ». Dans le prolongement de la troisième vague féministe (qui a vu converger les causes homosexuelles et féministes, et s’ouvrir le périmètre des militant.e.s aux groupes lesbiens, gays, bi et trans) et de la quatrième vague (un intérêt public croissant pour les féminismes en même temps que le développement d’un activisme numérique chez celles et ceux qui se déclarent relié.e.s aux féminismes, d’une manière ou d’une autre), #MeToo questionne encore davantage la centralité de la catégorie « femmes » comme objet de luttes. La diversité revendiquée des identités de genre parmi les populations contribuant au développement du mouvement dissout – et conteste en partie – la spécificité de la cause des femmes, en étendant considérablement la dénonciation de rapports de pouvoir liés aux rapports de genre et à la sexualité. Globalement, toutefois, il ne faut pas oublier que les dénonciations portent quasi-exclusivement sur des auteurs de violences qui sont des hommes.
Entre autres nombreuses questions auxquelles #MeToo confronte les sciences sociales, on peut également mentionner la place et le rôle très structurant que joue le monde du travail dans la dénonciation des violences sexistes et sexuelles. Il s’agit de politiser des questions relatives à l’intimité. Certes, des relations que l’on peut définir de prime abord comme intimes sont mises à jour par #MeToo : relations violentes dans le couple, agressions sur les plus jeunes – filles et garçons – au sein de la famille dénoncées comme incestes, etc.Mais la survenue des violences dans les relations de travail, souvent énoncées par #MeToo de manière sectorielle (#MeToo dans le cinéma, #MeToo dans le sport, #MeToo à l’hôpital, etc.), tient une place cruciale qui questionne en particulier la possibilité de survenue de ces violences dans un cadre qu’en principe le droit encadre très strictement. Ainsi, cela pousse à questionner la potentielle insuffisance des changements législatifs qui, depuis les années 1990, ont cherché à mieux définir et sanctionner les comportements de harcèlement sur les lieux de travail et dans les relations de travail. En outre, se pose la question méthodologique toujours renouvelée pour les sciences sociales devant le caractère fuyant de la notion de violence(s) : comment apposer une étiquette homogène « violences » sur des agressions qui sont dénoncées comme autant de situations spécifiques à des relations de travail contextuelles (relations hiérarchiques et poids professionnel et symbolique du genre dans l’Église catholique, travail avec et sur le corps dans l’activité professionnelle du théâtre, du cinéma ou du sport, etc.) ?
Enfin, et sans épuiser les questions, un autre champ de travail important – lui aussi méthodologiquement difficile – s’ouvre aux sciences sociales avec #MeToo. Comme le montre le chapitre de Kaitlynn Mendes précédemment mentionné, la prise de parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer des violences sexistes et sexuelles subies n’est pas également partagée. À l’évidente inégalité générationnelle qui donne à l’agilité numérique des plus jeunes un accès plus aisé aux outils numériques, s’ajoutent des inégalités de race et de classe. Celles-ci paraissent patentes, au bénéfice de la parole prise par des femmes blanches et bien dotées du point de vue économique ou culturel. Ces inégalités demeurent toutefois difficiles à mesurer, du fait même de la nature des expressions en ligne, souvent anonymes ou difficilement caractérisables d’un point de vue social.
En matière d’inégalités raciales, on rappellera que celles-ci ont d’ailleurs, depuis les années 1960, déjà divisé les luttes féministes (en particulier aux États-Unis comme l’a dénoncé le black feminism (Davis 1983) ). Dans le mouvement #MeToo, ces inégalités se manifestent à nouveau, comme le rapporte le témoignage de Tarana Burke (Burke 2021) , lorsqu’elle explique la stupeur dans laquelle l’a plongée l’émergence des témoignages portés par les réseaux sociaux sous le hashtag #MeToo en octobre 2017. Loin de considérer immédiatement que le message qu’elle-même portait en tant qu’activiste afro-américaine depuis des années était en train de connaître une reconnaissance inouïe, elle déclare avoir été profondément perturbée par la manifestation en masse de ces témoignages. Outre le fait que Tarana Burke affirme avoir ressenti de la crainte pour toutes ces personnes qui, en prenant la parole publiquement, s’exposaient sans protection et sans accompagnement pour le faire, elle relate avoir été choquée par le fait que les victimes faisant usage du hashtag #MeToo étaient pour beaucoup d’entre elles des stars du cinéma hollywoodien. Leur reconnaissant le statut de victimes de violences sexuelles, Tarana Burke rappelle pourtant à quel point les situations vécues par ces innombrables personnes lui ont paru éloignées des réalités (raciales et donc aussi sociales) des violences sexuelles subies au sein des communautés afro-américaines dans lesquelles elle travaille comme promotrice de programmes artistiques destinés aux plus jeunes et comme éducatrice (“Other than these women being survivors of sexual violence, none of what was happening in Hollywood felt related to the work I had been entrenched in in my own community for so many years. Seeing "me too", the phrase I had built my work and purpose around, used by people outside of that community, was jarring.” (Prologue de (Burke 2021))
Comment le #MeToo a-t-il transformé ou fait évoluer l’action publique sur les violences sexistes et sexuelles ?
Dans l’ouvrage que nous venons de publier, il est question de l’action publique à de nombreuses reprises, souvent au titre du contexte des événements violents survenus. Et dans deux chapitres, l’action publique fournit directement la matière à réflexion. Chloé Mour et Linda Sehili s’intéressent (Mour et Sehili 2022) à l’effectivité de l’action de l’État employeur contre les violences sexistes et sexuelles dans les relations professionnelles du milieu de l’enseignement et de la recherche d’une part, et au Ministère de l’Économie et des Finances d’autre part. Alors que les protocoles d’accord et autres outils législatifs se sont multipliés dans l’administration dès avant #MeToo, ces deux autrices montrent que l’activation de ces instruments passe souvent « par le bas », du fait de l’action de personnes qui se mobilisent spécifiquement sur cette cause, mais sans que l’administration en tant que telle s’engage véritablement. Dans ce contexte, également compliqué par une relative disette budgétaire, les sanctions à l’encontre des auteurs restent difficiles à mettre en œuvre.
Le chapitre signé par Catherine Le Magueresse (Le Magueresse 2022) concerne pour sa part la sphère juridique, domaine qui a été le plus vivement interpellé à l’occasion des cinq ans de #MeToo dans la presse, à la fois comme univers professionnel et secteur des politiques publiques : univers professionnel questionné comme lieu de survenue de violences en son sein même (Défenseur des droits et al. 2018) , et comme lieu de représentations et de normes potentiellement en retrait des revendications portées par #MeToo, en particulier sur le problème de l’impunité des auteurs. On se souvient de la radicalité avec laquelle Adèle Haenel, témoignant auprès de Mediapart des agressions subies au cours de son adolescence, concluait : « La justice nous ignore, on ignore la justice » (Turchi 2019) . Pour établir un bilan de ce que #MeToo a pu (ou non) changer dans ce qu’elle nomme « le monde du droit », Catherine Le Magueresse prend en compte de nombreuses dimensions. Elle interroge des professionnels du droit (avocates, magistrates mais aussi universitaires), s’intéresse à la jurisprudence et aux textes doctrinaux, inclut dans son analyse des comptes rendus de procès publiés dans la presse, et examine les travaux parlementaires qui depuis 2018 ont porté sur les violences sexuelles. Son bilan est contrasté : entre une sensibilité croissante mais encore limitée des avocat.e.s et des magistrat.e.s à cette cause, de réels effets de #MeToo sur l’activité législative entre 2019 et 2021, et la difficulté à évaluer avec un recul suffisant la mesure dans laquelle des condamnations s’appliqueraient aujourd’hui avec une plus grande fermeté. Les forces contraires aux effets de #MeToo sur la justice sont nombreux, explique l’autrice, à la fois parce que la politique pénale reste sous-dotée, que la jurisprudence de la Cour de cassation est pour partie invisible et pour partie contradictoire et parce que plus largement le backlash est bien réel, qui peut se manifester par la multiplication des embûches – déjà nombreuses – dans le parcours des victimes de violences sexistes et sexuelles auprès de la Justice.
Ce type de conclusion rejoint sur le fond les contradictions ou les sources de blocages mises en évidence par Solenne Jouanneau (Jouanneau 2022) à propos de la conception et de la mise en œuvre de l’ordonnance de protection en cas de relations violentes au sein du couple. Une juridicisation et une judiciarisation originellement appuyées sur des bases féministes se trouvent finalement confiées aux juges aux affaires familiales qui éprouvent des réticences certaines à prendre des décisions sévères à l’encontre des conjoints et pères violents. La charge de la preuve continue de reposer lourdement sur les femmes victimes et, malgré des politiques publiques plus largement nourries d’intentions et d’outils d’inspiration féministe, la gestion familialiste de la protection des femmes victimes débouche aujourd’hui sur un bilan très en demi-teinte.
Les années qui ont précédé #MeToo puis celles qui suivent ce mouvement, marquées par un renouveau du droit et une judiciarisation des violences perpétrées en particulier dans l’intimité, laissent les politiques publiques encore au milieu du gué.
Propos recueillis par Ariane Lacaze.
Références :
- Badouard, Romain. 2017. Le désenchantement de l’internet. Désinformation, rumeur et propagande. Présence/Questions de société. Limoges: FYP Editions.
- Burke, Tarana. 2021. Unbound. My Stry of Liberation and the Birth of the Me Too Movement. Flatiron Books: An Oprah Book.
- Davis, Angela Y. 1983. Women, Race & Class. New York: VIntage Books. A Division of Random House.
- Défenseur des droits, Nathalie Bajos, Catherine Cavalin, Martin Clément, et Manon Brocvielle. 2018. « Conditions de travail et expériences des discriminations dans la profession d’avocat·e en France ». Paris: Défenseur des droits.
- Jouanneau, Solenne. 2022. « Une protection sous conditions. Les magistrat·es de la famille face à la lutte contre les violences masculines dans le couple ». Mémoire original présenté pour l’Habilitation à Diriger des Recherches, Paris: Université de Paris.
- Jouët, Josiane, Katarina Niemeyer, et Bibia Pavard. 2017. « Faire des vagues. Les mobilisations féministes en ligne ». Réseaux, n o 201: 21‑57.
- Le Magueresse, Catherine. 2022. « À la recherche d’un effet #MeToo sur le monde du droit in Catherine Cavalin, Jaércio da Silva, Pauline Delage, Irène Despontin
- Lefèvre, Delphine Lacombe, Bibia Pavard (dir.) ». In Les violences sexistes après #MeToo, 97‑112. Paris: Presses des Mines.
- Levine, Barry, et Monique El-Faizy. 2019. All the President’s Women: Donald Trump and the Making of a Predator. Hachette UK.
- Mendes, Kaitlynn. 2022. « #MeToo, selfies et mèmes : une exploration des récits numérisés des violences sexuelles in Catherine Cavalin, Jaércio da Silva, Pauline Delage, Irène Despontin Lefèvre, Delphine Lacombe, Bibia Pavard (dir.) ». In Les violences sexistes après #MeToo, 23‑36. Paris: Presses des Mines.
- Mour, Chloé, et LIinda Sehili. 2022. « Après #MeToo,l’État est-il devenu un employeur exemplaire ? in Catherine Cavalin, Jaércio da Silva, Pauline Delage, Irène Despontin Lefèvre, Delphine Lacombe, Bibia Pavard (dir.) ». In Les violences sexistes après #MeToo, 113‑27. Paris: Presses des Mines.
- Pavard, Bibia. 2017. « Faire naître et mourir les vagues : comment s’écrit l’histoire des féminismes ». Itinéraires [En ligne], 1‑17.
- Springora, Vanessa. 2022. « Le soutien du mouvement #metoo, cette solidarité invisible, anonyme, m’a littéralement portée ». Le Monde, 14 octobre 2022.
- Turchi, Marine. 2019. « #MeToo dans le cinéma : l’actrice Adèle Haenel brise un nouveau tabou ». Mediapart, 3 novembre 2019. https://www.mediapart.fr/journal/france/031119/metoo-dans-le-cinema-l-actrice-adele-haenel-brise-un-nouveau-tabou.