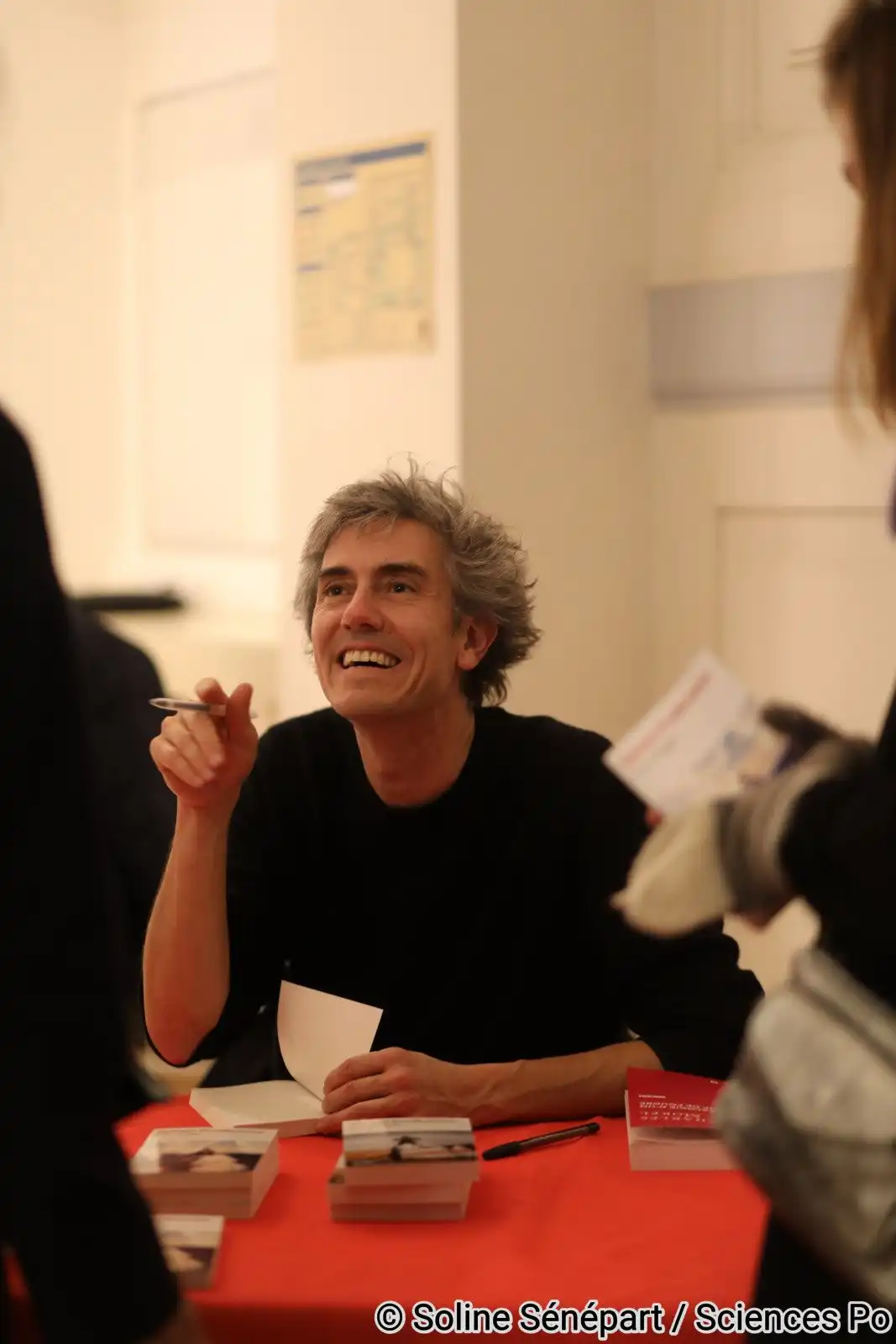Accueil>Littérature : la Chaire d'Écriture accueille Sylvain Prudhomme
11.02.2025
Littérature : la Chaire d'Écriture accueille Sylvain Prudhomme
La Chaire d'Écriture de la Maison des Arts & de la Création accueille Sylvain Prudhomme pour le semestre de printemps 2025. Le passage de relais avec sa prédécesseure, Jakuta Alikavazovic, a eu lieu le 6 février. Cet échange était introduit par Laurence Bertrand Dorléac et modéré par Frédéric Gros.
Auteur de romans et de reportages, Sylvain Prudhomme s'est régulièrement inspiré de l'Afrique, continent où il a grandi et travaillé. À travers ses romans, il s’attache à suivre des trajectoires individuelles d’hommes et de femmes façonnés par l’histoire. Collaborant avec des musiciens, il a aussi développé différentes formes de lectures musicales. En 2012, il publie Là, avait dit Bahi, un roman se déroulant entre l’Algérie et la France et composé d’une seule phrase. Puis en 2014, son roman Les Grands nous plonge en Guinée-Bissau, aux côtés d’un célèbre groupe de musique de la fin des années 1970. Suivront Légende (2016), Par les routes (2019) ou encore L’Enfant dans le taxi (2023), acclamés par la critique. Agrégé de lettres modernes, Sylvain Prudhomme est aussi traducteur. Il collabore depuis 2015 à la chronique « Écritures » du journal Libération.
La littérature comme vie augmentée
Après une lecture d'extraits de ses textes par Maia Koubi et Violette Bouteloup, toutes deux ambassadrices de la MAC, Sylvain Prudhomme a donné une leçon inaugurale qui commençait par l'affirmation suivante : « la littérature augmente ma vie ». Il souligne lui-même un usage surprenant du verbe augmenter à l'ère d'une réalité qu'on imagine augmentée surtout par des outils et appareillages technologiques. C'est justement le « miracle de la littérature », « ajouter des éléments virtuels à la réalité de tous les jours » avec des moyens dérisoires : un papier et un crayon suffisent pour faire ce que font lunettes 3D et écrans. La madeleine de Proust surgit lorsqu'on essaie de convoquer un souvenir, la bibliothèque de Babel s'étend sur nos yeux lorsque l'on se trouve devant des rayonnages de livres, et deux hommes sur un banc deviennent soudainement Vladimir et Estragon qui attendent Godot : la littérature projette dans notre réalité ses héros, ses moments, ses objets. « Quand j’écris, je peux explorer tous les possibles, quel autre art permet cette liberté, à si peu de frais ? » Pourtant loin du fantasme transhumaniste, le corps humain est doté, par l'écriture, de facultés démultipliées : le déserter pour habiter les pensées d'autres hommes et femmes et, inversement, accueillir en soi ces personnages, leurs perceptions et leurs points de vue. « C'est cela qu'essaie idéalement de faire la littérature : donner à éprouver la vie vécue. »
La littérature comme vie augmentée
En préparant ce moment, je me suis dit que j'allais jouer le jeu, essayer de me demander sincèrement, après presque 20 ans à écrire et à publier des livres, pourquoi je tenais tant à cette chose qui nous relie toutes et tous ici, la littérature. Pourquoi je vivais au milieu des livres, pourquoi j'étais toujours à en lire, à en acheter, à projeter d'en écrire de nouveaux. Beaucoup de verbes me sont venus : la littérature agrandit la vie ; elle l'intensifie ; elle la déploie ; elle l'aiguise ; elle l'ouvre. Et puis cette expression m'est venue : la littérature augmente ma vie. La littérature augmente nos vies. Au sens le plus concret du mot, c'est ce que je vais essayer de montrer.
La littérature a toujours été là, dans toutes les sociétés, à toutes les époques. Les aèdes, les conteurs, les troubadours, les griots, les bardes. À côté de ceux et celles qui travaillaient, qui géraient les affaires, qui construisaient les villes, qui labouraient les champs, qui faisaient les guerres, il y a toujours eu des hommes et des femmes un peu décalés dont on acceptait qu'ils se soustraient par intermittences aux obligations de la communauté pour effectuer cette opération étrange : essayer de raconter ce que vivaient leurs contemporains ; essayer de dire quelles questions les traversaient, quelles peurs, quelles joies, quels conflits. À côté de la vie vécue, il y a toujours eu ça : la vie racontée, reprise, légendée, bref : la littérature.
C'est sans doute ce qui nous caractérise en tant qu'humains ; à la différence des animaux, nous n'arrivons pas à nous contenter de vivre ; nous avons besoin de mettre des mots sur ce que nous vivons. Nous avons besoin de sens. Désespérément, nous voulons trouver des raisons à ce qui nous arrive. Et pour tenter de trouver ces raisons, nous éprouvons le besoin de dire et redire ce que nous vivons, de reprendre ce vécu, de le déplacer, de le rejouer, de le déplier, de le comprendre. La littérature comme tentative de faire reculer le chaos de la vie, de le rendre habitable, d'y restaurer un minimum de cohérence, de sens, d'intelligibilité– fût-ce dans l'acceptation de l'idée qu'il n'y aura jamais de réponse à nos questions, et que le sens toujours se dérobera.
A priori, quand on parle de « vie augmentée », on est loin de l'univers des livres. Je suis allé voir de plus près les définitions de cette fameuse notion de « réalité augmentée », j'ai trouvé ceci : « technologie d'affichage visuel qui consiste à superposer à la réalité telle que nous la percevons, en temps réel, au moyen d’un écran (téléphone ou tablette) ou de lunettes spéciales, des objets virtuels. ». (Exemple : voir dans son salon un vélociraptor qui chante avec Taylor Swift). Bonne nouvelle : pas besoin de lunettes 3D ni de technologie très poussée. La littérature aussi permet ça. Ajouter des éléments virtuels à la réalité de tous les jours : n'est-ce pas très exactement ce qu'opère à chaque instant la fiction ? Prouesse supplémentaire, elle y parvient avec des moyens dérisoires : de simples signes noirs griffonnés sur du papier, reproductibles à l'infini, indifférents même au support sur lequel ils sont inscrits, des signes dont le pouvoir d'évocation survit même si la main qui les a tracés n'est plus là depuis longtemps. Homère est mort depuis trois mille ans et pourtant ça continue de marcher, je lis les pattes de mouche de n'importe quelle édition de l'Odyssée, même la plus abîmée, même la plus mal imprimée. Et tout de suite Ulysse est là, et avec lui Polyphème, et Circé, et Charybde et Scylla, et les retrouvailles avec la vieille nourrice Euryclée au retour à Ithaque. C'est le miracle de la littérature. Il ne m'arrivera peut-être jamais de voir un vélociraptor qui chante dans mon salon avec Taylor Swift (tant pis, j'essaie de m'habituer à ce renoncement douloureux) – mais dès que je peine à retrouver un souvenir je vois le narrateur de Proust qui trempe la madeleine dans son thé, dès que je rencontre une cabane près d'un étang je pense à Thoreau dans sa forêt de Walden, dès que je vois deux types à la rue qui bavardent sur un banc je vois Vladimir et Estragon qui attendent Godot, dès que j'entre dans une bibliothèque un peu vaste je vois les rayonnages infinis de la Bibliothèque de Babel rêvée par Borges, dès que je regarde une vitrine de boucher je pense aux carcasses que pousse sur un rail Joseph Ponthus dans À la ligne. Hamlet, Don Quichotte, Mme Bovary, Falstaff, Raskolnikov. Les héros de la littérature existent, ils sont là, à jamais ajoutés au monde. Ils ne sont pas du tout irréels, ils existent bel et bien, ils peuplent le monde, nous vivons avec eux, nous pensons à eux, ils nous tiennent compagnie, avec leurs tristesses, leurs victoires, leurs échecs. Ils sont des boussoles qui nous aident à vivre, tout autant que nos amis en chair et en os.
Le fantasme du transhumanisme va sans doute au-delà. Certes. Il rêve d'un corps « augmenté » au sens propre. Un corps aux facultés démultipliées par toutes sortes d'appareillages technologiques, un corps plus endurant, plus adroit, plus puissant, plus véloce. Mais là encore, n'est-ce pas ce que m'offre la littérature ? Quand j'écris je fais ce que je veux. Je vis ce que je veux. Je peux reprendre une histoire d'amour rêvée ou vécue et lui donner une autre issue que celle qu'elle a connue. Je peux jouer à me faire peur, jouer à me faire plaisir. Je peux oser ce que jamais j'aurais le courage de faire dans la vie. Je peux décider que Trump a perdu les élections, le mettre à croupir au pain sec avec Elon Musk au fin fond d'un marécage de Louisiane. Je peux les envoyer tous les deux à l'autre bout de la voie lactée dans une sonde spatiale qui ne reviendra jamais. Quand j'écris je suis libre, je peux tout écrire, explorer tous les possibles, rêver tous les dénouements que je veux. Quel autre art permet cette liberté, à si peu de frais ?
Si je veux, je peux même le quitter, ce corps. Je peux le déserter pour m'en aller séjourner dans d'autres. Je cite Annie Ernaux : « Au fond le but final de l'écriture, l'idéal auquel j'aspire, c'est de penser et sentir dans les autres ». Baudelaire dit à peu près la même chose dans Les Fenêtres, et je me rappelle que ce texte, la première fois que je l'avais lu, avait très fort ému l'étudiant de 18 ans que j'étais, sonnant presque à mes yeux comme un programme : « Par-delà des vagues de toits, j’aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose, et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j’ai refait l’histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant. // Si ç'eût été un pauvre vieux homme, j’aurais refait la sienne tout aussi aisément. // Et je me couche, fier d’avoir vécu et souffert dans d’autres que moi-même ».
Baudelaire parle de fierté, mais il me semble que cela va bien au-delà. Quand je referme un grand livre, qui a effectivement réussi le miracle de me faire vivre et souffrir dans d'autres que moi-même, je ne me couche pas seulement fier. Je me couche agrandi, élargi, plus vaste qu'auparavant, plus riche d'avoir exploré en moi des sentiments nouveaux, vécu des dilemmes insoupçonnés, découvert une complexité de ressorts intérieurs dont je n'avais pas idée. Ce n'est pas seulement ma perception de la réalité qui est changée. C'est ma réalité elle-même. Je vois ce que je n'avais jamais vu, j'éprouve ce que je n'avais jamais éprouvé, et qui pour moi n'existait tout simplement pas. « Les limites de mon langage sont les limites de mon propre monde », dit Wittgenstein. C'est à dire que j'ai beau regarder une forêt, si je ne sais pas le nom des arbres, ce que je vois c'est seulement : beaucoup d'arbres. Si en revanche je sais le nom des arbres, devant la même forêt je vois : des micocouliers, des érables, des noyers, des chênes verts, des chênes blancs, des ormes, des alisiers, des marronniers, des liquidambars, des frênes. Il est inexact de dire que ces arbres étaient là mais que je ne les voyais pas. Si je ne les voyais pas, c'est bel et bien parce qu'ils n'étaient pas là. Je vivais dans une réalité où, à la lettre, ils n'existaient pas.
Avec la littérature je sors de moi, je m'en vais habiter les pensées d'autres hommes et d'autres femmes, j'entre dans leurs raisons, leurs émotions. Inversement je leur fais une place en moi. Je suspends temporairement mes propres raisons pour accueillir les leurs. Migration des âmes. Allers-retours de mon point de vue à celui d'autres que moi. Qui ne voudrait pas cela : une société où chacun ait l'habitude de se mettre à la place des autres, l'habitude d'épouser pour de bon leur vécu, puisque c'est cela qu'essaie idéalement de faire la littérature : donner à éprouver la vie vécue, dans sa dimension la plus sensible, la plus concrète ? La plupart des malentendus, des haines réciproques, des conflits n'en seraient-ils pas instantanément désamorcés ?
La littérature augmente notre vie parce qu'elle nous fait vivre d'autres vies que la nôtre. Elle nous multiplie. Au lieu de n'être que moi, pauvre être solitaire, limité, dérisoire, je deviens cent, je deviens mille. J'ai en moi tous les auteurs et les autrices que j'ai lus, toutes les voix chères que j'ai écoutées dans les livres, avec l'infinie variété de leurs regards, de leurs inflexions, de leurs tons, de leurs grains. J'ai toutes les peines et les joies des personnages avec lesquels j'ai vécu pendant des centaines de pages. Je pense à la chanson The partisan de Leonard Cohen, dont je transforme à peine les paroles : « j'ai changé cent fois de nom / j'ai perdu femme et enfants / mais j'ai tant d'amis / J'ai la littérature entière. » Cette foule est là en moi, et m'accompagne à chaque instant, chaque rencontre, chaque tournant de ma vie. Si je suis amoureux, j'aime avec en moi le souvenir de tous les amours que j'ai vécus dans les livres, j'aime avec les amours de Duras, de Proust, de Tolstoi. Si je dois me battre contre une injustice, je lutte avec le souvenir des mots et du courage de Simone Veil, de Gisèle Halimi, d'Henri Alleg, de Charlotte Delbo, de Zola, d'Asli Erdogan.
Je ne peux m'empêcher de repenser à la vision sur laquelle se referme Farenheit 451 de Ray Bradbury. Effrayés à l'idée que les incendiaires parviennent à mener à bien leur entreprise de destruction de la littérature mondiale, des résistants et des résistantes, pour sauver les livres, se mettent à les apprendre par cœur. Un livre par individu, qui en devient le porteur et le responsable. À partir d'aujourd'hui je serai la Légende des Siècles. Toi tu seras Guerre et paix. Toi tu seras Vendredi ou la vie sauvage, toi toutes les poésies de Louise Labé, toi La Fin de l'homme rouge de Svetlana Alexievitch, toi La vie et demie de Sony Labou Tansi. Ray Bradbury a cette vision bouleversante : des hommes et des femmes devenus livres. Tellement imprégnés par la forêt de mots accueillie en eux qu’ils en viennent à se confondre avec elle. Bien sûr ce n'est qu'une vision. Mais je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'ils ressentent, ces hommes et ces femmes-livres : ça fait quoi, de porter en soi chaque mot de L'Odyssée. De l'avoir tout entière à disposition, avec chaque vers de chaque chant, chaque scintillement de la mer, chaque caprice des vents, chaque tempête, chaque épreuve, chaque ressort des ruses d'Ulysse pour repartir chaque fois ? Ça fait quoi de porter en nous tous les livres que nous avons lus ? Ça ouvre quelles brèches exactement ? Ça lève quels empêchements ? Ça autorise quelles audaces ? Ça se passe de quelle façon précise, cet invisible et vertigineux processus par lequel un livre nous fait grandir, nous fait mûrir, nous modifie, nous émancipe, nous libère.
Je veux terminer là-dessus, en rêvant à ces inconnus de Farenheit 451. Je veux essayer d'imaginer ce qu'ils éprouvent, ce que cela leur fait, de s'être incorporé ces livres, de les porter en eux, pas seulement de les avoir en eux, pas seulement de les posséder, mais d'être devenus ces livres. Être L'amant de Marguerite Duras. Être L'origine de Thomas Bernhard. Être L'art de la joie de Goliarda Sapienza. Être Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Être L'avancée de la nuit de Jakuta Alikavazovic. Être La promenade au phare de Virginia Woolf.
Je vous remercie.
6 février 2025
Revoir le passage de relais de Jakuta Alikavazovic à Sylvain Prudhomme
La Chaire d'Écriture de Sciences Po
Initiative inédite dans le paysage universitaire français, la Chaire d’Écriture a été créée en 2019 pour renforcer l’expression créative des étudiants et leur permettre de développer une réflexion critique et originale. Les deux ateliers d’écritures proposés par Sylvain Prudhomme aux étudiants de Sciences Po s’intitulent Écrire à partir de photographies et Filatures, enquêtes, terrains : écrire à partir du réel.
La Chaire est rattachée à la Maison des Arts & de la Création, qui propose chaque année pas moins de 25 cours aux étudiants de toutes les années de formation. Ces ateliers sont pensés autour de trois axes : l’argumentation, les arts oratoires et l’écriture de création. Elle est l’une des quatre chaires artistiques de la Maison des Arts & de la Création, un projet unique en France lancé début 2023 pour faire dialoguer les sciences sociales et humaines avec les arts sous toutes leurs formes.
La Chaire d’Écriture bénéficie du soutien de la Fondation Simone et Cino Del Duca, de Karen et Michel Reybier et de Céline Fribourg.
Avec le soutien de Chanel et le19M, grands partenaires de la Maison des Arts & de la Création.
En savoir plus :