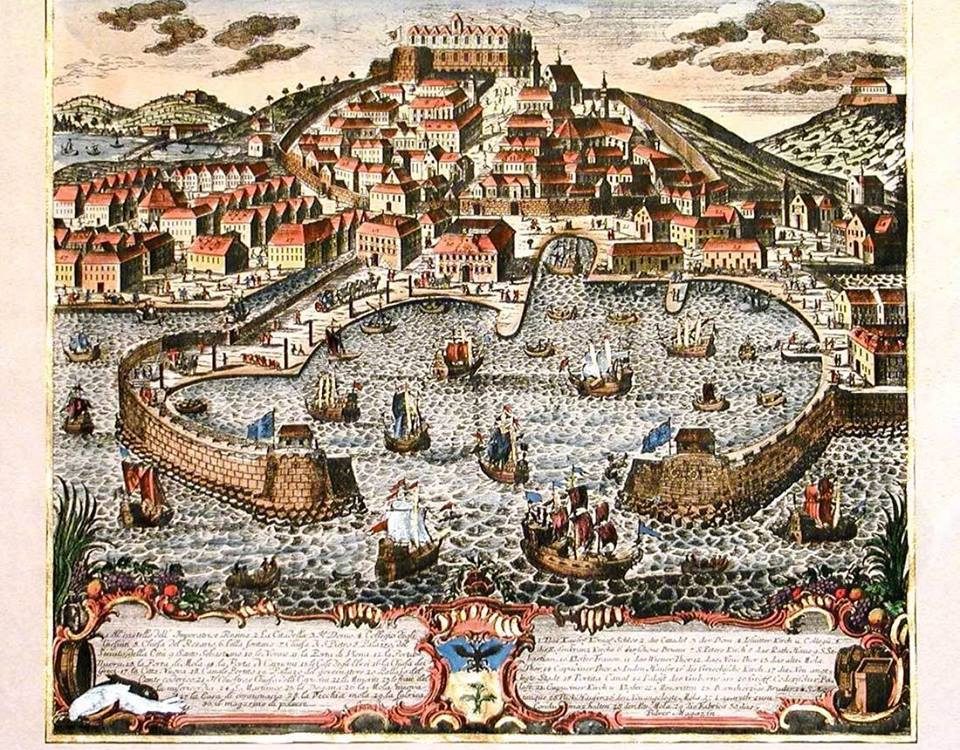Cogito 11
15 juin 2020
Déconfiner les politiques migratoires: lacunes et biais des débats scientifiques
16 novembre 2020Face à un sujet si vaste et si déterminant pour une évolution pacifique des sociétés, les projets de recherche conduits à Sciences Po ont toujours été nombreux. Nous présentons ici les directions et méthodes d’un échantillon de projets récemment engagés :
Ce projet de recherche* vise à analyser la spécificité de la participation politique en France des Asiatiques (Chinois, Cambodgiens, Vietnamiens et Laotiens) et Français d’origine asiatique et les processus de socialisation politique qui se forment avant et après la migration, au sein des groupes diasporiques.
Le projet repose sur les hypothèses de travail suivantes :
- le passage de génération, des immigrés aux descendants, transformerait la participation politique ;
- les actions collectives récentes menées par des Asiatiques en France contre les violences et les discriminations encourageraient des formes de participation politique plus classiques aux niveaux local et national ;
- le pouvoir économique croissant de la Chine (et plus généralement de la région asiatique) et sa stratégie de promotion d’un modèle alternatif à la démocratie libérale joueraient un rôle dans le processus de socialisation politique des immigrés et de leurs descendants ;
- ces expériences n’exclueraient toutefois pas l’adhésion aux pratiques citoyennes propres aux pays de résidence.
Le projet s’organise autour de trois thématiques d’enquêtes.
- Qui sont les élus d’origine asiatique et quelles sont leurs capacités et volontés de représenter un groupe minoritaire ?;
- Quelles sont les formes d’action collective de la société civile des populations concernées. Une attention est également portée sur les interventions diplomatiques potentielles des pays d’origine et leur acceptation par les groupes diasporiques;
- Quelles sont les formes d’adhésion (ou non) aux systèmes politiques des pays d’origine (des démocraties libérales aux régimes autoritaires) en prenant en compte les processus de socialisation politique.
*Ce projet (POLASIE) soutenu par l’Agence nationale de recherche, a pris place cette année pour une durée de 4 ans. Y participent Ya-Han Chuang (INED), Hélène Le Bail (CERI/Sciences Po), Aurore Merle (CY Université de Cergy), Laura Morales (CEE/Sciences Po), Djamel Sellah (Centre Émile Durkheim), Patrick Simon (INED et CEE/Sciences Po), Vincent Tiberj (Centre Émile Durkheim), Lun Zhang (CY Université de Cergy).
Le projet Migration Governance and Asylum Crises (MAGYC)* traite des politiques migratoires dans un contexte de crise. Il a pour principal objectif de comprendre l’impact des politiques migratoires sur les migrations et les migrants, et saisir comment la crise des réfugiés influence les politiques migratoires.
Deux axes de ce projet sont dirigés par le Centre de recherches internationales de Sciences Po (CERI) : “Constructing the crisis” et “External dimensions of the crisis”. Le premier de ces deux axes s’intéresse aux interprétations concurrentes de la crise. Le second traite de l’externalisation des politiques migratoires européennes au Moyen Orient et dans la Corne de l’Afrique, c’est-à-dire le processus par lequel l’Europe fait porter aux États de ces région la responsabilité de contrôler les mouvements migratoires et de prendre en charge les réfugiés. Cette externalisation soulève de nombreux débats scientifiques, politiques et éthiques, mais peu de travaux ont contribué à l’évaluation de ses effets.
Dans le cadre de cet axe, une équipe d’économistes et de politistes travaille à mesurer l’impact de l’externalisation sur les flux de migrants irréguliers et de demandeurs d’asile. La création d’une base de données et d’un modèle économétrique soulève plusieurs défis. L’externalisation est un phénomène pluriel et transversal qui concerne non seulement le contrôle des frontières et des migrations irrégulières, mais aussi l’aide humanitaire et le développement économique dans les pays d’origine et de transit, avec pour ambition de d’empêcher l’immigration clandestine. Cette recherche a notamment pour objectif de déterminer l’impact différencié que les multiples instruments politiques, regroupés sous le vocable d’externalisation, ont sur les demandeurs d’asile et les migrants irréguliers à travers les différentes “routes” qu’ils empruntent vers les frontières de l’Union Européenne.
Le projet MAGYC est financé par la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon 2020 dans la catégorie des projets Research and Innovation Action (RIA), lancé en novembre 2018. Il s’achèvera en 2022. Y participent : Thibaut Jaulin (CERI Sciences Po), Filip Savatic (Georgetown University), Céline Cantat (CERI Sciences Po), Hélène Thiollet (CERI Sciences Po/CNRS) Gerasimos Tsourapas (University of Birmingham), Stéphanie Latte Abdallah (CERI Sciences Po/CNRS), Virginie Guiraudon (CEE Sciences Po/CNRS), Camille Schmoll (Paris 7 – Université de Paris), Antoine Pécoud (Paris 13 – Université Paris Nord), Alice Mesnard (University of East London), Jean-Noël Senne (Université Paris-Saclay)
Alors que les politiques migratoires et identitaires continuent de jouer un rôle majeur dans la société et pour les gouvernements du monde entier, il est essentiel que les chercheurs disposent de données accessibles sur les minorités ethniques et migrantes afin d’analyser et de comprendre ces questions complexes. C’est ce que le projet Making Ethnic and Migrant Minority Survey Data
(FAIRETHMIGQUANT) ambitionne de faire en rendant les données des enquêtes françaises sur les populations de minorités ethniques et migrantes « FAIR » (faciles à trouver (F), accessibles (A, interopérables), R (réutilisables).
Pour atteindre cet objectif, l’équipe du projet travaille en partenariat avec deux projets européens : l’Ethmig Survey Data et le Social Sciences and Humanities Open Cloud. Ce partenariat permettra d’inclure des enquêtes françaises dans une base de données internationale d’enquêtes librement accessible en ligne : l’Ethnic and Migrant Minority Survey Registry (ou registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes).
Dans le cadre de cet effort, l’équipe du projet a collecté les données de 175 enquêtes menées en France auprès d’un nombre important de répondants issus de minorités ethniques et migrantes, ce qui représente l’un des plus grands nombres d’enquêtes collectées parmi les 30 pays qui seront représentés dans l’Ethnic and Migrant Minority Survey Registry. Les informations obtenues à ce jour concernent douze pays et permettent de comparer les perspectives des enquêtes réalisées en France avec celles d’autres pays qui produisent également de nombreuses enquêtes. Par exemple, 93 % des enquêtes françaises sont menées au niveau national, une proportion plus élevée qu’en Allemagne (47 %), en Suède (84 %) et au Royaume-Uni (38 %). Les enquêtes menées au niveau infranational (local ou régional) sont donc beaucoup moins courantes en France. Étant donné que les politiques d’intégration sont largement déterminées par le contexte local, il serait utile de disposer de plus d’informations au niveau local.
Ces enquêtes constituent une mine d’informations pour les chercheurs qui veulent comprendre l’intégration sociale, économique et politique des minorités ethniques et migrantes en France. Elles couvrent des sujets variés, notamment la santé, le marché du travail, l’inclusion politique et les conditions de vie. Certaines enquêtes ciblent des populations particulièrement vulnérables ou difficiles à atteindre, comme « l’Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement ou de distribution de repas » menée en 2012 auprès de 10 627 personnes sans domicile fixe, dont 4 524 sont nées à l’étranger. D’autres enquêtes portent spécifiquement sur l’inclusion des populations d’origine immigrée, comme la série d’enquêtes intitulée Enquête Longitudinale sur l’Intégration des Primo-Arrivants (ELIPA) ou les enquêtes Trajectoires et Origines.
Certaines des enquêtes collectées font partie de programmes d’enquêtes internationaux qui permettent des comparaisons transnationales. Mais ce n’est pas le cas de la plupart des enquêtes. Il est donc urgent de rendre les données d’enquête plus disponibles, accessibles et comparables pour les chercheurs. C’est pourquoi la prochaine étape consiste à inclure des enquêtes françaises dans le cadre d’un projet pilote de création d’une banque de données européenne en ligne sur les questions relatives aux minorités ethniques et migrantes qui comprendra les questionnaires utilisés dans les enquêtes menées dans dix pays européens géographiquement et linguistiquement différents. Cet outil permettra aux chercheurs d’identifier facilement les enquêtes dans lesquelles des questions importantes pour mesurer l’intégration sociale et politique de ces populations sont posées et qui résument les métadonnées pertinentes.
Le projet FAIRETHMIGQUANT est financé par l’appel science ouverte de l’Agence Nationale de Recherche (contrat ANR-19-DATA-0004-01). Il est mené par des chercheurs du CEE à Sciences Po (Laura Morales et Meredith Winn) en collaboration avec des chercheurs de l’Ined (Patrick Simon), du CDSP à Sciences Po (Alina Danciu, Lucie Marie et Nicolas Sauger), de PROGEDO (Sébastien Oliveau), d’IC Migrations (Perin Yavuz) et du GESIS (Esra Akdeniz, Thomas Krämer et Wolfgang Zenk-Möltgen).
L’ambition de ce projet* est tester et de quantifier l’hypothèse selon laquelle le contact direct entre individus affecte leurs opinions, leurs actions, et les technologies qu’ils utilisent. Afin d’identifier des variations dans la propension d’un individu à entrer en contact avec d’autres, nous utilisons des variations de migrations historiques. Deux volets particuliers de ce projet sont directement liées aux migrations internationales.
- Le volet “The Immigrant Next Door: Exposure, Prejudice, and Altruism” se base sur des variations de la composition ethnique des villes américaines héritée des migrations vers les États-Unis depuis le 19ème siècle. Il s’agit de déterminer si le voisinage entre populations d’origines diverses induit des changements d’attitudes et de comportements vis-à-vis des cultures étrangères. En particulier, nous chercherons à valider l’hypothèse selon laquelle plus la communauté d’origine arabe dans une ville est grande, pour des raisons historiques quasi-accidentelles, moins les résidents non-Arabes de cette ville ont de préjugés négatifs envers les Arabes en général, et plus ils font de donations caritatives destinées à des pays Arabes touchés par des catastrophes naturelles.
- Le second volet “Very Long Run Growth” vise, dans un premier temps, à construire une base de données des objets hébergés dans la plupart des musées d’art et d’histoire du monde. Cette base nous permettra ensuite de mesurer l’apparition et la diffusion de nouvelles technologies sur un horizon de plusieurs millénaires. En combinant ces informations avec des données historiques et archéologiques autour des migrations, nous pourrons quantifier la contribution des migrations humaines aux progrès technologiques sur le très long terme.
* Intitulé “Historical Migrations, Trade, and Growth”, ce projet est financé par le Conseil de Recherche Européen dans le cadre des “ERC Advanced Grants”. Conduit par Thomas Chaney, Professeur au département d’économie, il a démarré en juin 2020 pour s’achever en juin 2025.
Ce projet vise à décrire la manière dont des acteurs non étatiques contribuent à la construction des crises politiques à partir de ce qu’il est convenu d’appeler la crise des migrants ou des réfugiés qui s’est déployée en Europe et au delà des frontières de l’Europe au cours des années 2010. Il s’agit d’expliquer à partir de ce cas la façon dont les crises influencent les perceptions, les stratégies et les tactiques de ces acteurs non étatiques. Le projet explore comment ces “moments” génèrent des transformations organisationnelles parmi ces acteurs en réponse aux politiques de gestion de la « crise » déployées par les États. Une équipe au sein du projet s’intéresse en particulier au cadrage de la crise par les médias et les organisations non gouvernementales dans différents contextes nationaux, dont celui de la France.
Alors qu’aucun flux importants d’immigration et de demandes d’asile n’ont été enregistrés vers la France de 2011 à 2017, la « crise migratoire » a fait l’objet d’une intense couverture médiatique. Pour comprendre ce paradoxe, nous nous proposons de répondre à deux questions :
- Comment la crise est-elle construite comme un «événement» et sensationnalisée dans les principaux titres de la presse française ?
- Comment la «crise» a-t-elle été polarisée en fonction des nationalités des immigrants et des demandeurs d’asile, conduisant à ce que nous supposons être une racialisation du cadrage des migrations et de l’asile?
A partir d’un corpus d’articles extraits des six principaux journaux nationaux français, nous décrivons l’émergence et le cadrage de la migration et de l’asile comme une «crise». Nous testons l’hypothèse selon laquelle une caractéristique clé de la “crise” migratoire en France est sa déconnexion des flux réels d’étrangers et sa politisation.
En suivant un fil chronologique,, nous étudions la construction de sous-événements qui ont polarisé les discours médiatiques tels que les différents bateaux de migrants qui chavirent en Méditerranée depuis 2012, la publication de la photo d’Aylan Kurdi en août 2015,la déclaration commune de l’Union européenne et de la Turquie d’octobre 2016 ou l’accord entre l’Italie et Libye conclu en juillet 2017.
Nous analysons aussi le traitement différentiel de la crise migratoire en fonction de l’origine des migrants et des demandeurs d’asile: nous explorons ainsi la polarisation comme une forme de racialisation des discours de crise.
* Ce projet – (La politique des crises des migrants et des réfugiés en Europe (PACE) – financé par l’Agence Nationale pour la Recherche a débuté en 2019 et se déroulera jusqu’en 2023,
Il implique quatre institutions: le Centre de recherches internationales de Sciences Po (CERI), le Centre “ Migrations Internationales, espaces et sociétés (MIGRINTER) de l’Université de Poitiers, le Laboratoire Triangle – Action, discours, pensée politique et économique (CNRS/ENS de Lyon et partenaires) et l’Université Paris 13.
A Sciences Po, y participent : Hélène Thiollet (CNRS/CERI Sciences Po), Catherine Perron (CERI Sciences Po); Michelle Reddy (CERI Sciences Po), Virginie Guiraudon (CNRS/CEE Sciences Po), Elisa Benker (Sciences Po/Frei Universität); Camille Schmoll (Université de Paris), Mélodie Beaujeu (AFD), Marie Bassi (URMIS, Université de Nice), Giulia Scaletaris (Université de Lille), François Gemenne (Université de Liège).