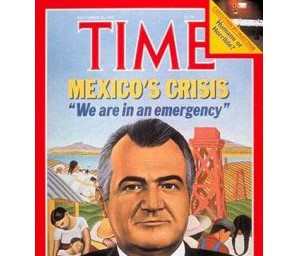Légiférer pour s’enrichir
15 novembre 2019
Finance et démocratie sont-elles irréconciliables ?
15 novembre 2019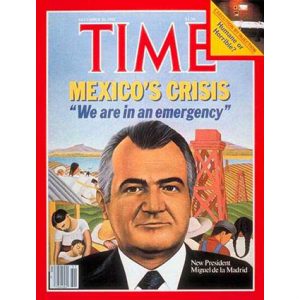 La mémoire des crises financières est une curieuse chose. L’hyperinflation allemande de 1923 ou le Krach boursier de 1929 restent des références connues de tous et on peut parier qu’il en ira de même, longtemps encore, avec la crise de 2008. Inversement, la crise d’endettement de nombreux pays en développement dans les années 1980, semble prise dans un angle mort, tant pour le grand public que pour les chercheurs. .
La mémoire des crises financières est une curieuse chose. L’hyperinflation allemande de 1923 ou le Krach boursier de 1929 restent des références connues de tous et on peut parier qu’il en ira de même, longtemps encore, avec la crise de 2008. Inversement, la crise d’endettement de nombreux pays en développement dans les années 1980, semble prise dans un angle mort, tant pour le grand public que pour les chercheurs. .
Jérôme Sgard, professeur d’économie politique et chercheur au CERI, en a repris l’histoire à partir des nombreuses archives désormais ouvertes et en interrogeant ses principaux acteurs.
Deux points ressortent avec force : primo, la gestion multilatérale de cette crise par le Fonds monétaire international (FMI) a reposé à la fois sur des règles procédurales très stables et sur beaucoup d’informalité, de non-dits et de rapports de force ; secundo, cette crise a été un des principaux « incubateurs » du passage à la finance globalisée et aux réformes libérales des années 1990.
La connaissance commune sur la crise de la dette des années 1980 repose sur un récit largement accepté quoique mince. A son origine on trouve la politique de « recyclage des pétrodollars » des années 1970, qui conduit les banques occidentales et japonaises à prêter massivement aux pays en développement, en particulier en Amérique latine. En 1982, asphyxié par sa dette, le Mexique appelle au secours le FMI et les États-Unis, suivi très vite par une trentaine de pays. 109 restructurations de dettes suivront jusqu’à ce qu’une issue soit trouvée en 1989, avec le Plan Brady, qui réduit leurs encours de 25 à 40%. Qui plus est, ces crédits accordés initialement par des banques sont échangés du jour au lendemain contre des obligations, qui s’achètent et se vendent en continu – les Brady bonds. Par cette opération d’ingénierie on passe donc à une finance de marché qui prépare la libéralisation des mouvements de capitaux et prolonge les réformes structurelles engagées depuis le milieu de la décennie – le Consensus de Washington.
Une histoire à écrire

Guillermo Ortiz – World Economic Forum on Latin America 2010. CC BY-NC-SA 2.0
Curieusement, ce récit largement accepté a été peu enrichi depuis les années 1990. Pas encore dans l’histoire, mais plus dans l’actualité, cet épisode reste dans un angle mort, si bien que les économistes et les juristes qui ont travaillé sur les crises en Argentine (2001-2015) et en Grèce (2009-2015) ignoraient généralement comment des problèmes similaires avaient été traités dans les années 1980. Pourtant les archives de cette crise sont abondantes et ses grands acteurs ne demandent qu’à être interrogés. J’ai donc rencontré, parfois pendant plusieurs heures, Jacques de Larosière (FMI), Paul Volcker (Réserve Fédérale), Bill Rhodes (principal coordinateur des banques internationales), Guillermo Ortiz (Banque Centrale du Mexique), Angel Guria (Ministère des Finances mexicain), Charles Dallara (Trésor Fédéral américain) ou Lee Buccheit (avocat). Bien d’autres entretiens s’y sont ajoutés, dans les pays endettés et les pays créanciers, dans le privé et le public.
Une stratégie multilatérale
S’il y a une règle générale en matière de dettes souveraines, c’est que les restructurations ont lieu sur les places financières dominantes où ces dettes ont été émises. Au dix-neuvième siècle et jusqu’aux années 1920, puis à nouveau depuis les années 2000, tout se passe ainsi à Londres et à New York. Les années 1980 sont ici la grande exception, en ce que ces opérations se réalisent selon une logique largement extra-territoriale et multilatérale : le FMI coordonne les parties, apporte un soutien financier, sanctionne le « partage du fardeau » entre les banques et les pays endettés, tord le bras de l’un ou de l’autre. Enfin il garantit que les politiques économiques d’austérité sur lesquelles s’engagent les pays endettés ne soient pas abandonnées une fois reçues les concessions financières.

Neoliberal Tina There Is No Alternative to the washington consensus
On retrouve ici la pratique rugueuse de la conditionnalité, c’est-à-dire cette transaction entre une aide financière et des engagements de politique économique, qui a été développée par le FMI depuis les années 1950 et qui reste jusqu’à aujourd’hui son principal outil d’intervention.
Cela étant, la question des dettes souveraines n’étaient pas à l’agenda de la conférence de Bretton Woods, où les statuts du FMI ont été adoptés. Ce n’est qu’à partir des années 1970 que les Ministères des finances et les administrations du Trésor des pays du G7 lui confient de facto le sujet, en dépit de l’opposition des pays en développement qui auraient préféré créer une instance ad hoc au sein de l’ONU où leur influence est beaucoup plus grande.
La règle du triple véto
Une fois le FMI en charge de la dette, il fallait toutefois inventer une procédure de restructuration économiquement efficace et globalement légitime. En particulier, il fallait s’accorder sur la règle de décision qui sanctionne le « partage du fardeau » entre les engagements de politique économique du pays, le soutien du FMI et les concessions des banques créditrices. De manière très pragmatique, on a décidé que chaque partie signalerait successivement son adhésion au deal. Mais voilà : en pratique, ce principe d’unanimité revient à soumettre la décision du FMI d’accorder un crédit à la bonne volonté de petits groupes de banques commerciales qui ont renégocié les dettes, mais qui n’ont pas d’existence juridique et pas de délégation de pouvoir formalisée – les Steering Committees.
On n’est donc plus dans le schéma habituel où une organisation internationale exploite les interstices laissés par le contrôle imparfait des États-membres. Il y a ici un écart beaucoup plus radical aux principes classiques de la délégation multilatérale, et donc un degré exceptionnel de non-dit et d’informalité. De fait, la règle du triple veto n’a jamais été annoncée, explicitée et justifiée. Dans les archives du FMI on trouve des allusions insistantes, mais lointaines et à peine décodables. Il fallait passer à l’histoire orale pour comprendre comment les choses se passaient.
Un jeu complexe et déséquilibré entre grandes et petites banques
Regardons plus précisément le cas des banques commerciales. En pratique, on ne réunit jamais ni ne consulte les centaines de banques qui ont fait crédit à chaque pays en restructuration – ce serait quasiment impossible.

NYC – Citicorp Center by Wally Gobetz via Flickr CC BY-NC-ND 2.0
Tout au long de la crise, les négociations sont donc menées par un club étroit de grands établissements bancaires internationaux, conduit le plus souvent par le plus puissant d’entre eux – Citicorp. Ceci pose des problèmes considérables avec les centaines de petites banques locales ou régionales qui doivent participer à chaque restructuration et contribuer, le plus souvent, à un prêt complémentaire (new money loan) destiné à soutenir le pays dans sa phase d’ajustement. Pendant toutes ces années, les petites banques n’ont donc qu’une idée en tête : acter leurs pertes et sortir du jeu. Mais si on les laisse faire, tout le poids de la crise va se concentrer sur les seules grandes banques internationalisées, qui ne cessent de répéter que sans cette solidarité, plus rien n’est possible.
Alors que le conflit d’intérêt premier oppose le pays endetté aux banques créditrices, depuis 1982, chacune des 109 restructurations est marquée avant tout par une épreuve de force brutale pour maintenir à bord toutes les banques. Et ici, à nouveau, on est dans le non-dit et le non-écrit. Encore aujourd’hui la plupart des grands acteurs préfèrent l’euphémisme et le sous-entendu, alors qu’il n’y a aucun doute que si les petites banques résistaient, elles étaient très vite menacées de rétorsions. Par exemple on les menacerait d’un accès plus difficile au marché monétaire et aux marchés de capitaux, qui passent par les grands réseaux bancaires nationaux. Si cela ne suffisait pas, les Banques centrales, à commencer par la Réserve fédérale américaine, leur rappelleraient sans doute que le superviseur garde une capacité de nuisance, par exemple en cas de fusion ou d’émission d’actions dans le futur. Comme le dit gentiment Paul Volcker, «il y avait toujours des banques qui faisaient de la résistance et on n’aimait pas leur tordre le bras ; mais il fallait bien qu’elles acceptent que c’était dans leur propre intérêt ». Quant à la Bundesbank, la Banque nationale néerlandaise et la Banque d’Angleterre, elles étaient horrifiées par ce qu’on leur demandait de faire. En France, en revanche, où la plupart des banques étaient nationalisées, c’était plus simple : elles n’avaient qu’à obéir.
Une crise gérée à l’ancienne
Au total, que l’on considère le FMI ou les banques, l’image qui ressort des entretiens et des archives est celle d’une crise gérée avec des méthodes typique des décennies d’après-guerre, où des pouvoirs publics puissants et discrétionnaires écartent les règles qui ne leur conviennent plus et mettent au pas les intérêts privés qui s’opposent à leurs vues. Une puissante odeur de dirigisme émane de cette histoire. C’est tout son paradoxe : les vieilles méthodes ont préparé le passage, après 1990, à un monde globalisé et libéralisé où elles n’auront plus aucune validité, aucune légitimité.
Jérôme Sgard, professeur d’économie politique et chercheur au CERI, consacre ses recherches actuelles à la construction et la régulation des marchés, vues depuis une perspective micro-fondée, accordant une grande importance aux règles de droit et aux procédures de règlement des différends.