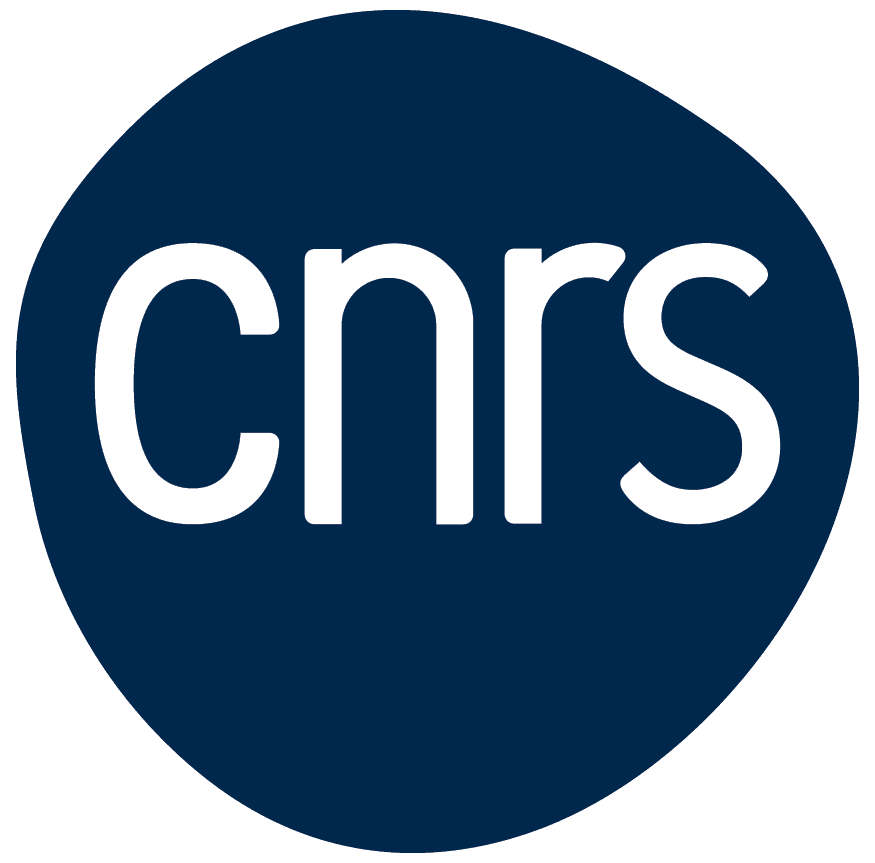Accueil> Différentes nuances de fondamentalisme en islam : pour une typologie des radicalités

22.10.2025
Différentes nuances de fondamentalisme en islam : pour une typologie des radicalités
Entretien avec Stéphane Lacroix
Le religieux fait un retour en force sur la scène internationale. Pour nous aider à comprendre où va notre monde, Alain Dieckhoff a dirigé l’ouvrage Radicalités religieuses. Au cœur d’une mutation globale (Albin Michel). Ce livre dresse un panorama des radicalités religieuses contemporaines pour nous aider à mieux saisir les rapports entre État, ethnicité, nationalisme, violence et religion. Rédigé par les meilleurs spécialistes, dont sept chercheurs du CERI, ce livre collectif reflète la vitalité de la recherche sur le fait religieux en France, et plus précisément au CERI.
Stéphane Lacroix a rédigé dans cet ouvrage le chapitre De l’islamisme et du salafisme comme catégories analytiques distinctes : les cas de l’Égypte et de l’Arabie Saoudite. Il répond ici à nos questions.
Le salafisme et l’islamisme partagent une référence commune à l’islam des origines, mais leurs généalogies historiques et leurs grammaires d’action sont très différentes, pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Stéphane Lacroix : Salafisme et islamisme sont deux formes de fondamentalisme musulman, distinctes tant dans le discours que dans la praxis (ce que j'appelle la grammaire d'action). Ils constituent deux traditions issues du mouvement réformiste apparu en Egypte et au Levant à la fin du XIXe siècle. En Egypte, ces deux traditions s'institutionnalisent dans les années 1920: l'islamisme, avec la création en 1928 de l'organisation des Frères musulmans ; le salafisme avec la création deux ans plus tôt, en 1926, de l'association des partisans de la tradition prophétique (Ansar al-Sunna al-Muhammadiyya).
Le programme des Frères Musulmans vise à la refondation de l'Etat sous la forme de ce qu'ils appellent un « Etat islamique » (dawla islamiyya), c'est-à-dire un Etat moderne appliquant la charia plutôt que le droit séculier d'inspiration européenne. Leur projet est donc avant tout politique, même si le religieux en est le substrat. A l'inverse, l'approche des salafistes est fondamentalement religieuse, et même théologique : ils prônent ce qu'ils appellent « la purification et l'éducation » (al-tasfiya wa-l-tarbiya), c'est-à-dire l'épuration du corpus musulman pour le réduire à son interprétation la plus conservatrice, inspirée du hanbalisme et son avatar wahhabite, et la transmission de ce corpus à une nouvelle « communauté croyante » par la prédication.
Les grammaires d'action, donc les méthodes, divergent tout autant : les Frères musulmans bâtissent une organisation sociale, politique et religieuse, qui selon eux a vocation à investir tous les espaces, y compris le champ politique, ils cherchent dès les années 1940 à entrer au parlement. Pour ce faire, les Frères musulmans se tiennent à bonne distance des querelles théologiques, y compris d'ailleurs (au début au moins) de la querelle sunnites-chiites, pour rassembler le plus grand nombre de musulmans au nom de ce qu'ils présentent comme un objectif politique commun. A l'inverse, les salafistes sont obsédés par l'orthodoxie théologique et ils consacrent une partie de leurs écrits à fustiger ceux qu'ils estiment être des « musulmans déviants » (soufis, chiites ou même partisans de l'école théologique ash'arite, majoritaire parmi les sunnites jusqu'au XXe siècle). Ils se tiennent en revanche à l'écart du politique, convaincus que seule « l'islamisation par le bas » (la salafisation par le bas, faudrait-il dire) peut produire le changement.

Comment la tension entre « moderniser l’islam » et « islamiser la modernité » a-t-elle structuré le champ intellectuel musulman contemporain ?
Stéphane Lacroix : Cette question est présente dès le début du XXe siècle dans les débats qui agitent le réformisme musulman né quelques décennies plus tôt. Toute la problématique du réformisme musulman était en effet de s'interroger sur le retard du monde musulman par rapport à l'Europe, avec l'idée que les « solutions » seraient à chercher dans l'islam. Très vite se pose la question de la « modernité » telle qu'elle est entendue par les Européens : faut-il l'adopter, l'adapter ou la rejeter?
Les plus libéraux des penseurs de l'époque penchent pour la première option - mais à condition de « moderniser l'islam », c'est-à-dire de produire des interprétations religieuses en phase avec cette modernité, en allant puiser dans les traditions les plus rationalistes en islam. Une faction plus conservatrice se refuse à aller aussi loin: ils prônent non pas adopter mais d'adapter la modernité. Ce qui ne pose pas problème religieusement peut être intégré tel quel, mais le reste doit être « islamisé », c'est-à-dire adapté aux exigences et interdits de l'islam. Cette faction donnera naissance à l'islamisme. Leur concept-phare, l'Etat islamique, en est un bon exemple : il s'agit d'adopter la structure de l'Etat moderne (ce qui implique de rompre avec les structures politiques traditionnelles en islam) en en adaptant le droit, remplacé par la charia. Quant aux salafistes, ils sont finalement les seuls à évacuer la question de la modernité, remplacée par celle de la pureté théologique.
Propos recueillis par Corinne Deloy
Lire : Les mutations des radicalités religieuses. Entretien avec Alain Dieckhoff
Lire : Le nationalisme chrétien aux États-Unis. Entretien avec Denis Lacorne
Légende de l'image de couverture : Vue intérieure du dôme central flanqué de quatre demi-dômes de la mosquée Muhammad Ali du Caire. (crédits : Zidniyalfan pour Shutterstock.)
Suivez-nous
Nous contacter
Contact Média
Coralie Meyer
Tel: +33 (0)1 58 71 70 85
coralie.meyer@sciencespo.fr
Corinne Deloy
Tel: +33 (0)1 58 71 70 68
corinne.deloy@sciencespo.fr