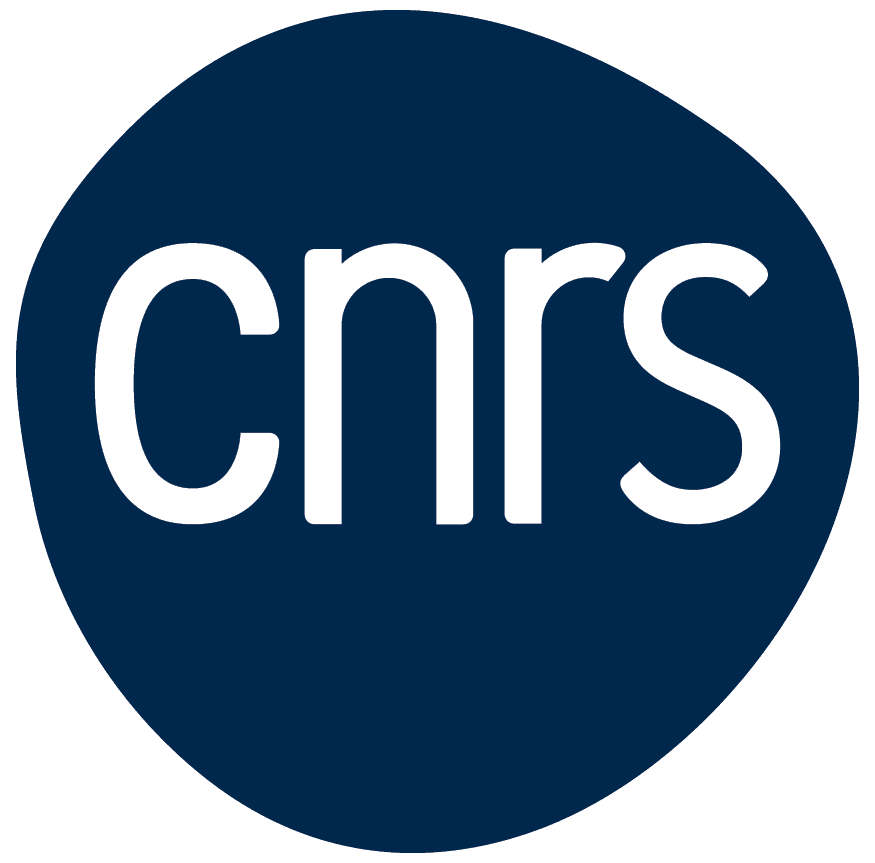Accueil>Le Yémen, dix ans de guerre.

06.03.2025
Le Yémen, dix ans de guerre.
Entretien avec Laurent Bonnefoy
En mars 2015, la coalition militaire emmenée par l’Arabie saoudite bombardait pour la première fois les cibles du mouvement rebelle houthiste : c’était le début de la guerre du Yémen. Dix ans plus tard, le conflit n’a pas cessé, et le président Donald Trump a annoncé, en mars 2025, l'accroissement significatif de l'implication militaire des États-Unis, par de nouvelles opérations. Par-delà les enjeux géopolitiques et régionaux mais aussi ses lourdes conséquences humanitaires, le conflit a indéniablement bouleversé tant la péninsule Arabique, que la société et les institutions yéménites. Laurent Bonnefoy nous rappelle pourquoi il est important que la recherche ne se détourne pas de ce conflit. Entretien.
Le Yémen, un pays que vous connaissez bien, est en guerre depuis dix ans. Pouvez-vous nous rappeler, en quelques lignes, l’origine de ce conflit?
Face aux discours simplificateurs des belligérants, les approches en sciences sociales viennent généralement éclairer la complexité des variables et des origines d’une guerre. Le conflit au Yémen est souvent hâtivement perçu comme une guerre confessionnelle, entre des rebelles chiites alliés à l’Iran - les houthistes, et un gouvernement sunnite soutenu par l’Arabie saoudite. Les dimensions tant religieuse que régionale sont présentes et on a coutume de dater le début de la guerre au déclenchement de l’opération militaire de la coalition emmenée par l’Arabie saoudite sur les positions des houthistes : la nuit du 25 au 26 mars 2015.
La chronologie est toutefois l’objet de vives controverses. De nombreux Yéménites, hostiles aux houthistes, pointent la date du 21 septembre 2014, qui correspond à la prise de la capitale, Sanaa, par les rebelles, et marque le début de leur coup d'État. Ce récit souligne une dimension plus locale du conflit, distincte de la rivalité irano-saoudienne qui a donné une coloration régionale à la guerre du Yémen. Ainsi, cette dernière est-elle principalement le fruit de la compétition entre élites politiques dans un contexte de transition mal négociée à la suite du “Printemps yéménite” débuté en 2011. Les rebelles ont pu acquérir leur capacité militaire et opérer leur prise de pouvoir parce qu’ils se sont alliés avec l’ancien président déposé par les révolutionnaires, en quête de revanche.
Les enjeux sont-ils les mêmes aujourd’hui?
Évidemment, une décennie de guerre a bouleversé la société yéménite. L’appréhension de ces recompositions est un enjeu central pour les chercheuses et les chercheurs. Dix ans, c’est long, notamment parce que les services, notamment éducatifs, se sont effondrés et qu’une génération semble sacrifiée. Les effets sont également importants en termes religieux, et restent pour une large part sous-analysés alors même que les houthistes ont transformé, et polarisé, les identités. Les salafis se sont en outre engagés dans une militarisation, quittant souvent leur approche quiétiste et prétendument apolitique. La question de l’accès au terrain rendu très difficile si ce n’est impossible - pour les chercheurs étrangers, comme pour les journalistes occidentaux - complique notre appréhension collective, y compris par des collègues yéménites dont une partie vit en exil.
Parallèlement, on peut dire que les enjeux du conflit se sont transformés, notamment par rapport à la grille de lecture régionale. D’une part, les Saoudiens ont implicitement reconnu l’inefficacité de leur stratégie militaire. Ils cherchent depuis le printemps 2022 à s’extraire du bourbier yéménite, sans vraiment y parvenir. Ils actent par là le fait que les houthistes sont un interlocuteur légitime dont ils ne contestent plus frontalement le contrôle d’une part significative du territoire. Cette évolution a été accompagnée d’une amélioration sensible des relations irano-saoudiennes.
D’autre part, la question des rivalités régionales s’est déplacée et les tensions se manifestent entre les Saoudiens et leur principal allié membre de leur coalition, les Emirats Arabes Unis. Ces derniers ont établi au fil de la guerre un partenariat avec le mouvement sécessionniste sudiste, sapant l’autorité du gouvernement reconnu par la communauté internationale. C’est un enjeu dans le Golfe qui est encore trop négligé.
Enfin, la place prise par le conflit yéménite a été soudainement bouleversée dans le sillage des attaques du 7 octobre en Israël. En effet, les houthistes, affirmant leur soutien aux Palestiniens, ont développé depuis novembre 2023 une stratégie nouvelle en s’attaquant à la navigation marchande en mer Rouge. Les effets, inattendus, ont conduit à la réduction de plus de 50% du trafic maritime dans cette voie importante du commerce mondial. Plus d’une centaine de bateaux ont été touchés dont un coulé alors que des marées noires d’ampleur historique ont été évitées de justesse. Les houthistes ont par-là démontré la capacité de nuisance de leur mouvement ainsi que la nécessité de régler le conflit. En février 2025, la décision de Donald Trump de classer ce mouvement en tant qu’organisation terroriste et d’engager, en partenariat avec les Britanniques et les Israéliens, des nouveaux bombardements du Yémen, se fait contre l’avis de bien des acteurs de l’aide humanitaire dont dépendent pourtant les deux tiers des 35 millions de Yéménites. Les coupures de financement de l’USAID font également craindre une détérioration très sensible de la situation humanitaire.
À qui profite la guerre ?
Il est devenu manifeste au fil des années que la guerre bénéficie principalement aux houthistes. Leurs interventions en mer Rouge leur ont permis d’acquérir une certaine popularité à l’échelle régionale. En effet, ils apparaissent habilement comme les seuls soutiens des Gazaouis, au moment où les États arabes sont décrédibilisés. En étant la cible de frappes israéliennes qui ont détruit des infrastructures civiles, notamment le port de Hodeïda en mer Rouge,ceux-ci se positionnent dès lors comme une alternative au Hezbollah, au moins sur le plan symbolique. Ils sont en effet parvenus à envoyer des drones et missiles qui ont ponctuellement atteint Tel Aviv, faisant même une victime. Les bombardements américains décidés par Donald Trump le 15 mars 2025 ont tué plusieurs dizaines de civils et alimentent cette même logique d’un mouvement qui, seul contre tous, conteste l’ordre international. En outre, la volonté du pouvoir saoudien de quitter le théâtre militaire yéménite depuis 2022 a placé les houthistes en position de force. Ils font ainsi monter les enchères et semblent disposés à humilier encore davantage les Saoudiens avant de signer un quelconque accord de paix.
On peut se demander comment continuer à garder espoir et une forme d’engagement optimiste…peut-il être intéressant, alors, de se tourner vers les arts et la création ?
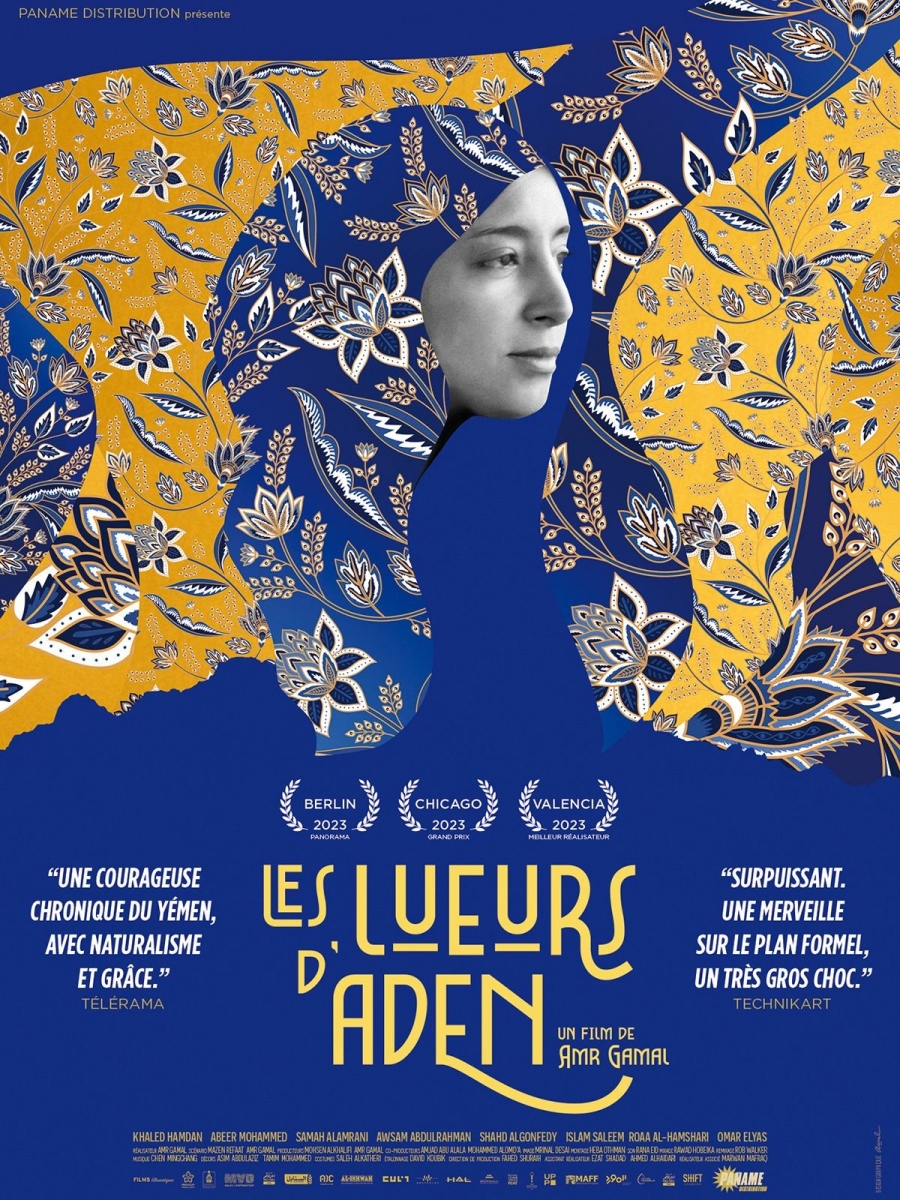 En effet, au terme d’une décennie pleine de guerre, la question de la lassitude des chercheurs face à leur objet engagé dans une désespérante spirale de destruction se pose évidemment. La part sensible de notre travail, fondé sur un rapport affectif au terrain et à celles et ceux que nous y côtoyons, est indéniablement remise en question ou du moins de plus en plus réduite à des “passions tristes”. Les interlocuteurs blessés ou tués, ceux qui cherchent à fuir et qu’il faut tenter d’aider, les amis dont on ne comprend pas les positions : la guerre affecte aussi celles et ceux qui font profession d’en éclairer une part. Les destructions de patrimoine, par les bombardements comme par la crise économique induite sont une autre source de pessimisme. Il n’est pas toujours simple de trouver ce à quoi se raccrocher, mais les arts et la création en font partie. C’est ainsi que j’aurai plaisir le 1er avril à participer à la présentation du long métrage Les lueurs d’Aden du réalisateur yéménite Amr Gamal diffusé dans le cadre du ciné club du CERI avec le cinéma L’entrepôt à Paris. J’y trouve là, malgré une thématique difficile, une forme de réconfort.
En effet, au terme d’une décennie pleine de guerre, la question de la lassitude des chercheurs face à leur objet engagé dans une désespérante spirale de destruction se pose évidemment. La part sensible de notre travail, fondé sur un rapport affectif au terrain et à celles et ceux que nous y côtoyons, est indéniablement remise en question ou du moins de plus en plus réduite à des “passions tristes”. Les interlocuteurs blessés ou tués, ceux qui cherchent à fuir et qu’il faut tenter d’aider, les amis dont on ne comprend pas les positions : la guerre affecte aussi celles et ceux qui font profession d’en éclairer une part. Les destructions de patrimoine, par les bombardements comme par la crise économique induite sont une autre source de pessimisme. Il n’est pas toujours simple de trouver ce à quoi se raccrocher, mais les arts et la création en font partie. C’est ainsi que j’aurai plaisir le 1er avril à participer à la présentation du long métrage Les lueurs d’Aden du réalisateur yéménite Amr Gamal diffusé dans le cadre du ciné club du CERI avec le cinéma L’entrepôt à Paris. J’y trouve là, malgré une thématique difficile, une forme de réconfort.
Par ailleurs, j’admets que le sentiment de faire partie d’une communauté épistémique qui, tout en ayant évité de grandes tensions politiques inhérentes à une situation de conflit, se côtoie depuis de longues années et partage un intérêt et un respect communs pour le devenir du Yémen a aussi une dimension précieuse. Je trouve également une dose de satisfaction dans le fait que la guerre, malgré les horreurs, a aussi encouragé l’émergence d’une nouvelle génération de chercheuses et de chercheurs yéménites. Nous aurons plaisir et intérêt à écouter certains d’entre eux dans le cadre d’une journée d’étude organisée par le CERI/Sciences Po, en partenariat avec la revue Orient XXI et la chaire d’étude du fait religieux, le 26 mars consacrée aux dix ans de guerre au Yémen.
Propos recueillis par Miriam Périer, CERI.
- Info et inscription à la journée d’étude du 26 mars
- Info et réservation à la séance du cinéclub au cinéma L’Entrepôt
Pour aller plus loin :
Laurent Bonnefoy, Yémen. De l’Arabie heureuse à la guerre , Paris, Fayard, 2017.
Laurent Bonnefoy, “Revolution, War and Transformations in Yemeni Studies ”, Middle East Research and Information Project: Critical Coverage of the Middle East Since 1971, No. 301, 2021.
Revolution, War and Transformations in Yemeni Studies - MERIP
Abdullah Hamidaddin, The Huthi Movement in Yemen: Ideology, Ambition and Security in the Arab Gulf, I.B. Tauris, 2022.
Helen Lakner, “Les houthistes du Yémen sous les feux de la rampe” , Orient XXI, 10 janvier 2024.
Illustrations
- Photo de couverture : la vieille ville de Sanaa. © : Rod Waddington. Photo republiée dans le cadre de la licence CC-BY -SA 2.0
- Affiche française du film Les lueurs d'Aden
(crédits : Rod Waddington. Photo republiée dans le cadre de la licence CC-BY -SA 2.0)
Suivez-nous
Nous contacter
Contact Média
Coralie Meyer
Tel: +33 (0)1 58 71 70 85
coralie.meyer@sciencespo.fr
Corinne Deloy
Tel: +33 (0)1 58 71 70 68
corinne.deloy@sciencespo.fr