Archives - Regards sur nos publications
 © Daguerréotype, 1855, CC0 Public Domain Designation, Chicago Art Institute.
© Daguerréotype, 1855, CC0 Public Domain Designation, Chicago Art Institute.Cette page présente par ordre de parution les débats et les analyses suscités par les publications scientifiques des chercheur-e-s du CERI au cours du trimestre.
Vous y trouverez, entre autres, des entretiens, vidéos, podcasts et comptes rendus qui contribuent à prolonger et à enrichir la réflexion développée dans ces travaux.
Toutes ces ressources sont librement accessibles en ligne, sauf les recensions parues dans des revues à comité de lecture.
Au-delà de cette page,
la liste complète des publications scientifiques.
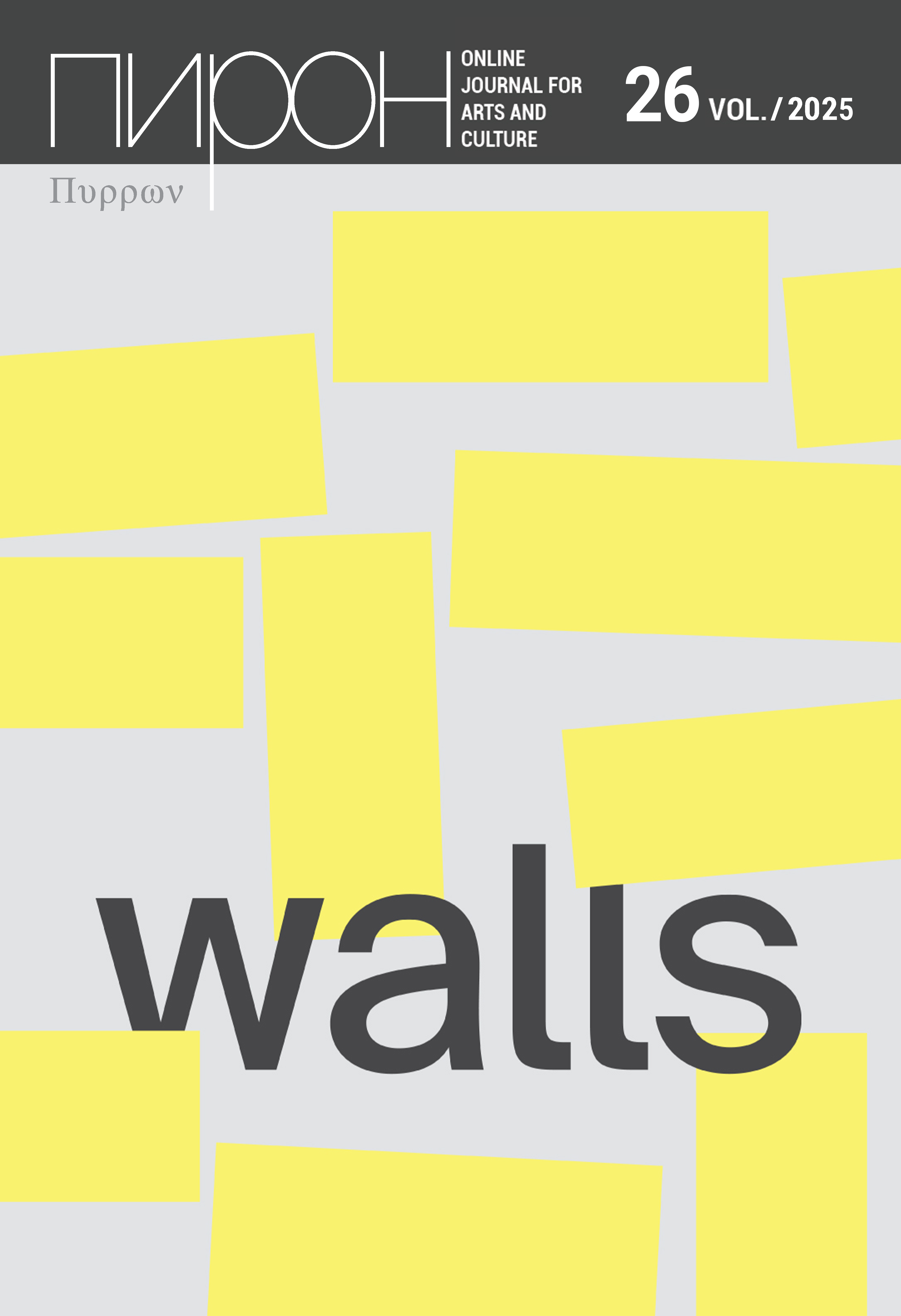
Elastic and Explosive Europe at a Time of War: How Can We Rethink European Cleavages and Linkages?
Piron, Vol. 26, Walls, January 2025.
Once upon a time, in 1989–1991, European elites and citizens seemed to know that Europe existed, and they hoped that the continent would get reunited. Since then, several map-making efforts have taken place. Changing lists of (often normative) cleavages and linkages have been drawn to portray the political, economic, and societal evolutions affecting the region. Today, however, attempts at comparing and contrasting intra-European experiences offer only limited access to the radical changes that are taking place in Europe. Where do democracies/authoritarian regimes start and end? Are foreign policy alignments reminiscent of a (new) Cold War? At stake is not the identification of dominant divisions/ties, similitudes/differences, etc. Rather, a central issue lies in our ability to abandon the classification-based modes of knowledge production inherited from the 18th century and to invent new ways of thinking about an era that is both elastic and explosive.
Autour de la publication
Les Entretiens du CERI
17 mars 2025
Rethinking Europe: Beyond Classifications and Towards New Paradigms
Interview with Nadège Ragaru, by Miriam Périer
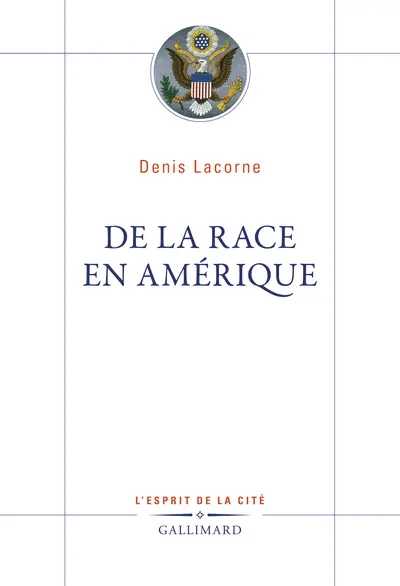
Denis Lacorne
Paris, Gallimard (L'esprit de la cité), 2025, 240 p.
La question de la race travaille l’histoire des États-Unis depuis l’origine dans une dualité tragique : la Constitution consacre la liberté individuelle et les droits politiques en privant les Noirs de leurs bienfaits ; les principes fédèrent les Américains, la race et l’esclavage les désunissent. Ce mot de race n’est pas une donnée biologique mais une construction sociale qui évolue dans le temps et dont ce livre restitue les avatars, de l’arrivée des premiers Pèlerins jusqu’à aujourd’hui. Denis Lacorne interroge les narratifs concurrents qui se disputent le récit national américain : d’une part, un idéal civique indifférent à la couleur des personnes ; de l’autre, une conception « racialisée » de la république, autrefois soutenue par les grands planteurs mais aujourd’hui revendiquée par les « identitaristes » et instrumentalisée par les partisans de la « théorie critique de la race ». En Amérique, la peur de l’Autre n’a cessé de changer de cibles au rythme des immigrations, nourrie par la hantise lancinante de l’effacement de la race blanche au profit de nouveaux arrivants jugés inassimilables. Dans un pays devenu si métissé, la politique des identités recouvre de moins en moins une réalité démographique qui incline les individus à multiplier les appartenances sans nécessairement les opposer. Il n’y a plus d’identité fixe aux États-Unis, mais un E pluribus unum constamment réinventé.
Autour de la publication
Les Entretiens du CERI
17 mars 2025
Racialisation, peurs et démocratie aux États-Unis
Entretien avec Denis Lacorne, par Miriam Périer
Médias
15 mars 2025
Pourquoi la question raciale obsède-t-elle autant les États-Unis ?
Entretien avec Denis Lacorne, par David Doucet, Le Point (abonnés)
Recensions
09 mars 2025
Les experts livres
Recension de Rémi Bostsarron, franceinfo
06 mars 2025
« De la race en Amérique » de Denis Lacorne : le rêve inachevé des États-Unis
Recension de Gilles Biassette, La Croix (abonnés)
Les tourments raciaux de l'Amérique
Recension de Paul-François Paoli, Le Figaro (abonnés)
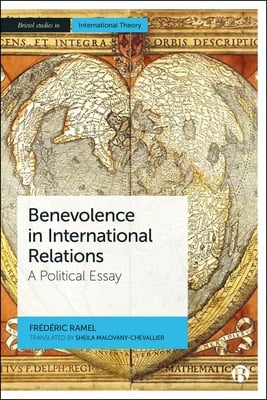
Frédéric Ramel
Bristol, Bristol University Press (Bristol Studies in International Theory), 2025, 210 p.
In this first English-language edition of a sole-authored book from Frédéric Ramel, benevolence is defined as a moral principle which promotes temperance and attention to vulnerability. Ramel unpacks this concept, analyses its received meanings in different contexts and spells out its practical and ethical implications in detail.
Autour de la publication
Les Entretiens du CERI
08 mars 2022
Pour une expérience sensible des relations internationales. La bienveillance, selon Frédéric Ramel
Entretien avec Frédéric Ramel, par Miriam Périer
28 mars 2022
For a Sensitive Experience of International Relations. Benevolence, according to Frédéric Ramel
Interview with Frédéric Ramel, by Miriam Périer
Médias
23 mars 2025
L’espérance, une vertu politique
Débat avec Frédéric Ramel, par Régis Burnet, KTO
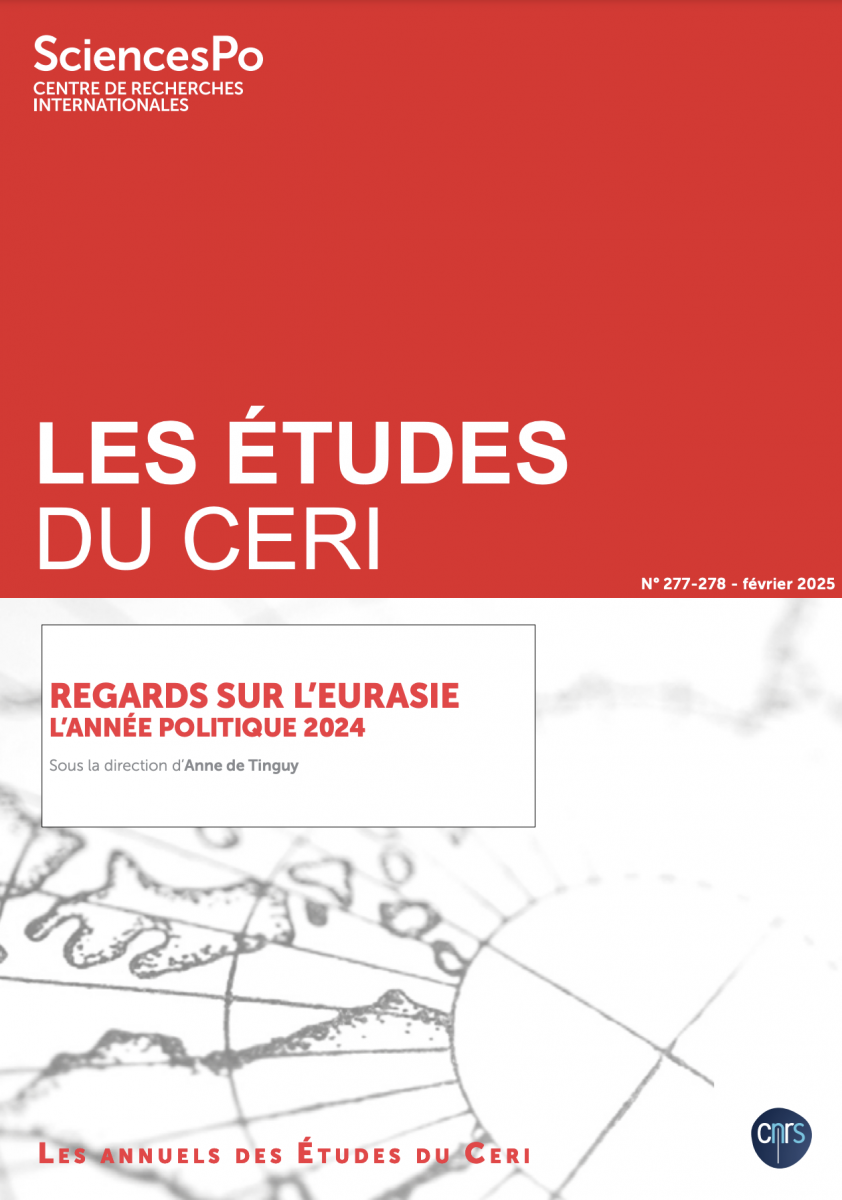
Anne de Tinguy (Dir.)
Les Études du CERI, n°277-278, février 2025.
Regards sur l’Eurasie. L’année politique est une publication annuelle du Centre de recherches internationales de Sciences Po (CERI) dirigée par Anne de Tinguy. Elle propose des clefs de compréhension des événements et des phénomènes qui marquent de leur empreinte les évolutions d’une région, l’espace postsoviétique, en profonde mutation depuis l’effondrement de l’Union soviétique en 1991. Forte d’une approche transversale qui ne prétend nullement à l’exhaustivité, elle vise à identifier les grands facteurs explicatifs, les dynamiques régionales et les enjeux sous-jacents.
Autour de la publication
Les Entretiens du CERI
19 février 2025
Ondes de choc en Eurasie après trois ans de guerre totale en Ukraine
Entretien avec Anne de Tinguy, par Corinne Deloy
La Moldavie, dans l’ombre de la guerre en Ukraine
Entretien avec Florent Parmentier, par Corinne Deloy
Géorgie : l’espoir démocratique en berne
Entretien avec Silvia Serrano, par Corinne Deloy
Podcast
11 février 2025
Conflits et bouleversements tectoniques en Eurasie
Conférence organisée à l’occasion de la publication de "Regards sur l’Eurasie. L'année politique 2024"
Traduction
Février 2025
Eurasia Faces a Proliferation of Perils. English Introduction
Traduction de l'introduction d'Anne de Tinguy

David Recondo (Dir.)
Les Études du CERI, n°276-277, janvier 2025.
Amérique latine. L’Année politique 2024 est une publication de l’Observatoire politique de l’Amérique latine et des Caraïbes (Opalc) du CERI-Sciences Po. Il prolonge la démarche du site www.sciencespo.fr/opalc en offrant des clés de compréhension d’un continent en proie à des transformations profondes. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site.
Autour de la publication
Les Entretiens du CERI
12 février 2025
Continuités politiques sur fond de stabilité économique. L’Amérique latine en 2024
Entretien avec David Recondo, par Corinne Deloy

Laurent Gayer
Londres, Hurst (Comparative Politics and International Studies Series), 2025, 384 p.
On 11 September 2012, over 250 workers of Ali Enterprises, which produced jeans for the German discount retailer KiK, perished in a fire in their Karachi factory. Was this an accident or an arson attack? Straight away, the tragedy gave rise to contradictory interpretations. While some blamed the exploitative logics of fast fashion, others suspected foul play by the political parties preying on the city and its business class. Taking as a starting point the controversy caused by this disaster, Gunpoint Capitalism plunges us into the murky waters of globalisation. Exploring the back alleys of Pakistan’s industrial capital city, it shows how the manufacturing economy makes order out of disorder, and profit out of conflict–to the detriment of workers. In Karachi, as elsewhere, petty criminals and ex-servicemen prove to be formidable enforcers of economic order. A comparison with Europe, the United States and Latin America confirms the central place of such henchmen in the dynamics of capitalism. These shock troops of anti-unionism are now participating in the dismantling of the social state.
Autour de la publication
Les Entretiens du CERI
11 février 2025
Making economic order out of disorder: Insights from Karachi
Interview with Laurent Gayer, by Corinne Deloy
04 mars 2023
Le capitalisme à main armée. Caïds et patrons à Karachi
Entretien avec Laurent Gayer, par Corinne Deloy

Catherine Wihtol de Wenden
Paris, Autrement, 2025, 160 p.
Comment penser un monde qui repose sur les mobilités quand la question de l’immigration donne lieu à tant de crispations sociales et identitaires ? Coups d’État, catastrophes environnementales, flux de migrants économiques et de réfugiés de pays en guerre : les crises se multiplient et s’installent dans un paysage politique marqué par la peur de l’Autre. Indifférent à ceux qui meurent aux frontières, le choix des approches sécuritaires s’affirme. Coupée des réponses humanitaires, économiques et démographiques, cette politique ignore et dénigre les propositions réelles des chercheurs et des associations. Réunir le politique, le savant et l’opinion publique, tel est l’enjeu du livre de Catherine Wihtol de Wenden.
Autour de la publication
Médias
17 février 2025
Immigration : les faits plutôt que le ressenti
Entretien avec Catherine Wihtol de Wenden, par Quentin Lafay, France Culture
19 février 2025
"Submersion migratoire", un faux débat ?
Débat avec Catherine Wihtol de Wenden, par Nina Masson, France 24

Frédéric Ramel, avec la collaboration d'Aghiad Ghanem
Paris, Presses de Sciences Po, 2024, 476 p.
Nos vies sont plus que jamais liées les unes aux autres. Un virus circulant à travers les frontières entraîne des mesures de confinement dans la majorité des pays. Une guerre interétatique expose à des ruptures d'approvisionnement en gaz et en céréales bien au-delà des États belligérants. Le succès d’un objet du quotidien rend les économies dépendantes de terres rares dont l’exploitation se révèle particulièrement polluante sur l’ensemble des continents. Si cette tendance à nous voir exposés à des enjeux qui débordent le cadre national n’est pas forcément nouvelle, elle prend de plus en plus d’ampleur. La coupure entre affaires intérieures et extérieures des sociétés ne tient plus : nous évoluons dans un espace mondial, la plupart du temps sans que nous nous en rendions pleinement compte. Liant Relations internationales et condition planétaire, ce manuel invite à cultiver un nouveau regard sur des enjeux mondiaux omniprésents, mais souvent négligés ou simplifiés. Riche d’une centaine de cartes et documents, il donne à comprendre l’interdépendance profonde des faits sociaux, environnementaux, économiques et sécuritaires.
Autour de la publication
Les Entretiens du CERI
06 décembre 2024
L’espace mondial, ou nos vies entrelacées
Entretien avec Frédéric Ramel, par Miriam Périer
12 décembre 2024
The World Space, or our Intertwined Lives
Entretien avec Frédéric Ramel, par Miriam Périer
Médias
05 février 2O25
Planisphère. Quelle géopolitique de l’espace mondial ? Avec F. Ramel
Podcast, vidéo et synthèse rédigée par E. Bourgoin, F. Ramel, et P. Verluise, Diploweb

Delphine Allès, Christophe Jaffrelot (dir.)
Paris, Presses de Sciences Po (L'Enjeu mondial), 2024, 190 p.
Formulée pour la première fois en 2007 pour souligner la convergence des intérêts indiens et japonais en matière de sécurité maritime, la notion d'Indo-Pacifique s'est imposée en une petite décennie à l’agenda international. Elle structure les discours politiques et stratégiques de la plupart des États interagissant dans cette zone et, au-delà, fait l’objet de définitions concurrentes, de réinventions et de contestations. Elle agit comme un révélateur géopolitique : chaque acteur semble projeter à travers elle sa conception du monde. Cartes et données à l’appui, cet ouvrage propose, au fil des contributions, une synthèse inédite d’analyses sur une zone devenue un enjeu mondial. Coréalisée par le CERI et les Presses de Sciences Po, la collection « L’Enjeu mondial » propose les analyses de spécialistes illustrées de façon claire et pédagogique par des cartes et des graphiques en couleurs, et enrichies des données les plus récentes.
Autour de la publication
Vidéos
10 décembre 2024
Trois entretiens sur l'Indo-Pacifique
Entretiens avec trois auteurs de l'ouvrage, par Christophe Jaffrelot
Médias
22 janvier 2025
Quelle place pour la France et l'Europe en indo-pacifique à l'heure de la nouvelle politique internationale américaine ?
Débat avec Delphine Allès, par Quentin Lafay, France Culture
Recensions
8 février 2025
L’Indo-Pacifique : naissance d’un concept
Séverine Bardon, En attendant Nadeau
Janvier 2025
Recension de l'ouvrage L'Indo-Pacifique
Renaud Lambert, Le Monde diplomatique

Christophe Jaffrelot et Vanessa Caru
Paris, Fayard, 2024, 544 pages.
Bombay, devenue Mumbai en 1995, est surtout connue en France pour ses conditions catastrophiques de logement et pour son industrie cinématographique florissante, Bollywood. Au-delà de ces images attendues, Vanessa Caru et Christophe Jaffrelot ont voulu retracer l'histoire de cette cité devenue, depuis le XIXe siècle, la capitale économique de l'Inde ainsi que la ville la plus peuplée du pays, attirant migrants et migrantes à la recherche d'une vie meilleure. De port inséré dans de multiples réseaux commerciaux, elle s'est mue en une métropole industrielle et s'est imposée comme un des hauts lieux de la lutte pour l'Indépendance, mais aussi de puissants mouvements sociaux qui visaient à remettre en cause les inégalités de classe et de caste. Ressaisissant sa trajectoire historique, les auteurs éclairent les défis auxquels la ville est à présent confrontée : la montée de la xénophobie, notamment du nationalisme hindou, l'emprise du crime organisé, les effets de la désindustrialisation ainsi que des dégradations environnementales dont pâtissent au premier chef ses habitantes et habitants les plus précaires.
Autour de la publication
Entretiens du CERI
30 août 2024
De Bombay à Mumbai : une ville en mutation politique, économique et sociale
Entretien avec Christophe Jaffrelot, par Corinne Deloy
Recensions
Novembre 2024
Les livres du mois
Lili Frèrebeau, Le Monde diplomatique
12 novembre 2024
Les livres de la dernières minute
Jean-Marc Daniel, BFMTV
Janvier 2025
De Bombay à Mumbay
Clément Fabre, L'Histoire










